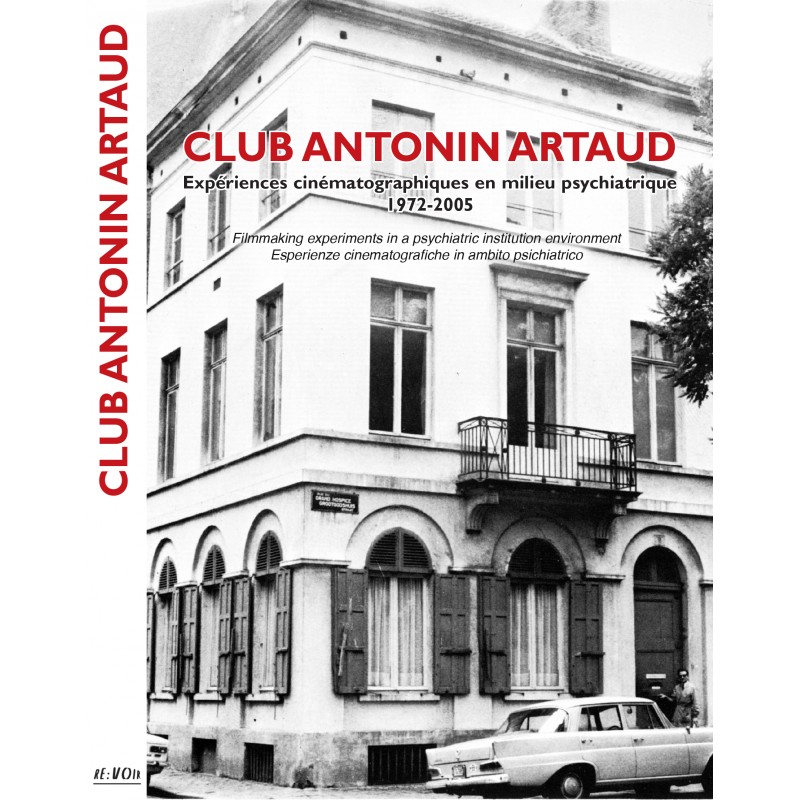DVD-Philes : Pour un seul de mes deux yeux
En 2005, Avi Mograbi complète sa filmographie avec Pour un seul de mes deux yeux. Son septième documentaire est présenté, cette année-là, en sélection officielle (hors compétition) à Cannes et remporte une mention spéciale au 16ème Festival International du Documentaire (FID).

 Depuis Déportation, son premier film daté de 89, Avi Mograbi s’interroge sur les événements, petits et grands, vécus par les israéliens et les palestiniens mais aussi par ses proches et lui-même. Cinéaste d’un réel politiquement complexe, il maintient son engagement d’homme, d’artiste, de voisin, d’ami, de juif et d’israélien dans son dernier opus.
Depuis Déportation, son premier film daté de 89, Avi Mograbi s’interroge sur les événements, petits et grands, vécus par les israéliens et les palestiniens mais aussi par ses proches et lui-même. Cinéaste d’un réel politiquement complexe, il maintient son engagement d’homme, d’artiste, de voisin, d’ami, de juif et d’israélien dans son dernier opus.