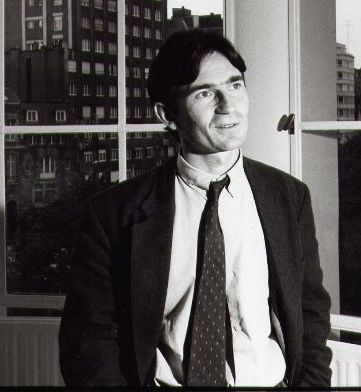Répertoires, le bulletin trimestriel de la SACD et de la SCAM-Belgique a publié dans son numéro 24 (Printemps 2000), Le documentaire est-il soluble dans la fiction ? (et vice-versa), un excellent dossier consacré au cinéma documentaire, animé par Marie Mandy.
La réalisatrice de Pardon Cupidon interroge quelques cinéastes sur l'évolution du documentaire, ses relations de plus en plus étroites avec la fiction et vice versa.
Pure Fiction est-il une fiction documentaire et, à l'inverse, Le Rêve de Gabriel est-il un documentaire de fiction ?
Nous mettons en ligne de larges extraits d'un dossier que vous pourrez vous procurer dans son intégralité en écrivant à Répertoires.