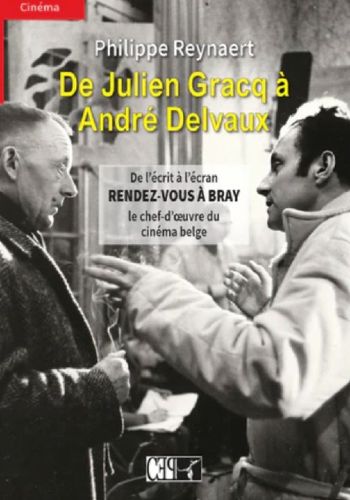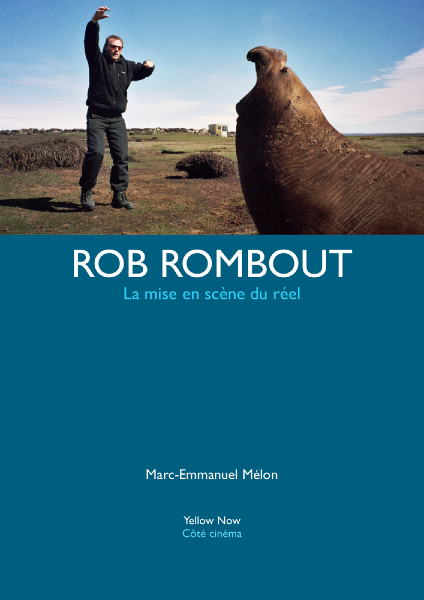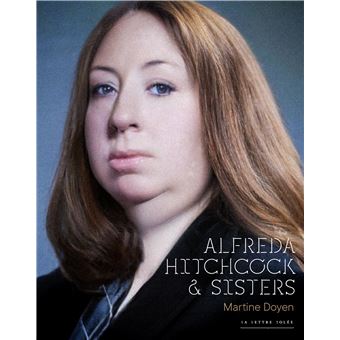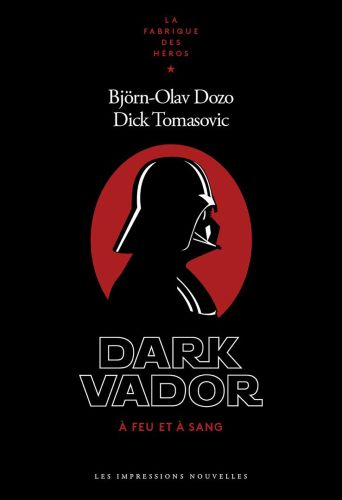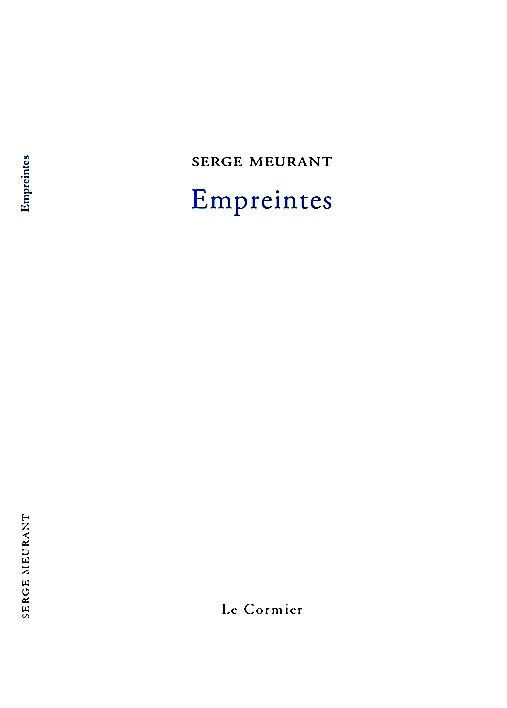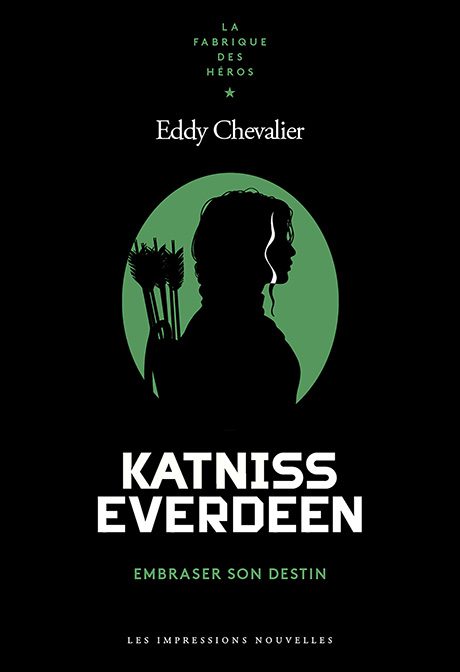Trafic 65, printemps 2008. L'énigme de l'acteur.

Ce numéro est entièrement consacré au métier le plus mystérieux du cinéma bien qu’il soit le plus vénéré du public. Après avoir passé plus de trente ans sur les plateaux de cinéma ou ailleurs à faire leurs portraits, (des instantanés qui créent de la durée dans le temps) leurs angoisses continuent à nous perturber.
Jouer à être un autre, est-ce le seul désir des acteurs ? Vouloir être plus beau ou plus désirable que ce que la nature nous a offert malgré nous ? Changer, « à ses propres yeux et à ceux d’autrui », l’impression que l’on suscite ? Rendre visible l’invisible ? Vouloir devenir immortel ?
L’acteur comme scénario de Sylvie Pierre examine tout cela, mais surtout la performance des magiciens du gag (les comiques) à vouloir rester fidèles à une même image.
« Cette construction volontaire de leur propre figure (y compris graphique, volumique, dans l’espace et la lumière des actes de scène ou des plans, y compris par le costume, le maquillage ou en cacophonie si le comique est parlant) d’une certaine façon leur interdit d’entrer dans la peau d’un autre que celle-là même qu’ils se sont inventés en tant qu’auteur d’eux-mêmes ».
Et si l’autre crise de 1929 était le passage du cinéma muet au cinéma parlant ? Suscitant l’angoisse de Buster Keaton ne sachant plus si son propre chapeau (célèbre devenu) suffirait désormais à imposer sa figure dans des films où la parole risquait de devenir déterminante (devenir un bavard, l’horreur pour un artiste). D’où, aussi, la longue résistance de Chaplin pour transformer son vagabond muet.
L’acteur comique a-t-il besoin de la parole pour rester, à l’infini, constamment fidèle à sa propre création ? « Le grand comique à concevoir la figure poétique qu’il devient, procède à une véritable auto-création, dont l’élaboration est sans doute autre chose qu’un jeu d’acteur, mais c’en est un aussi, puisque c’est, dans sa composition récurrente, le travail d’incarnation, d’une figure unique ». Prisonniers de la création de leur propre paraître ? « Chaplin charlotté, Tati hulotté, Etaix yoyoté, c’est autant de misère que de grandeur ».
« Monte dans ton Alfa, Romeo ! », s’exclame Brigitte Bardot dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Belle analyse de Sylvie Pierre sur les blasons du corps de BB (« Tu les trouves jolies mes fesses ? Oui. Et mes seins, tu les aimes ? », proche de l’Olympia de Manet.
Cela nous conduit, tout naturellement, au texte de Luc Moullet, l’un des plus drôles d’une revue qui n’a pas l’habitude de jouer avec l’humour. La durée de la mâchoire, la souplesse des reins, l’art de Jennifer Jones, voici le titre ! Comme d’habitude, Moullet démarre son texte à fond la caisse. Pourquoi Jennifer Jones ? « Parce qu’elle est la plus belle femme du monde. Entre nous, elle est encore plus belle que la mienne ».
Si Moullet nous apprend « qu'elle saute de King à Vidor, de la sainte à la sainte nitouche, femme fatale sans le vouloir mais qui a le feu au cul » (Duel au soleil, King Vidor, 1945) c’est surtout l’adresse de David Selznick, son soupirant devenu mari, qui nous amuse. Jaloux, celui-ci lui fourrait dans les pattes des homos comme Montgomery Cliff (Stazione Termini de Vittorio de Sica) ou Rock Hudson (L’Adieu aux armes de King Vidor).
Quant aux célèbres jambes de Jennifer Jones, rappelons cet échange avec Humphrey Bogart. Jones : « Ce n’est pas un homme sérieux – Bogart : Pourquoi ? – Jones : Parce qu’il n’a pas regardé mes jambes » (Beat the devil, John Huston, 1954).
Les fans de Jennifer Jones se souviennent avec admiration de son rôle dans Cluny Brown, le dernier film du maître de la « Lubitsch Touch », Ernst Lubitsch (faire rire à partir de deux thèmes majeurs : l’argent et le sexe).
« Etre plombier, avec ses instruments, ses entrées faciles chez les ménagères, c’est la profession dont rêvent les érotomanes, mieux encore que celle de dentiste, qui endort pour les plombages. Mais dans le film de Lubitsch, c’est elle, Cluny Brown, la plombière, qui tient sa quincaillerie, dans un sens à l’opposé de la norme et tout à fait pervers, d’autant que le débouchage de l’évier est suivi d’un bruit tardif et para-orgasmique peu ambigu chez le cinéaste qui, dit-on, allait mourir seize mois après entre les jambes d’une copine ».
Avec Marie-Anne Guerin, Le ravissement de Norma Jean, on passe de l’érotisme à la religion, au sacré : l’actrice comme une Sainte Thérèse d’Avila. « J’ai aimé le cinéma par les acteurs et à cause d’eux – et grâce à la lumière. Peut-être parce qu’ils ne sont jamais à l’écran par hasard ». Le ton est donné. Généalogie d’une description de Marilyn à l’écran et non avec Mister President Kennedy ou toute nue dans Playboy à travers l’objectif des grands photographes américains. « Marilyn, en pleine gloire, connaissait déjà par cœur cet espace paradoxal, délié de tout, ce statut d’invisibilité, doublé de l’illusion d’une clandestinité, à l’ombre gigantesque d’une extrême célébrité.»
« Actrice qui se sert de son corps, elle fait surgir la partie du corps qui écrit » (…) ce qui vit chez Monroe, c’est ce qui joue. Pour interpréter, il faut incarner le mouvement et emprunter l’espace. » Dans River Of No Return (La rivière sans retour), Otto Preminger, Viennois et fin connaisseur de la psychanalyse, cadre en cinémascope le nerf de la guerre : le sexe. La relation homme/femme et l’alliance de Marilyn (Kay) avec l’enfant (contre son amant Harry pour Mark l’enfant de Matt Calder). « Marilyn a choisi son camp. Et c’est toujours celui des femmes ou des enfants. D’ailleurs pour elle, on le verra, c’est la même chose, la mère et l’enfant ».
Sur la voix singulière de Marilyn, on sait que contrairement à l’homme, la femme garde sa voix d’enfant (ce qui a permis à l’Ars Perfecta de la polyphonie de se construire). « Le cinéma a détourné Norma Jean de sa réalité d’enfant spolié et méprisé. Mais Marilyn n’a rien abandonné de son expérience, préservant de l’enfance une voix très minuscule et mélodique. Tel un souffle dont toutefois on ne peut oublier le corps d’où il provient…C’est la voix d’une enfant dans un corps de femme sublimé ».
Signalons aussi, Passage à l’acteur par Jean-Louis Comolli. Longtemps, l’écart entre le monde du documentaire et de la fiction s’est imposé comme une évidence quasi irréversible. Depuis le triomphe planétaire des mass média, la planète-cinéma comporte désormais un ensemble : la fiction et le documentaire face au monde de l’information. D’où l’idée : et si le documentaire était nourri par son ou ses acteurs ? On divague ? Pas du tout. Bien sûr il ne s’agit pas du comédien qui a choisi comme destinée le « je est un autre », cher à Rimbaud, mais du comédien de passage, « de l’acteur d’un jour qui ne saurait tout à fait, lui, être un autre que lui-même» ainsi que le définit Comolli.
Donc, hormis chez Pedro Costa ou Abbas Kiarostami qui utilisent des acteurs non-acteurs, en fiction, on pourrait dire qu’un comédien professionnel dans une fiction « fait comme s’il n’était pas filmé, comme si le cinéma n’était pas là, la caméra inconsistante, transparente, immatérielle, comme s’il n’y avait entre lui et le spectateur rien d’autre que du plaisir et du jeu, justement ». Tout autre est le dispositif du documentaire où « le motif de la complicité est au départ de la relation filmée ». L’acteur d’un jour « désire avec force » être filmé et non s’en cacher comme dans l’increvable émission télé « caméra cachée ».
Lire aussi le beau texte de Babette Mangolte, Rompre le silence (quarante ans après). Lorsque avant de filer vivre aux Etats-Unis, elle vivait à Paris, « étudiante dans une mansarde du Quartier Latin, rat de cinémathèque, traînant dans les cafés à discuter, des nuits entières, des séries B américaines », elle découvre Pickpocket de Robert Bresson (tourné à Paris durant l’été 1959) qui la stupéfie (combien de réalisateurs ne cessent de nous parler du choc du chef-d’œuvre de Robert Bresson et de leur découverte des modèles, les acteurs non-acteurs). Parmi ceux-ci, Pierre Lameyrie, étudiant en médecine, qui interprète Jacques, l’ami du protagoniste principal Michel (Martin Lasalle). Lameyrie, un comédien de passage (pour citer Comolli), et qu’elle redécouvre à Paris, quarante ans après, lui rappelant d’un coup sa jeunesse dans les années '60, « un art de la vie qui semblait éternel et pour lequel le temps n’existait pas ». D’où le désir pour Babette Mangolte de découvrir l’énigme de Pickpocket en enquêtant sur son tournage. Suit le scénario.
Kim Novak est-elle une invention de Columbia Pictures ? Existe-t-elle en dehors du grand studio américain ? Suspense ! Jonathan Rosenbaum vous répond dans Kim Novak, l’indépendante du Middle West.
Plus, Charlie Chaplin : la machine et son ombre de Jacques Rancière, Anita/Anita de Mark Rappaport, Le Joker d’Elfriede Jelinek, etc.
Un numéro, vous l’avez compris à ce stade de votre lecture, indispensable pour allumer votre été.
Trafic 65, printemps 2008