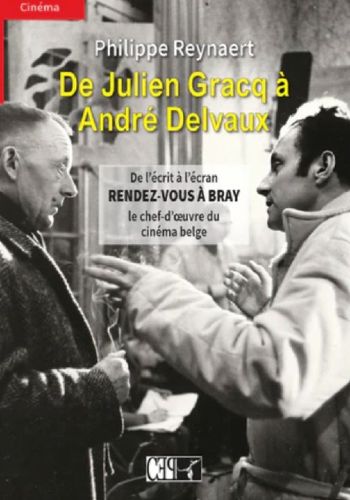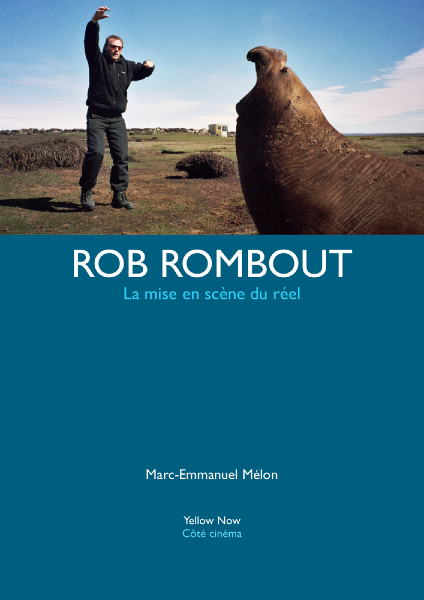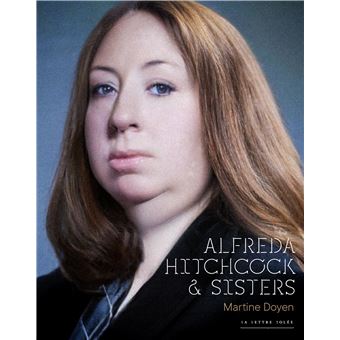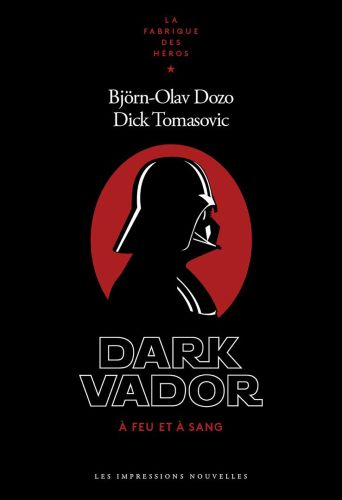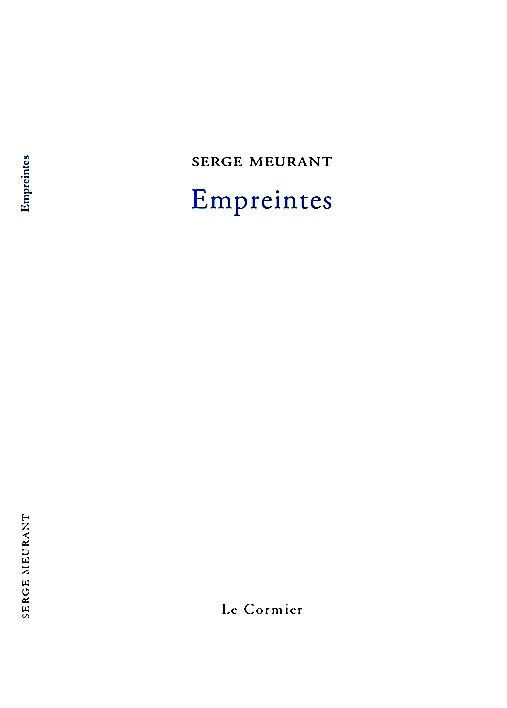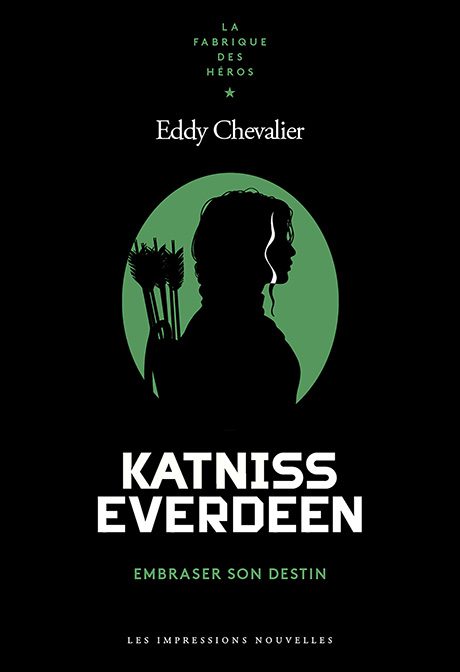Trafic 67(suite), automne 2008
 1. Faut-il soutenir l’hypothèse du tableau volé d’Hervé Gauville ?
1. Faut-il soutenir l’hypothèse du tableau volé d’Hervé Gauville ?Nous nous souvenons encore de notre stupeur lorsque nous avons découvert, dans les années 80, l’Hypothèse du tableau volé, le second film de Raoul Ruiz. Pour n’égarer personne (ou égarer tout le monde), revenons sur ce film inspiré par un texte de Pierre Klossowski sur le « statut (onto)logique de la peinture ». Hervé Gauville, à qui l’on doit, depuis Trafic 60 une série d’articles sur le cinéma et la peinture s’y atèle.
Un collectionneur, exégète de sa propre collection, nous montre les tableaux, aujourd’hui tombés dans l’oubli, du peintre Tonnerre, un parangon du style pompier qui méprisait le style des impressionnistes. Il reste six sur les sept, le quatrième ayant été volé. Ce tableau disparu détient le secret de la continuité de l’ordre des œuvres et donne sens à l’ensemble. Le collectionneur nous conte donc ce qui relie les sept tableaux à travers un double mouvement : les toiles qui ne montrent pas, mais font allusion et, telle une représentation théâtrale, les tableaux vivants qui ne font pas allusion mais montrent.
« Ces tableaux vivants, très prisés dans les soirées mondaines du XIXème siècle, ont connu un regain de faveur grâce au cinéma. Passion (Godard) et La Ricotta (Pasolini) en fournissent une illustration de choix. Dans le film de Ruiz, leur fonction est sensiblement différente. Ils étoffent l’argumentation du collectionneur. » Certes, mais laquelle ? Un scandale. Ne croyez pas trop au rocambolesque récit du tableau 4 qui, au moment où le collectionneur nous le montre, semble être la clé de l’énigme. Une histoire de quiproquos amoureux, de complot de société secrète (là, on vous file un tuyau), de scandale homosexuel (avec un jeune éphèbe qui fait tomber les bretelles des mâles devant une Justine qui se voit en Sainte Thérèse d’Avila), de suicide avorté. En un mot, le genre d’allusion que la bourgeoisie du 19ème siècle, pour se punir de ses illusions, adorait évoquer dans ses romans devenus illisibles ou dans le théâtre de boulevard.
Le scandale n’est pas non plus le Baphomet, l’éphèbe nu cher à Klossowski, figure trinitaire incluant la dualité androgyne, ni ceux à qui ce signe est adressé, à savoir les Templiers.
Nous y voilà. Ces moines-soldats du Moyen Age, ce contre-pouvoir qui a menacé un ordre monarchique qui le leur a bien rendu en les éliminant, feu les templiers ? Pas sûr... Puisque le récit du collectionneur semble s’adresser aux heureux élus choisis par une société secrète, les Templiers de l’art (ni art pour l’art, ni art populaire) au service d’un art qui n’est accessible qu’à deux conditions. « D’abord, une initiation. La peinture doit être déchiffrée selon un mode d’emploi que chaque spectateur découvrira en suivant les signes de pistes déposés par l’artiste de tableau en tableau. Ensuite, une émancipation. Une fois initié, ce nouveau Templier de l’art inventera la signification des images qu’il parcourt du regard au fur et à mesure que progressera son observation ». Mais le tableau volé ? L’énigme vous est montrée dans la pièce vacante du tableau 4 et finement expliquée par Hervé Gauville. Lisez-le. En bonus, il vous expliquera, en fin de texte, qui a volé le tableau. Diantre !
Signalons les autres textes de Gauville, sur le sujet : Blow-Up d’Antonioni (Trafic 60), Passion de Godard (Trafic 61), La Ricotta de Pasolini (Trafic 63), Les Glaneurs et la glaneuse de Varda (Trafic 64), Cinq femmes autour d’Utamaro de Mizoguchi (Trafic 66).
2. Johnnie To, un jeu anachronique de Julien Gester, chroniqueur cinéma aux Inrockuptibles.
Cette année, au printemps, la cinémathèque française offrait à Bercy une rétrospective des films de Johnnie To. Analyse de Julien Gester.
Dès sa création avec Wai Ka-Fai, en 1996, le studio de Milkyway Image Company s’est, au fil du temps, établi comme un modèle économique exemplaire d’équilibre entre rationalité de tiroir-caisse et ébullition créatrice. Tant et si bien que la production partage chaque année sa production de films dédiés à renflouer l’œuvre spécifique de Johnnie To; des blockbusters à têtes d’affiche cantopop (films spécifiques à Hong Kong sur la musique populaire chinoise avec des stars comme Faye Wong et Leslie Cheung) qui ont un succès fou.
Des premiers films de la compagnie Milkyway, avant la rétrocession de l’île à la Chine pop, en juillet 1997, on découvre « des mythes que l’on s’invente dans l’instant pour combustion immédiate, à la folle allure de ceux à qui il ne reste plus le temps de vivre ». C’est A Hero never dies (1998), Lifeline (1997), Expect the Unexpect (1998). Cette virtuosité dans une mise en scène fragmentée dans le dédale du temps, dans les reflets d’un labyrinthe qui échappe au sens (à cet égard, revoyez ce sommet du genre, incompréhensible pour beaucoup, de Time and Tide de Tsui Hark).
La pré rétrocession a été vécue comme un temps lié à l’immobilité des ruines, une immobilité du temps où l’on vit les ruines d’un passé à jamais disparu. La fin d’un monde ou la fin du monde ? Juillet 1997 a été vécu par les habitants d’Hong Kong comme une implosion à l’inverse de l’implosion du World Trade Center, en 2001, à New York.
Le changement de siècle, avec The Mission (2000) permet aux films de Johnnie To de reprendre le temps, de s’attarder dans la durée.
« Johnnie To a échafaudé sa maison sur des cendres, souligne très justement Julien Gester, c’est sans doute cette affirmation tardive qui le fascinait, il devint ce cinéaste arrivé au soir qui prend conscience que le seul talent qu’on lui laisse est le génie du retard, que son heure vient après la tombée de la nuit, que son jour sera toujours celui d’après. Même une fois que la crise aura mis tout le monde à terre sauf lui, son cinéma demeurera hanté par le spectre de la survivance.» Pas seulement dans les « gunfights » qui lui ont donné une réputation mondiale, mais aussi dans une comédie romantique comme Yesterday Once More, (Monsieur et Madame To – on n’invente rien – deux voleurs mariés se disputent le partage du butin). La même désolation souterraine parcours Fulltime Killer (2001), ce somptueux polar, co-réalisé avec Wai Ka-Fai, dans lequel s’affrontent deux tueurs : O le professionnel solitaire et Tok (Andy Lau) un tueur extraverti. Qui va devenir le meilleur ?
La grande désillusion qui survient lorsque l’horloge locale du temps a cessé de tourner, les fans de Wong Kar-wai la connaissent bien. On se souvient de l’horloge de Chungking Express (1994), de l’anxiété du temps dans Happy Together (1997), « film de la bascule où les horloges demeurent figées sur 00-00, il y aura aussi la beauté stagnante de In The Mood for Love et puis 2046, l’adieu de Wong Kar-wai à Hong Kong, sublime film immobile.
Etre figé avant le temps de la date de la rétrocession ne consiste-t-il pas, dans ce temps stationnaire, à vivre l’éternité du monde, tout simplement ? Ne consiste-t-il pas à être, tout simplement, dans un cycle d’un temps global comportant « deux phases : ascendante et descendante », selon Krzysztof Pomian (3) qui distingue un présent progressif tourné vers le futur et un temps régressif immobilisé pour calmer les angoisses du futur.
Johnnie To change de registre avec P.T.U. (2006) comme avec The Mission (2000), plus de courses échevelées, « les échéances temporelles se sont évaporées et les traques policières se mènent désormais au pas dans la nuit hongkongaise. »
Qu’en est-il du duo Johnnie To et Wai Ka-fai, producteurs, scénaristes, et parfois co-réalisateurs ? Au début, Milkyway image permettait à d’autres réalisateurs de faire des films, retenons Too many ways to be number one (1997) de Wai Kai-fai, produit par To. Puis surgit un OVNI, un certain Patrick Yau qui réalise trois films dont l’excellent The longest nite qui date de l’année de la rétrocession (1997). Une heure vingt, à bout portant, d’un film produit par Johnnie To et Wai Kar-fai, considéré comme une matrice des néo-polars à la Johnnie To’s Touch. Pourtant, Patrick Yau est demeuré si mystérieux que beaucoup prétendent que Johnnie To producteur et maître du jeu porte la signature du film. Où est celui qui porte le masque de Patrick Yau ? Quelle est sa version ? Monsieur Yau est introuvable. Existe-t-il, ou est-ce un pantin, une boule de billard de Maître To ? Mystère intemporel des nuits hongkongaises. Contentez-vous de vous ruer sur la projection de ce film mystérieux.
Soucieux d’ouvrir une nouvelle orientation, un nouveau style à Milkyway, To relance une co-réalisation avec Wai Ka-Fai dans Mad Detective. Pour tout savoir sur leur volonté de surprendre le public, après une brillante décennie (1996-2006) lisez la suite et la fin de l’excellent article de Julien Gester.
3. Ontologie d’un fétiche par Dudley Andrew nous parle de Sartre et d’André Bazin auquel ce professeur du département Cinéma de l’Université d’Iowa a consacré un livre (1). Truffaut dans sa préface écrivait : « J’ai lu ce livre comme un roman dans lequel je savais que tout était vrai ».
Andrew écrivait en 1978 que Sartre, Malraux et Bazin concevaient la notion de l’art comme une activité où les hommes cherchent à refaire le monde. « L’Art n’est qu’une des voies par lesquelles nous réglons cette impulsion ; il est comparable au rêve diurne, à la satisfaction émotionnelle et à certains actes de l’imagination qui, pour Sartre, comptent entre autres l’amour, le militantisme politique et le suicide. Tous ces modes montrent l’homme essayant de donner forme, dans le vide de sa conscience, à la plénitude du monde qui lui appartient ».
Dudley Andrew nous avoue posséder dans son grenier, sur près d’un mètre de haut, des photocopies des écrits publiés par Bazin (2.600 titres dont moins de sept pour cent sont disponibles en français). Parmi ces documents, l’Imaginaire de Jean-Paul Sartre, édité par Gallimard, en 1940, un volume jauni, défraîchi à force d’être lu qui se trouvait sur l’étagère au-dessus du lit de mort de Bazin, et que Janine Bazin, sa veuve « m’avait laissé choisir comme souvenir en 1974. Trente ans plus tard, Andrew ouvre le livre aux pages 38 et 39 des passages soulignés au crayon sur « l’ontologie de l’image cinématographique ». Une notion qui allait permettre à Bazin de préciser son point de vue sur la photographie et le cinéma. Des phrases qui nous hantent depuis 50 ans. Sur la photo : « La photographie ne crée pas comme l’art, de l’éternité, elle embaume le temps, elle le soustrait à sa propre corruption ». Sur le cinéma : « Pour la première fois, l’image des choses est aussi celle de leur durée et comme la momie du changement. Car le cinéma réalise l’étrange paradoxe de se mouler sur le temps de l’objet et de prendre par surcroît l’empreinte de la durée. » (3)
Plus encore, en tournant les pages de l’Imaginaire, Andrew découvre, à sa grande surprise, une feuille de papier qui s’avère être un écrit tapé à la machine de Bazin dans le bouquin.
Ce texte analyse la position du cinéma entre la photographie et la télévision et se divise en trois parties. La première « appelle la photographie un document. Dans la seconde « Bazin imagine cette photographie prenant vie dans une bande d’actualité ». La troisième nous signale que « les spectateurs d’une émission de télévision participent simultanément à un seul et même événement. Les images de cinéma, elles, sont vues des jours, des semaines ou des années après le moment où elles sont tournées ».
Une distinction, comme le souligne Andrew, qui s’est atténuée… les images différées étant devenues nombreuses. Néanmoins, le direct des rencontres sportives, journaux d’information, les Jeux Olympiques, la cérémonie des Oscars ainsi que d’autres émissions en direct sont là pour témoigner que la télévision se différencie essentiellement du cinéma. La philosophie baziniene de l’image s’inscrit dans cette différence ».
Trafic 67, automne 2008
(1) L’ordre du temps de Krzsysztof Pomian, édition Gallimard, 1984
(2) André Bazin par Dudley Andrew, éditions des Cahiers du Cinéma, série Essais, 1978
(3) Qu’est-ce que le cinéma par André Bazin, éditions du Cerf.