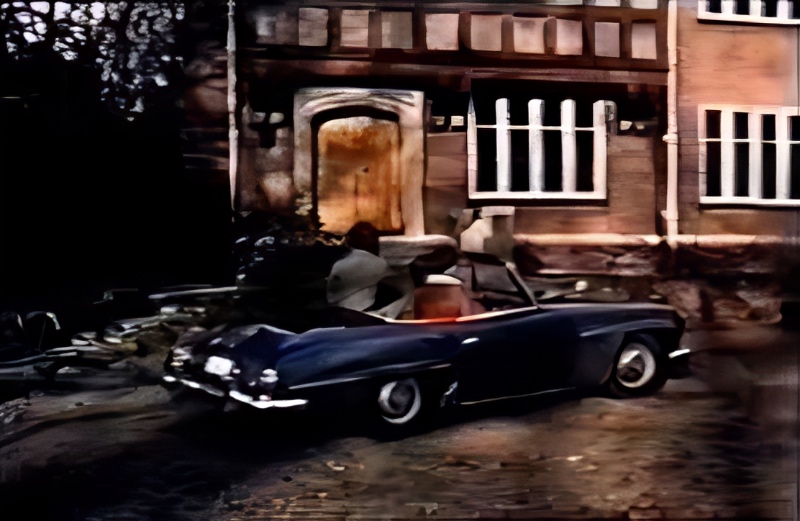Un simple maillon de Frédéric Dumont

Un simple maillon de Frédéric Dumont
Si personne n'a oublié les ravages de la Seconde Guerre Mondiale en Belgique, peu de gens ont entendu parler du « Comité de Défense des Juifs » et de ces femmes qui sauvèrent plus de 3000 enfants d'une mort certaine, en les cachant pour les sauver des rafles nazies. Andrée Geulen est la dernière survivante de ce réseau d'entraide et de sauvetage, « un simple maillon » selon ses propres mots, mais dont l'activisme forcené aura permis de sauver quantité de vies. A travers son témoignage, d'une rare intensité, le film retrace l'histoire de ce comité créé en 1942 : on y voit une femme encore belle, à peine marquée par le poids d'un passé douloureux, nous raconter comment s'organisait la survie clandestine des enfants, des transports au ravitaillement. « Nous étions une douzaine de femmes... un douzaine de femmes, juives et non juives, qui luttions contre la Gestapo. Je nous vois toujours comme cela. Les non juives étant le plus souvent dans les trams, les trains et les endroits dangereux ». Andrée Geulen se rappelle avec précision de cette époque terrible où de ses actes dépendait la survie de milliers d'enfants arrachés à leur famille : c'était elle qui se chargeait de ce dur labeur, « sans doute parce que je n'avais pas d'enfant, donc c'était plus facile », raconte-t-elle les larmes aux yeux. Certains de ces enfants peuvent encore témoigner aujourd'hui de cette période difficile qui les vit se terrer dans des monastères ou des familles d'accueil pour éviter la déportation vers Auschwitz. Henri Lederhandler se rappelle, la gorge serrée, de ses amis envoyés dans les camps et qu'il ne revit jamais. Jerry Rubin explique combien ce passé est lourd à porter, lui qui « n'a toujours pas trouvé d'explication » à cette guerre qu'il tente vainement d'enfouir en lui. Paul Pitterman raconte son séjour dans un monastère, et la sensation désarmante de devoir se faire passer pour un autre. Suzanne Didkewicz parle des conditions précaires dans lesquelles se déroulait cette existence recluse, indigne d'un homme... Tous les quatre en tout cas témoignent d'une reconnaissance extraordinaire envers Andrée Geulen, qui, d'après Suzanne Didkewicz, « a sauvé l'humanité ». Depuis ces tragiques événements s'est tissée une amitié tenace entre la femme et toutes ces personnes dont elle a sauvé la vie, les vies (« Ce n'est pas moi qu'elle a sauvé, mais mon fils, mon petit-fils, et plus encore », confie Suzanne, avec émotion). Malgré quelques effets dramatiques trop appuyés et vite agaçants (la musique de thriller, les ombres d'une silhouette fuyante sensée incarner l'enfant apeuré), « Un simple maillon » se veut le témoignage juste et parlant d'un épisode de la guerre par trop méconnu. Une leçon d'humanité et d'amour, un message exemplaire de tolérance et de courage.
L'Homme qui voulait classer le Monde de Françoise Levie
« L'Homme qui voulait classer le Monde » raconte la vie de Paul Otlet, utopiste forcené à qui l'on doit le système de Classification Décimale Universelle toujours en vigueur dans les bibliothèques, le microfilm, voire Internet puisque déjà en 1934 cet encyclopédiste obsessionnel parlait d'une « Bibliothèque irradiée » (joli !) consultable à distance grâce à... un écran de télévision et un téléphone. Aujourd'hui pourtant, Paul Otlet n'est connu que des papivores les plus forcenés, et la réputation de scientifique pointilleux qu'il s'était érigé au fil des années n'est plus connue que des (très) vieux documentalistes (un mot qu'il fût d'ailleurs l'un des premiers à employer). La vie de Paul Otlet est à l'image de la documentation gigantesque qu'il aura amassée pendant plus de cinquante ans : sans doute cataloguée quelque part, dans une caisse, sous un amas de papelards hétéroclites au contenu indéchiffrable. Il aura donc fallu du courage à Françoise Levie pour retracer avec précision le parcours d'un homme déluré dont la noble mais folle ambition était de créer une Cité Mondiale « où concentrer les plus grandes forces intellectuelles », une ville utopiste dédiée à la Connaissance, la Fraternité et la Paix... Tout un programme laissé en plan à la mort d'Otlet en 1944, avant d'être oublié pour de bon... Jusqu'à ce que Benoît Peeters et François Schuiten, un jour, décident de rendre hommage à Paul Otlet en montant une exposition à Mons, dans un endroit qu'ils baptisent pour l'occasion « Mondaneum », vestige fantasmatique d'un allumé notoire qui voulait classer le Monde (et tout le reste). Un monde répertorié pendant toute une vie, puis à sa mort enfermé dans des caisses en carton, vite abandonnées dans un vieux bâtiment situé au fond du parc Léopold... Voilà ce qu'il restera, pendant trente ans, du travail gigantesque de Paul Otlet, utopiste génial mais victime de sa propre obsession. C'est en voyant ces caisses, derrière les vitres sales où parfois se glissait l'ombre fantomatique d'un vieil homme en redingote poussiéreuse, que Françoise Levie eût l'idée de faire ce film. En partant d'un constat simple mais problématique : comment filmer des caisses sans ennuyer le spectateur ? En se filmant les déballant, avec l'aide d'une jeune fille sans doute étudiante en biblio. Les aventures rocambolesques de Paul Otlet prennent ainsi forme au fil du déballage, un véritable travail de fourmi effectué avec patience et passion par les deux femmes. Concrètement, l'accroche visuelle d'une image d'archives ou d'une photo d'époque part de la lecture à voix haute d'une note ou d'une affiche, tandis que retentit, de manière redondante, la voix supposée de Paul Otlet. De son amitié avec Henri Lafontaine, Prix Nobel en 1913, à son délire de créer une ville imaginaire (dont les plans seront confiés à l'architecte Le Corbusier), aucun détail ne nous est épargné sur sa vie dédiée à la recherche et au classement... Parce que classer, selon lui, « symbolise la plus haute opération de l'esprit humain » (sic). Au fil de leur enquête minutieuse, Françoise Levie et son assistante Leila tantôt s'émouvront (les confessions d'Otlet à la mort de Jean, son fils ; en découvrant ses relations adultères) tantôt s'étonneront de cette tonne d'informations amassée par le savant. Pour mieux coller au sujet, la réalisatrice choisit d'être la plus claire et scolaire possible au niveau de la mise en scène : ici pas d'esbroufe, que l'essentiel pour déchiffrer l'univers complexe du personnage, comme si la méthode de travail du documentaliste s'appliquait par mimétisme au travail filmique. Françoise Levie s'applique comme une bonne élève à rendre hommage à cet homme original, et se filme s'y appliquant. Peut-être qu'un regard un peu plus corrosif sur ce destin singulier aurait rajouté davantage de piment au film... Celui-ci terminé, les caisses ont été refermées. La boucle est bouclée. Sauf que maintenant, on sait qui fût Paul Otlet, et quelle incidence eût son travail sur notre société des communications, des fiches de classement à l'Internet. En ce sens, malgré que son idéal fût de son vivant un échec, il apparaît aujourd'hui comme un précurseur inattendu. La consécration posthume, en somme.
Black Spring de Benoît Dervaux
Après « La Devinière » et « A Dimanche », Benoît Dervaux prend la tangente expérimentale : son nouveau court métrage, en fait un film de commande « détourné » dans la tradition storckienne, mêle ainsi chorégraphie et interrogation du réel, dans un tourbillon de corps et d'images d'Afrique. Au départ, « Black Spring » est un spectacle chorégraphique de Heddy Maalem - un univers auquel Benoît Dervaux n'est pas vraiment familier... « Lors de notre première rencontre, on avait chacun de grosses réserves, explique le réalisateur. Je ne voyais pas très bien ce que je pouvais faire, à part une captation, et lui trouvait ça trop réducteur... Finalement nous avons eu l'idée de mêler le langage des corps au langage du réel et de la peinture, avec en filigrane la question du regard occidental sur l'Afrique, à travers ses corps. Le film se saisit ainsi de la matière dansée du spectacle qui, confrontée à des images de l'Afrique d'aujourd'hui, élargit notre propos vers une question essentielle : celle de notre regard sur l'Autre ». Visuellement, cela donne un résultat déroutant par son aspect brut et non narratif, mais pas moins captivant : l'on voit ainsi des danseurs au physique taillé dans le marbre (noir) se fondre dans un torrent de brèves séquences africaines (la foule, le port d'une ville, la mer, la nature), leur rapport visuel questionnant dès lors notre conditionnement aux images d'un autre monde, d'une civilisation qui reste à nos yeux méconnue et réduite à de violents clichés. De cette tension des corps, qui se cognent, s'enlacent, se mêlent, s'épuisent, l'on retient non pas l'animalité, vestige colonialiste d'une époque trouble, mais l'extraordinaire empreinte d'une culture qui se veut à tout prix moderne. « Do you want to see more african danse ? », crie l'un des danseurs, regard caméra, avant d'entamer une furieuse course dans la boîte noire de 12 m2 qui lui sert d'espace chorégraphique et incantatoire. Devant une telle débauche d'énergie, accentuée par un montage haletant de plans glanés sur le continent noir, on ne peut qu'acquiescer. Et s'interroger, pour le réévaluer, sur le regard biaisé qu'on porte sur l'Afrique.
Washington, Bruxelles-Kinshasa de Fabian Hannaert
Ce film réalisé avec des bouts de ficelle raconte l'histoire de Washington, Congolais exilé à Bruxelles depuis de longues années. Son seul but : faire venir en Belgique sa femme Mado, qui est restée à Kinshasa pour on ne sait quelle raison. « C'est Washington qui m'a demandé de faire un film pour sa femme, qu'il n'avait pas vu depuis huit ans. Il voulait filmer sa vie pour la lui montrer ». En bon copain, Fabien Hannaert a donc pris sa caméra et filmé Washington dans sa vie de tous les jours : au café, au repassage, à la fenêtre, toujours dans l'attente d'une lettre ou d'un coup de téléphone de cette femme qu'il aime par-dessus tout mais qu'il n'a plus vue depuis des lustres. Pourquoi ? On ne saura jamais les raisons de la rupture. Sans doute une histoire de papiers. En filigrane de cette triste histoire humaine se dessine ainsi une critique amère de la politique administrative qui empêche des milliers (millions ?) de personnes de vivre décemment leur amour, faute d'un visa en ordre, d'argent, de « bonne » couleur de peau. Washington ne vit que dans l'espoir d'un jour revoir sa belle. Il a confiance. Il s'applique à y croire. Là-bas, à Kinshasa, Mado continue de vivre tant bien que mal, seule malgré le soutien moral de sa famille. Elle parle de leur rencontre, quand Washington, au premier coup d'oeil (un coup de foudre, appelle-t-on ça), décida que cette fille serait sa femme. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. Du moins dans leur coeur. « C'est rare à Kinshasa qu'une femme reste ainsi fidèle à son homme pendant 12 ans », raconte une amie de Mado. Comme le dit cette dernière : « Ma maison, c'est là où est mon mari ». Un amour aussi fort, qui dépasse les frontières, est en effet plutôt rare. « Loin des yeux, loin du coeur », dit le proverbe. Dans le cas de Mado et Washington, c'est tout le contraire. Mais chacun de leur côté, ils n'en sont pas moins désespérément seuls. Minés par l'absence de l'autre. Mais pas résignés. Si Fabian Hannaert a filmé (séparément) le couple dans des conditions plutôt artisanales, il est parvenu, sans ficelles ici, à traduire les sentiments qu'éprouvent Washington et Mado l'un pour l'autre, même séparés par des milliers de kilomètres. Parfois, le film prend des allures de reportage télé, voire de film de famille, mais de cette proximité jamais impudique jaillit justement l'émotion. Sans doute qu'avec plus de moyens, le jeune cinéaste n'aurait pas aussi bien capté l'essence même de l'amour de ces deux êtres - un amour profondément intime, indestructible, qui n'a pas besoin de gros moyens pour resplendir à l'écran.
L'Homme de Pâques de Thomas Lavachery
En 1934, une expédition franco-belge se rend sur l'île de Pâques pour tenter d'élucider le mystère de ses fameuses statues. Ses membres, le Belge Henri Lavachery (en fait le grand-père du réalisateur) et le Suisse Alfred Métraux, défendent des hypothèses différentes au sujet de ces statues : pour Lavachery, muséologue passionné par les arts primitifs, il s'agirait de vestiges d'une civilisation évoluée ayant disparu... Pour Métraux, anthropologue renommé au scepticisme de scientifique, ce serait les Pascuans qui les auraient érigées... L'hypothèse de Lavachery, bien que plus séduisante pour l'inconscient collectif, se révélera très vite dénuée de toute plausibilité. Peu lui importe cette erreur de jugement : le plus important, c'est de frayer avec la population indigène, alors que Métraux, lui, reste plongé dans ses notes, pestant contre ces sauvages qu'il accuse d'avoir saboté un patrimoine archéologique inestimable. Lavachery, d'une humeur plus liante, deviendra rapidement l'ami des Pascuans, le « cabalero bueno » aux bras pleins de présents, et même l'amant inavoué de Victoria, la seule survivante d'une longue descendance royale, « l'incarnation de la beauté ancienne de l'île ». C'est sur ce canevas dramatique que le film de Thomas Lavachery émeut le plus : en usant des méthodes d'écriture scénaristique en général réservées aux fictions romanesques, le réalisateur réussit à nous émouvoir, alors qu'au départ il s'agit d'un documentaire sur une expédition scientifique. Le film prend dès lors une tournure inattendue, avec l'épisode de la fille de Victoria, Ana, que Lavachery désire emmener en Belgique... Le film, d'ailleurs, s'ouvre sur les images d'une jeune fille courant dans les herbes folles de l'île de Pâques, avec en fond musical des violons larmoyants : « bien plus qu'une anecdote scientifique, il s'agit d'une aventure humaine », souligne le cinéaste. De cette aventure exceptionnelle, on retiendra donc plus l'aspect narratif de la relation trouble qui unit Lavachery au couple Ana/Victoria que les explications savantes d'un Métraux dépeint comme un triste sire obnubilé par ses hypothèses sur les ahus, les statues et les pétroglyphes... L'histoire de ces deux hommes que tout oppose, si ce n'est leur passion pour une civilisation coupée du monde et nimbée d'un voile de mystère, n'aurait pas pu se faire sans un important travail de reconstitution : dans ce sens aussi, « L'homme de Pâques » s'avère une belle réussite. Thomas Lavachery a bénéficié d'un fonds d'archives extraordinaire : photos prises par l'expédition, et surtout ces images filmées par John Fernhout, le cameraman attitré de Joris Ivens. Pour l'anecdote, c'est Henri Storck qui devait y aller, mais son emploi du temps l'en empêcha... « L'homme de Pâques » peut donc se lire aussi comme un hommage au plus grand de nos documentaristes, lui qui à l'époque s'était déjà rendu sur l'île... Ode à l'amour et au respect de l'Autre, grand documentaire dans la tradition storckienne, film scientifique au rôle éducatif et historique : pour tout cela « L'homme de Pâques » est une oeuvre qu'il faut voir, singulière et riche en enseignements.