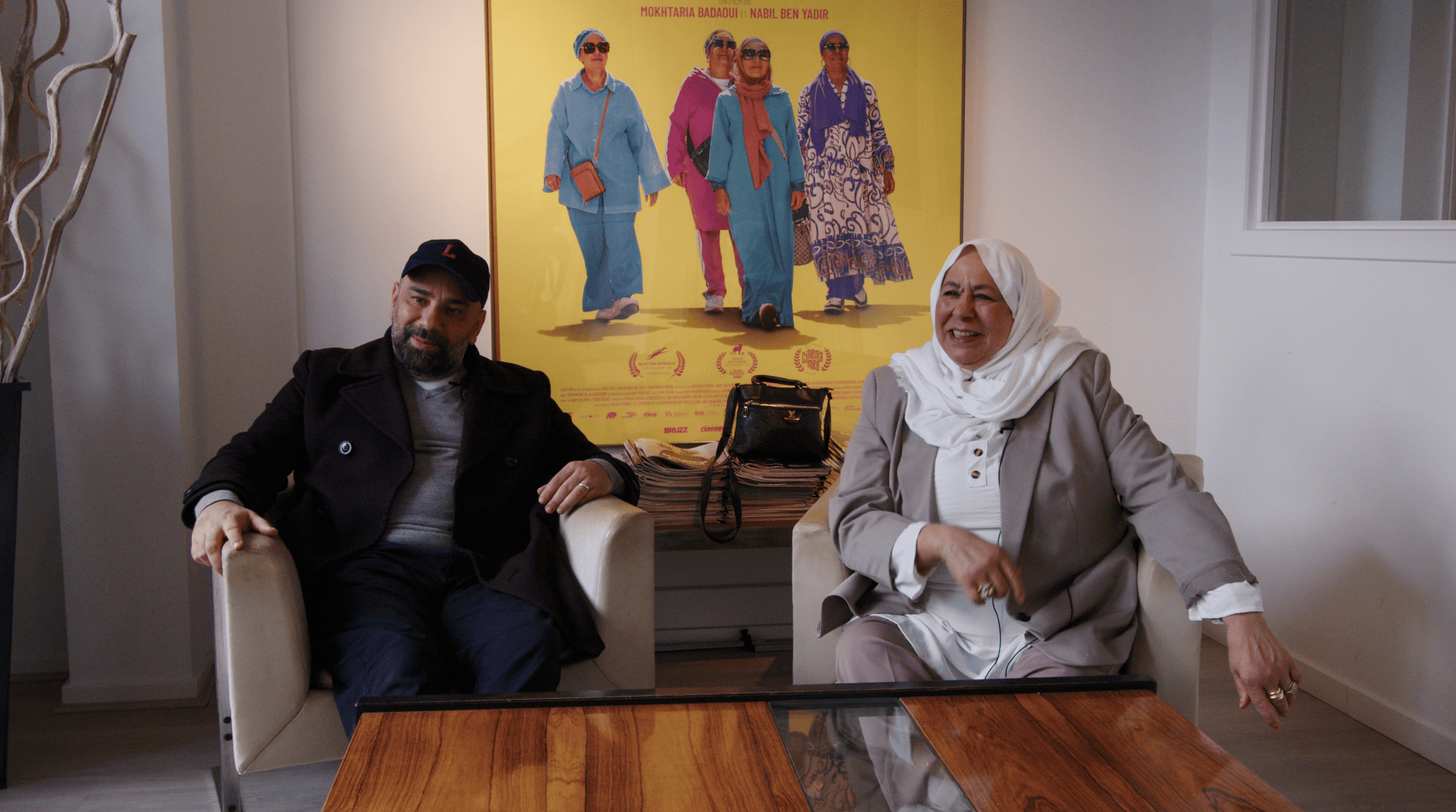Pierre-Yves Vandeweerd : Le Cercle des noyés
Cinergie : Tu aimes parler des gens, mais tu n’aimes pas les montrer, tu as une certaine pudeur vis-à-vis des personnages que tu présentes.
Pierre-Yves Vandeweerd : Je ne veux pas montrer les gens dans leur singularité, ce qui m'intéresse, c'est de filmer les gens à partir d’un enjeu que nous arrivons à créer ou à développer ensemble. Mes films ne sont pas des portraits de gens dans leur singularité et encore moins dans leurs faiblesses !
C. : Le Cercle des noyés est un recueil de témoignages de prisonniers qu’on ne voit pas. Les seules personnes qui apparaissent à l’image sont des anciens bourreaux ou des femmes de militants.
P.-Y. V. : Pour ce projet, qui s’est développé sur près de 10 ans depuis le moment où j’ai rencontré pour la première fois les survivants de Oualata, nous avons entrepris ensemble un travail de mémoire avec l’envie de sauver leur histoire de l’oubli. Nous avons décidé que le film aurait la forme d’un texte avec ce qui doit absolument survivre de leur vécu.
C. : Quelle est la signification du « Cercle des noyés » ?
P.-Y. V. : « Le cercle des noyés » est le nom qui a été donné à ces intellectuels négro-africains mauritaniens envoyés, pendant plusieurs années, dans le fort de Oualata. Le « cercle des noyés » vient du terme peul « youldé », qui signifie « être perdu, noyé », mais avec une notion de sécheresse, noyé dans le sable d’une certaine manière. La Mauritanie est un pays à la fois composé d’une communauté arabo-berbère qui est au pouvoir depuis l’indépendance (les maures), et dans le sud du pays, le long du fleuve Sénégal vit une minorité négro-africaine composée de Peuls, de Wolofs et de Soninkés. Depuis l’indépendance, cette minorité opprimée n’a jamais eu le droit d'entrer dans les organes politiques du pays. Elle a vécu un processus d’acculturation, étant obligée de copier le mode de vie et la culture nomade des maures. Sa langue ne pouvant pas être enseignée dans les écoles, elle a subi un processus d’arabisation. Petit à petit, une conscience politique est née qui s’est d’abord manifestée fin des années 60 au travers d’un mouvement mené par des instituteurs et des professeurs, et puis, se sont créées, clandestinement, les Forces de Libération des Africains de Mauritanie (les FLAM), constituées d’intellectuels peuls. Leur seul acte politique fut la rédaction d’un document : « Le Manifeste du Négro-Mauritanien opprimé » dans lequel ils dénonçaient les injustices qu’ils subissaient. Ce document a circulé de manière clandestine à l’intérieur du pays, à l’extérieur aussi, lors des grandes réunions internationales où étaient présentes les autorités mauritaniennes. La réponse du dictateur mauritanien de l’époque a été sanglante : les militants ont été arrêtés, jugés de manière sommaire et envoyés dans le Fort de Oualata.
C. : Pourquoi toutes ces explications ne se trouvent-elles pas dans le film ?
P.-Y. V. : La plupart de mes films se sont faits sur le continent africain, mais je n’ai jamais eu l’impression de faire des films sur l’Afrique. Je ne fais pas de films explicatifs, didactiques ou informatifs qui décriraient une géostratégie ou un problème donné. Je ne suis pas Africain, je viens de Belgique et pourtant, j’ai l’impression que l’Afrique est le lieu à partir duquel je peux le plus facilement exprimer l’essentiel.
Dans mes films, je pars de l’idée que les questions que je pose sont les mêmes que celles qui animent mon quotidien en Belgique. Inévitablement, j’essaie, à partir de ce que je décris en Afrique, de faire le lien avec le reste du monde. Ce film est le récit d’anciens prisonniers politiques qui ont vécu un calvaire, une descente aux enfers en Mauritanie à un moment de l’Histoire de ce pays. Mais ce vécu renvoie à d’autres situations qui ont eu ou ont lieu dans le monde. Mon film, Closed District, n’était pas sur la guerre au Sud Soudan mais un film qui questionnait ma position de cinéaste à un moment donné : quand on est témoin de quelque chose qui nous échappe, qu’est-ce qu’on en fait ? Racines lointaines, cette recherche d’un arbre que je vois de ma fenêtre en Belgique, je le cherche en Mauritanie, mais j’aurais pu le chercher en Finlande, en Islande... L’arbre a cette dimension universelle qui permet à chacun, au-delà des différences culturelles, de se rencontrer et de partager ensemble un certain nombre de questionnements, d’enjeux, de réfléchir sur ce qui nous habite, ce qui nous est essentiel et ce qui est inéluctable, les questions de la vie, du sens de la vie, de la mort, du rapport à l’autre, de l’amour etc.
C. : Dans Racines lointaines justement, ce symbole spirituel qu’est l’arbre est prétexte pour montrer une Afrique démunie, assoiffée, desséchée, moribonde. Au contraire, dans Le Cercle des noyés, tu pars d’un événement historique pour prendre du recul et avoir une réflexion universelle.
P.-Y. V. : Dans Le Cercle des noyés, ma position est une position de passeur : j’ai été témoin d’une histoire qui m’a été racontée, elle m’a touché, bouleversé et j’ai eu envie à mon tour de la transmettre à d’autres. Dans Racines lointaines, on est dans un processus de transformation ; je pars avec un symbole qui me permet d’avancer dans ma quête, mais je ne sais pas où je vais, et tant les arbres que les gens que je rencontre me transforment, à un tel point, que de ce film ou de ce tournage je ne suis pas revenu. Je suis revenu physiquement, mais je ne suis plus le même. Et ça pour moi, c’est essentiel. Le cinéma du réel a cette capacité de transformer, non pas les choses mais les êtres. Bien entendu, les gens qu’on filme ne sortent jamais indemnes de cette expérience, surtout quand on a pu faire émerger ensemble des enjeux communs. Le cinéma, c’est aussi pouvoir provoquer quelque chose chez le spectateur, mais il y a aussi un processus de transformation du réalisateur. Avec Racines lointaines, plus j’avançais dans le film, plus je m’éveillais, et plus je me transformais et je me suis tellement transformé que celui qui revient n’est pas celui qui est parti.
C. : Dans Le Cercle des noyés, il y a une écriture, alors que pour Racines lointaines, on a l’impression que l’écriture se fait au fur et à mesure du tournage.
P.-Y. V. : C’est complètement l’inverse. Le tournage de Racines lointaines a été précédé par six mois de repérages, et j’ai dû écrire un scénario pour les demandes d’aides. J’y avais présenté les personnages de telle façon, qu’on aurait dit une fiction. Au tournage, même s’il s’est fait en équipe restreinte, on est resté lié à ce qui avait été écrit comme si lorsqu’on codifie de manière trop serrée un texte on a de la peine à s’en détacher. Par contre, pour Le Cercle des noyés, il y a un texte écrit, résultant de plusieurs années d’écoute de témoignages, un texte écrit à deux mains, du narrateur et moi. Mais le tournage en tant que tel est certainement le plus libre que j’ai fait parce que je suis à la caméra (avec un dispositif minimal, on tourne de manière clandestine) et je ne savais pas ce que j’allais rencontrer, je ne savais pas ce que je pouvais et devais filmer. Par contre, j’avais une idée très claire de la manière dont j’allais ou n’allais pas filmer. La voix-off avait été écrite en amont et j’étais habité par cette narration pendant le tournage, j’étais dans un état d’esprit proche de l’éveil. Je n’avais pas besoin de réfléchir au tournage. Sans cesse, je cherchais des éléments qui pouvaient faire sens dans ce film. Quand je filmais, le plan ou le cadre s’imposait de lui-même. J’étais porté par cette histoire. J’avais deux certitudes avant de commencer le tournage, le noir et blanc et des images de sable soulevé par le vent.
C. : Et souvent une image de nuit.
P.-Y. V. : Voilà, des images de nuit ou du moins, des images avec de forts contrastes, entre l’obscurité et la lumière, une lumière qui est presque saturée, on serait presque en surexposition pour définir cette idée de blessure. Pour filmer, je pars plusieurs mois, je reste le temps qu’il faut et je me laisse imprégner par ce que je rencontre. J’aime laisser une grande place à l’imprévu, à l’accident, même si l'imprévu a pour conséquence que ce que je filme peut ne jamais avoir été imaginé. On peut même accepter que le film terminé ne ressemble absolument pas au film mis sur papier ou projeté en amont. Closed District en est le meilleur exemple : le film qui a existé sept ans plus tard est à mille lieux du film imaginé. C’est ça qui est fascinant dans le cinéma du réel, c’est que le réel d’une part te transforme mais aussi a cette capacité de te faire quitter la route que tu avais empruntée pour aller vers une toute autre géographie, et donner lieu à un tout autre film.
C. : Pour ce tournage, Le Cercle des noyés, vous êtes partis à deux avec quel genre de caméra ?
P.-Y. V. : Je voulais tourner en noir et blanc. J’ai longtemps pensé à la pellicule, j’avais même trouvé des accords avec Kodak. Mais je savais surtout qu’on allait devoir tourner de manière clandestine. À ce moment-là, la HDV est sortie. Les tests que nous avons faits ont démontré que c’était probablement la caméra qui pourrait le plus facilement m’accompagner. On est parti avec ce matériel de manière extrêmement discrète, minimaliste. À peu de choses près, on se retrouvait avec un dispositif proche de certains touristes ! (rires)
C. : Ce n’est pas comme ça que tu as travaillé pour tes autres films ?
P.-Y. V. : Oui, sauf pour Racines lointaines où là, je ne filmais pas moi-même, il y avait un opérateur image, un assistant à l’image. On travaillait parfois autour des arbres avec des rails. Même si c’était une petite équipe, c’était un autre dispositif. Suite à ce tournage, j’ai eu envie de filmer à nouveau. Déléguer un geste, devoir expliquer au cameraman non pas ce qu’il doit faire mais ce que je ressens, cela me paraît tellement difficile, tellement compliqué dans le cinéma du réel. De plus, il est difficile d’amener des tierces personnes sur un tournage, après les repérages. Elles viennent s’immiscer dans quelque chose qui est toujours fragile, qui est souvent intime et essentiel pour la personne filmée et pour le cinéaste. Tout ça pour dire que Racines lointaines a révélé ça, la nécessité de revenir moi-même à la caméra en me disant que, finalement, ce qui fait sens dans une image, ce n’est pas la beauté intrinsèque de l’image, c’est de les faire de la manière la plus juste possible. Pour moi, la beauté d’une image ne vient pas de la lumière, du cadrage, elle vient de sa justesse, et si elle est juste, elle est belle. Qu’elle bouge dans tous les sens ou pas, peu importe.
C. : Le Cercle des noyés est prévu pour sortir en salle ?
P.-Y. V. : D’emblée, on l’avait imaginé pour le grand écran, pour les festivals et pour les salles. Actuellement, on se trouve devant ce choix : soit on fait un film pour la filière télévisuelle et inévitablement, si on veut être pris dans une commission télévisuelle, il faut se soumettre à un certain nombre de règles, soit on veut faire autre chose, quelque chose de plus libre et, à ce moment-là, on peut choisir une autre filière, un autre mode de vie pour le film. J’avais opté pour un film pour grand écran, avec une forme libre où on n’aurait de comptes à rendre à personnes, en tout cas, pas à des coproducteurs. C’est un peu comme ça qu’est en train de se développer la vie du film. Il a été sélectionné à Berlin, qui est une superbe caisse de résonance. Il sort en salle à partir du 2 mars en Belgique, au Flagey et dans différentes salles en province, et à partir du 11 avril en France.
Ce qui me paraît essentiel, c’est que ce film, tourné en Afrique, soit projeté là-bas au plus vite. Même si c’est un film sur une partie de l’Histoire passée de la Mauritanie, les questions politiques soulevées sont essentielles et constituent aujourd’hui un des grands enjeux de la politique mauritanienne, dans cette période qui précède les premières élections libres. Il va être montré en Mauritanie et au Sénégal avant la France. Racines lointaines, grâce à des Mauritaniens, a circulé dans l’ensemble du pays mais prioritairement dans les villages des personnes qui apparaissaient dans le film. C’était important qu’ils puissent le voir, qu’ils puissent se rendre compte vraiment à quoi ils avaient participé et de voir la place qu’ils occupent dans une narration beaucoup plus large. Cela me paraît essentiel, parce que les gens ne sont pas des acteurs, ce sont des personnes avec lesquelles j’ai une histoire qui existe parce qu’il y a le film. C’est important qu'on puisse faire ce bout de chemin ensemble et que les participants aillent jusqu'à la fin. La fin d'un film, ce n'est pas quand il sort du montage, c’est plutôt quand il commence à circuler.
C. : Comment se passe la diffusion des films en Afrique ?
P.-Y. V. : Très difficilement. Il y a quelques festivals du cinéma du réel, comme le FESPACO ou Quintessence à Ouidah au Bénin... Au-delà de ça, il n’y a pas grand-chose. J’ai toujours proposé gratuitement mes films à la télévision, mais comme la plupart des cinéastes qui ont tourné en Mauritanie, ce n’est pas pour autant que les télévisions les diffusent. Finalement, les gens découvrent ces films qui sont faits dans leur pays par le satellite, comme TV5. Ce n’est pas que leur télévision n’en veut pas, je crois que ce n'est simplement pas assez organisé pour que chaque film tourné dans le pays soit systématiquement diffusé dans un laps de temps relativement court. Je crois qu’il y a plein de choses qui sont en train de changer dans ces pays, surtout en Mauritanie depuis le coup d’Etat, il y a deux ans. La télévision est dans une nouvelle dynamique, et on remarque même l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes cinéastes africains. On se rend compte que le genre « documentaire » est un genre de plus en plus mis en partage en Afrique. C’est très bien, car c’est un genre cinématographique dans lequel le public se reconnaît.