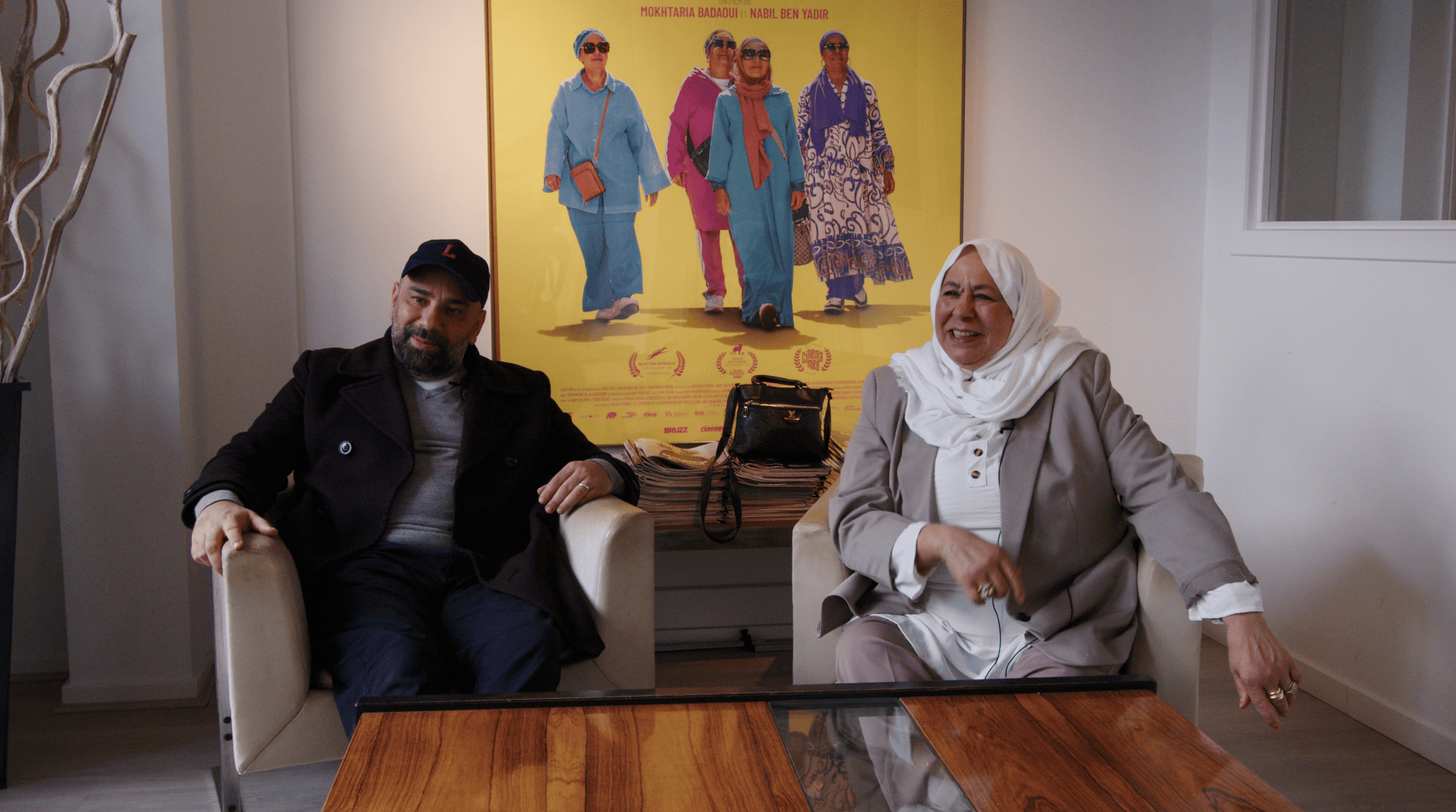La surprise de Frédéric Fonteyne
Aussi simple et sympathique qu'on le dit, Frédéric Fonteyne m'apporte un verre d'eau et me propose une cigarette. Acclamé à la Mostra 1999 de Venise où il offre à Nathalie Baye le prix d'interprétation féminine, Une liaison pornographique n'est jamais que son deuxième long métrage : aucune raison de se prendre la tête, ou quoi que ce soit d'autre. Un entretien purement cinématographique.