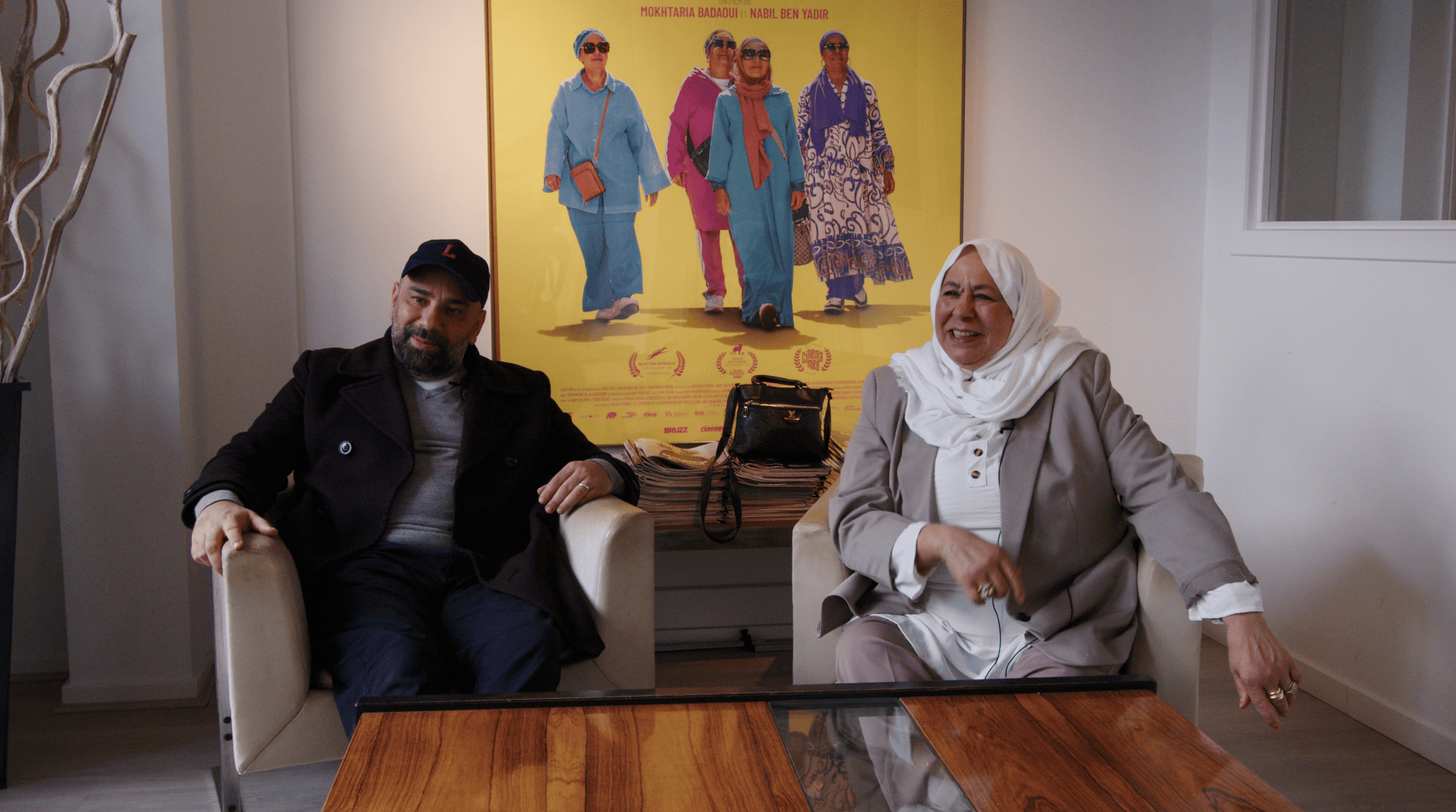Après son escapade marocaine qui lui a inspiré deux longs-métrages, Le Thé ou l'électricité et Où est l'amour dans la palmeraie ?, son grand bol d'air dans les Ardennes lors de son Grand'Tour, Jérôme Le Maire pose ses valises dans un hôpital panaméen pour son prochain documentaire : Burning out. Voilà le titre que le réalisateur belge a donné à son adaptation du livre de Pascal Chabot, Global Burn Out. Projet qui risque de faire parler de lui car aborder le sujet sensible du burn out dans un projet fictionnel passe encore, mais en faire l'objet d'un documentaire au sein d'une société hospitalière où sévit réellement ce syndrome d'épuisement professionnel qui guette notre XXIe siècle, c'est relativement audacieux.
Jérôme le Maire - Burning out
Cinergie : Après l'Atlas marocain, la forêt ardennaise, tu choisis un hôpital à Paris. Pourquoi ce changement d'intérêt ?
Jérôme Le Maire : Cela peut paraître très différent pourtant, cela parle de la même chose : de ce que la société est devenue. Le Thé ou l'électricité parle de la connexion d'une société isolée de notre monde globalisé. Ils sont touchés, ils vont rentrer dans notre sphère globale et quelques années plus tard, on se retrouve dans un hôpital et cette même société crée des maux et des pathologies du travail. Les médecins, les infirmières, les cadres ont des problèmes psychologiques ou physiques du travail: bur nout, risques psycho-sociaux, etc. C'est le même sujet, mais dans des endroits différents.
C. : Comment t'es venue l'idée de faire ce film ?
J. L. M. : L'idée vient d'un livre, Global Burn Out d'un philosophe belge qui s'appelle Pascal Chabot. Ce livre parle du burn out non comme une maladie individuelle, mais plutôt comme un trouble miroir de notre société. Arnauld de Battice, de AT-production qui produit ce film, m'a prêté l'épreuve du livre qui allait paraître il y a trois ans et quand j'ai lu ça je me suis dit que l'idée était intéressante. J'ai rencontré l'auteur, j'ai travaillé presque une année et demi avec lui en le suivant lors de ses conférences, en rencontrant les gens qu'il rencontrait pour écrire le livre. Je me suis plongé dans la constellation du burn out et je me suis retrouvé un jour à l'hôpital Saint Louis à Paris à une conférence de Pascal Chabot sur son livre : j'avais une porte d'entrée dans un endroit qui avait sollicité cette conférence et qui avait quelque chose à dire sur le sujet vraisemblablement. J'ai ensuite rencontré Marie Christine Becq, une anesthésiste de l'hôpital qui avait sollicité Pascal pour une intervention sous forme de conférence dans son service. Elle m'a fait visiter son service et j'ai trouvé cela magnifique, je me suis dit que c'était comme une salle de cinéma, il y a un éclairage, un acteur, un réalisateur. Au départ, je voulais entrer dans cet univers, essayer de comprendre quelles sont les règles, qui travaille là, comment, etc., et pourquoi ces gens ont fait appel à Pascal Chabot pour parler du burn out. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Pourquoi ces gens sont-ils fatigués, stressés, épuisés ? J'ai rencontré différentes personnes qui m'ont laissé les filmer. J'étais un peu de manière transversale avec les différents corps de métier (chirurgie esthétique, chirurgie urologie, chefs de service, chirurgiens, aides soignantes, infirmières, etc.). Je me suis inscrit dans ce collectif dont je voulais parler et j'ai remarqué qu'il n'y avait en fait plus de collectif. C'est ça que notre société est en train de détruire : tout n'est que finances, tout est comptabilité et il n'y a plus de lien entre les humains. Je voulais filmer un espoir, la reconstruction de quelque chose, un début d'action, me focaliser sur quelque chose de positif. Ce n'est que vers la fin du tournage (deux ans et demi avec le repérage) que j'ai vu l'espoir d'un changement, la reconstruction d'un lien comme la reconstruction d'un tissu de peau qui pourrait prendre mais ce n'est pas gagné. Le film ne terminera pas sur tout va bien parce que je trouve que les choses ne vont pas bien pour le moment. J'ai juste une envie d'espoir que les choses pourraient reprendre.
C. : Ce manque de collectif est dû, selon toi, à un rythme de travail effréné ou à une mauvaise organisation du travail ?
J.L.M. : J'ai l'impression qu'il y a une opposition entre finances et humains. C'est un hôpital public qui travaille avec la tarification de l'activité, ce qui veut dire que plus il y a d'actes, plus il y a de dotations. Donc, il faut travailler plus pour avoir plus d'argent, pour embaucher plus, pour avoir plus de matériel, etc. Au milieu de tout ce processus, j'ai l'impression que les gens ne s'y retrouvent pas nécessairement. Cela signifie qu'un chirurgien qui doit toujours faire du chiffre peut se poser la question : est-ce que je soigne mieux ? Il y a une concurrence entre les objectifs : les injonctions contradictoires, la perte du sens de son travail au travers d'un travail effréné, le manque de gratification, tous ces paramètres, avec trop de travail, concourent à des burn out ou des risques psychosociaux.
C. : Le fait de ne plus communiquer n'arrange rien.
J.L.M. : Ces gens communiquent, ils se parlent, etc. mais la communication est limitée. On sent bien dans le film qu'il y a une espèce de métro-boulot-dodo et les espaces communs ne sont presque plus habités. À l'époque, c'était comme une petite famille qui travaillait à l'instinct comme sur un bateau. Aujourd'hui, on voit que ce sont 15 salles d'opération où tout le monde est polyvalent, sauf les chirurgiens. Tout le monde passe d'une salle à l'autre et tout le monde est réglé par un programme informatique. C'est devenu une sorte d'usine où on sent la solitude des gens qui est très poignante et qui m'a interloqué. Je me suis senti seul et anonyme et la parole a commencé à circuler petit à petit. Je me suis dit que le cœur du film était le lien humain.
C. : Combien de temps as-tu eu besoin pour établir une relation de confiance avec le personnel du service pour qu'ils puissent te laisser les filmer dans leur travail, leurs questionnements, etc. ?
J.L.M. : Je fais toujours du cinéma de rencontres. Je veux surtout rencontrer les gens, pas spécialement les filmer. Je garde une trace pour créer une rencontre entre le spectateur et le film, c'est-à-dire les protagonistes finalement. Pour rencontrer quelqu'un, cela prend du temps. J'ai mis un an pour faire le tour du service, pour repérer où je pouvais aller, pour me présenter, je leur ai expliqué mon projet initial, je leur ai montré mes films, le livre de Pascal Chabot. De fil en aiguille, j'ai doucement abordé les problématiques du stress, du travail pathogène, de l'organisation du travail, de comment se sentent les gens. Au fur et à mesure, j'ai introduit un petit carnet, puis un appareil photo, puis un micro. Les gens s'habituent à ma présence, à mon questionnement, ils mûrissent un questionnement, des réponses, etc. Puis, ils s'habituent à ce que je les suive et l'arrivée de la caméra n'est pas un changement fondamental. Je l'ai amenée progressivement. Le film a duré deux ans, un an de repérage et à la fin je tutoie les gens, je les fais répéter, je leur pose des questions intimes.
C. : Comment as-tu procédé techniquement ? Avec un cameraman et un preneur de son ?
J.L.M. : J'ai vite choisi d'être tout seul. J'ai peut-être sous-estimé le fait que j'allais me retrouver seul au sein de ce bloc anonyme au milieu de cette souffrance avec beaucoup d'implications tant financières que politiques, avec de l'autorité, du pouvoir. On est dans la fosse aux loups. C'est un monde très violent. J'ai éprouvé cela physiquement et mentalement. Mais l'avantage c'est que c'était honnête, j'étais face à face avec ces gens. C'était un choix économique aussi car je suis allé dans cet hôpital trois fois par semaine pendant un an. L'idée était de chercher la bonne configuration.
C. : Qu'as-tu utilisé comme matériel ?
J.L.M. : J'avais un pied que j'utilisais lors des réunions sinon je porte ma handycam et j'avais un porte drapeau avec un monopod : comme je dois rester fixe, j'ai réussi à le faire avec ce dispositif. Je ne pouvais pas prendre de risque au milieu d'une salle d'opération. Pour le son, je mets un micro cravate de temps en temps ou je dépose un micro quelque part.
C. : Tu as dû te faire tout petit dans la salle d'opération ?
J.L.M. : Il ne faut pas gêner, mais je n'essayais pas de disparaître. Je suis devenu un personnage du film, un personnage du collectif avec lequel je vivais. Et je pense que je modifie l'endroit et les gens que je filme. Je sentais la modification et quelque part je la voulais car, comme ces chirurgiens, ces anesthésistes, je n'aime pas voir souffrir les gens. J'étais là-bas, j'ai éprouvé la souffrance avec eux et j'avais envie que quelque chose change. Quelque part, l'anesthésiste Marie-Christine Becq, qui m'a fait entrer dans cet hôpital, est devenue le personnage principal et on formait une sorte de tandem, de duo car on a la volonté de changer les choses.
C. : Pourquoi as-tu choisi un hôpital pour parler du problème du burn out?
J.L.M. : C'est un peu l'hôpital qui m'a choisi. J'ai rencontré des docteurs qui soignent le burn out, des docteurs qui ont eu des burn out. C'est une profession à risque et Marie-Christine Becq s'est présentée auprès de Pascal Chabot et je me suis retrouvé là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de hasard car quand j'étais petit, je voulais être chirurgien. Quand j'ai entendu parler de cas de burn out et de stress chronique dans cet hôpital, j'étais intéressé de visiter le bloc opératoire et c'était très impressionnant pour moi. Je me suis dit et « si j'étais à leur place ». Il y a eu un processus d'identification intéressant. Le fait d'être des leurs était fascinant pour moi. Chaque film est une étape dans la vie pour un réalisateur et là, pour moi, c'était intéressant de passer ce cap, d'entrer dans ce bloc pendant deux ans. Je me suis dit que finalement je faisais un métier qui me plaisait et que j'étais à la bonne place !
C.: Quels sont les parallèles qu'on peut faire entre ce qui se passe dans un bloc opératoire et sur un plateau de cinéma ?
J.L.M. : En tant que réalisateur, j'ai un rythme de travail tout à fait différent : un an de repérage, un an de tournage, un an de montage, un an d'écriture, je passe d'un film à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Je ne suis pas contraint. Je ne suis pas dans un collectif enfermé. Par contre, j'ai un même manque de gratification de mon travail. Lorsqu'on a cherché le financement et qu'on voit comment certaines chaînes de télévision nous demandent de formater nos produits, je me suis demandé si j'allais faire un beau film. Je voulais montrer qu'il y avait un problème de lien humain. Or, les films qu'on veut nous faire formater ne créent aucun lien entre ceux que je filme et moi et entre moi et le spectateur, il n'y a plus de lien. La télévision ce n'est plus du lien, c'est de la vente. Je me suis senti fatigué car j'étais non seulement en train de filmer ces gens fatigués à l'hôpital et d'autre part on nous demandait de formater mon film qui était en devenir. Le burn out ou les risques psychosociaux, c'est une maladie de société. C'est le reflet miroir de comment notre société se comporte avec l'homme. On est à un niveau d'évolution magnifique et on en arrive à oublier l'essentiel : le rapport humain. On a beau avoir un boulot valorisant, être chirurgien par exemple, on pleure le soir quand on rentre chez soi, on se sent seul. Ce n'est pas une vie.
C. : Avant de décider d'entrer dans l'hôpital, avais-tu fait d'autres repérages ?
J.L.M. : J'ai suivi une dame qui venait de faire un burn out pendant six mois. Elle travaillait dans une société pharmacologique. Je l'ai rencontrée un an après son arrêt de travail et elle commençait seulement à comprendre qu'elle avait fait un burn out. J'avais d'abord rencontré un médecin qui soigne cette pathologie et il m'avait fait rencontrer cette dame. J'allais chez elle une fois par semaine et je pensais la suivre avec la caméra. Je voulais qu'elle me raconte comment elle avait fait son burn out et comment elle s'en sortait. J'ai aussi rencontré le docteur Mesters qui a créé l'Institut Européen d'Intervention et de Recherche sur le burn out à Bruxelles. Il m'a permis de le suivre dans son travail. Il est psychiatre et reçoit des gens en souffrance en entretiens individuels. Il aide aussi les sociétés à "déburnouter" leurs locaux. C'est le ghostbuster de cette pathologie. Il m'a fait comprendre que la systémique était une approche intéressante. J'allais souvent chez lui en rentrant de Paris pour lui expliquer où j'en étais et pour qu'il me fasse son expertise de professionnel. J'étais aussi très intéressé de le filmer sur le terrain, mais cela prend des années pour entrer dans une société qui souffre de burn out, c'est comme une maladie honteuse et ils ne veulent pas qu'un médecin entre et encore moins une caméra. Finalement, j'ai fait ce travail de mon côté, je suis entré dans une société, l'hôpital.
C. : C'est compliqué de sortir d'un système qui crée du burn out chez ses employés ?
J.L.M. : C'est un système qui fonctionne avec des codes, des rôles. Pour changer un système qui lui même a dérivé, s'est fragilisé depuis des années, il faut lui faire faire un circuit. Je ne suis pas un spécialiste d cette maladie, c'est vraiment complexe et cela prend du temps. L'hôpital a fait des tentatives, il y a vraiment une volonté de s'en sortir et le fait d'accepter de faire un film sur le sujet montre qu'ils ont une certaine lucidité. Ils sont d'accord de mettre l'accent sur le problème. Il y a encore du travail et il était temps de s'y mettre pour éviter le pire.
C. : J'imagine que ce film va provoquer la discussion.
J.L.M. : Je sais que c'est un sujet brûlant, mais c'est ma contribution. Je considère que je dois accompagner le film en salle, je dois écouter comment il est reçu et ce qu'il peut faire, cela m'aide pour le suivant.