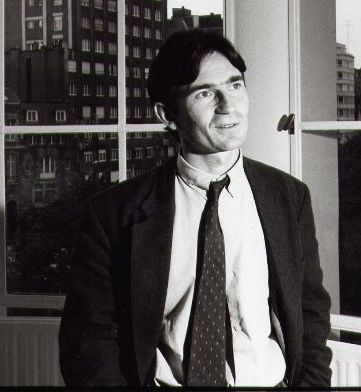Essayiste, romancier, scénariste des Cités obscures, Benoît Peeters a exploré plus d'une fois le script de cinéma tant pour le film d'animation que pour le court métrage. Une démarche " transmédiatique ", pour reprendre une expression de l'auteur, qui prône l'impureté des genres et refuse la séparation entre le scénario et la réalisation.
Benoît Peeters

Cinergie : Comment vous définiriez-vous en tant que scénariste de cinéma?
Benoît Peeters : D'abord quand on dit cinéma, on pense souvent long métrage de fiction. Or, un scénariste n'est pas exclusivement voué au long métrage de fiction. Il y a évidemment le court métrage, l'animation, mais aussi la télévision, la vidéo ou le documentaire. Dans mon cas, il y a des expériences qui sont autant de passerelles entre les genres. Je pense au Dossier B., documentaire-fiction co-écrit avec François Schuiten et réalisé par Wilbur Leguebe.
Par ailleurs, je suis intéressé par le plus grand nombre d'étapes possible dans le processus de création. Il y a des gens qui sont des scénaristes au sens strict du terme. Le fait d'avoir moi-même réalisé et travaillé tant pour le roman-photo que pour la bande dessinée m'a amené à ne pas séparer conception et réalisation, à être assez interventioniste.
J'ai peut être l'idée que le scénario ne s'arrête pas au moment où l'on donne une dernière lecture sur un papier soi-disant prêt à tourner, mais que l'on peut intervenir pendant le tournage, pendant le montage, voire le mixage.
Le scénariste est une machine à prévoir et le scénario, une sorte d'anticipation d'une oeuvre future. C'est une définition sans doute très large mais je pense que celui qui conçoit un site sur Internet fait un travail de scénario, même s'il est non-narratif.
C. : Comment vous situez-vous dans l'écriture cinématographique, qui renvoie généralement dos à dos scénariste et auteur?
B. P. : Il y a effectivement l'ancienne école qui considère le scénario comme un objet très écrit où la description et surtout les dialogues sont des éléments clé relativement intouchables. C'est le cas des scénarios de Prévert, d'Aurenche et Bost. Et puis il y a le scénario du deuxième type, lié à la Nouvelle Vague, où le scénario est à la limite un prétexte. Ce qui compte alors c'est l'écriture filmique, avec l'idée sous-jacente que le réalisateur est nécessairement scénariste. Depuis une période récente, on assiste à une revalorisation du rôle du scénariste mais sous un mode différent. Pour moi, l'idée d'être un pur dialoguiste, comme Audiard a pu l'être, est une conception extrêmement lointaine de la mienne.
Sans être trop spielbergien, je me vois comme un scénariste du troisième type : un scénariste très intéressé par la matière filmique sans pour autant l'assumer totalement dans sa concrétude. J'aime jouer le rôle de partenaire dans un ping-pong avec le réalisateur. C'est ce qui se passe tout le temps en bande dessinée. D'un côté, je peux m'avancer assez loin dans la pré-visualisation, proposer des suggestions très précises de cadrage mais d'un autre côté, le dessinateur peut aller très loin dans ses envies narratives. C'est un double mouvement où le scénariste s'implique davantage dans le dessin et le dessinateur dans le scénario. Mais ce n'est pas toujours possible dans l'audiovisuel.
C. : Pourquoi?
B.P. : Les mécaniques sont parfois plus rigides, plus hiérarchisées, et le poids de l'argent fait qu'à un moment donné le scénario passe par des phases techniques de dépouillement, de plan de travail, de budget qui font qu'on a vite l'impression que ce qui est écrit devient une bible. Et chaque fois qu'on en arrive là, j'ai le sentiment que l'on perd quelque chose.
C. : Dans votre ouvrage L'Aventure des images, vous faites un constat plutôt amer sur l'apport scénaristique de Frank Daniel à Taxandria.
B.P. : Frank Daniel avait l'avantage d'être issu d'une culture européenne, puisqu'il avait longtemps travaillé à Prague, et d'avoir une vision dramaturgique assez large, empruntant tant au théâtre ancien qu'à des formes contemporaines. En revanche, par certains côtés, il ne croyait pas au cinéma qu'il qualifiait de "poor dump media". Il avait cette idée que le cinéma est pauvre et limité et ne permet pas d'atteindre le même niveau d'exigence artistique que le théâtre; croyance que je ne partage absolument pas. C'est quelqu'un qui avait tendance à penser que si la structure scénaristique et les dialogues étaient bons, le "reste" suivrait. En d'autres termes, que la mise en scène était accessoire et la visualisation, un élément tardif. Or, ce qu'il y avait de fascinant dans le dispositif de Taxandria, c'était la quête de l'image réelle et animée imaginée par Servais dans un univers fortement inspiré par le surréalisme belge. L'image devenait le moteur même du récit, ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester dans une sotte fascination et visiter le film comme un musée.
C. : On pense évidemment au scénario américain très structuré qui a fait beaucoup d'émules...
B.P. : Ce qui m'effraie parfois dans le scénario américain, c'est l'idée de recette. Que certains techniciens du scénario aient mis au point des formules relativement efficaces pour réaliser des produits normés, répondant aux attentes d'un large public, tout le monde en convient. Mais que ce soit la panacée universelle, cela m'affole. Ce qui m'effraie aussi, c'est la notion de "script doctoring", de docteur ou de gourou en scénario, rôle que Frank Daniel a par ailleurs joué à une époque dans le cinéma belge. Je crois à la technique. Elle est importante dans la mesure où l'on sait que la courbe dramatique va être différente selon que le film dure dix ou cinquante-deux minutes. Mais à partir du moment où une technique commence à se détacher d'un contenu, d'un propos, voire d'un projet artistique, c'est à mon sens un applatissement et une normalisation. Suivre des formations en pensant qu'en ayant maîtrisé les constructions en trois actes, les plot points, la construction des personnages, on a tout compris des mécanismes scénaristiques et cinématographiques est un leurre grossier, hélas très répandu. Bien sûr, très souvent, à la fin du premier quart d'heure il y a un tournant fort mais il y a des milliers d'oeuvres qui fonctionnent ainsi sans avoir été construites à partir d'un schéma. La technique qui veut nous faire croire que les contenus vont miraculeusement venir dans un deuxième temps, je n'y crois pas. Écrire c'est d'abord apporter un regard.
C. : Quel que soit le sujet abordé?
B.P. : J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de scénarios pour la Commission du film, qui donnent le sentiment d'utiliser la référence au monde uniquement comme un assaisonnement. On met un chômeur, un SDF, un informaticien, ... mais sans aucune " vérité ", avec une sorte d'irrespect de la complexité du monde et de l'intérêt documentaire. Je ne plaide pas pour un cinéma forcément social mais il est clair que dans La Promesse, c'est le sentiment de justesse qui domine. On sent qu'il y a une proximité des auteurs avec le milieu qu'ils ont décrit. A une toute autre échelle, nous avons passé beaucoup de temps, François Schuitten et moi, dans ce qu'on pourrait appeler l'univers des Cités obscures.
Ce qui me fait peur parfois dans le regard technique, c'est l'idée que tout s'arrête aux bornes exactes de l'oeuvre. Il n'y a rien au-delà du cadre, il n'y a plus de hors-champ, de hors-scénario, plus d'arrière-plan du récit ni des personnages. Rien ne dépasse pour la réflexion et le sens.
C. : Vous défendez l'impureté des genres, l'apport réciproque des diciplines. Celui du story-board, donc du dessin dans le découpage, a connu diverses fortunes...
B.P. : Le story-board peut apporter beaucoup mais peut aussi devenir un carcan si on le sacralise. Il n'est pas une garantie de visualité. Par contre, il peut être utile localement et ponctuellement, pour les scènes d'effets spéciaux, par exemple.
Je pense que le domaine du scénario a l'avantage actuellement de courir au travers de médias très divers. Évidemment, si l'on passe du multimédia au long métrage, il y a des spécificités, des ressorts qui diffèrent. Prenons le cas de Winsor McCay. Au début des années 10, il passe de la bande dessinée au dessin animé et doit bien entendu acquérir tout un nouveau bagage technique. Quand Méliès passe de l'illusion sur scène à l'illusion cinématographique, il reprend des éléments et en invente de nouveaux. Le scénariste est en prise sur deux dimensions, l'une qui concerne le concept, une structure, presque une certaine abstraction qui lui permet de ne pas se perdre dans les détails et en même temps une confrontation à une matérialité qui est différente s'il s'agit d'une oeuvre photographique, télévisuelle ou autre. Quant au multimédia, on assiste pour le moment à une certaine euphorie technologique mais, à un moment, la technique peut devenir un vertige en soi. Le rôle du scénariste à mon sens est d'introduire une relativisation des effets.
C. : Vous aviez un projet de scénario avec Raul Ruiz, Le pari Lumière-Méliès.
B.P. : C'est une histoire qui se passait à la veille de l'Exposition universelle de Paris en 1900 où Méliès et Lumière faisaient le pari de réaliser chacun un tour du monde cinématographique, le premier en recréant le monde dans son studio de Montreuil, le second en voyageant autour du monde. Les deux personnages avaient évidemment des problèmes symétriques. Lumière traversait le monde sur des paquebots et désespérait de rencontrer l'événement, ce qui l'amenait à filmer de l'illusion. Méliès, à l'inverse, reconstituait des lieux à grands frais alors que des délégations du monde entier affluaient. Il y avait donc de vrais Chinois, de vrais Africains mais sa religion du faux lui interdisait de les filmer. C'est un sujet que j'aimais bien parce que la technique, le vrai et le faux devenaient des composantes directes du récit.
C.: Votre travail nous fait penser que vous préférez plutôt Méliès.
B.P. : Ce n'est pas si simple. Je crois vraiment que le cinéma est perpétuellement sur la corde raide. Vous savez, La Promesse m'intéresse davantage que pas mal de pseudo-mélièseries comtemporaines. Les plus grands cinéastes tiennent vraiment des deux dimensions. Est-ce que Welles est un réaliste ou un illusioniste? Et il y a du Lumière chez Tarkovski.
Renaud Callebaut