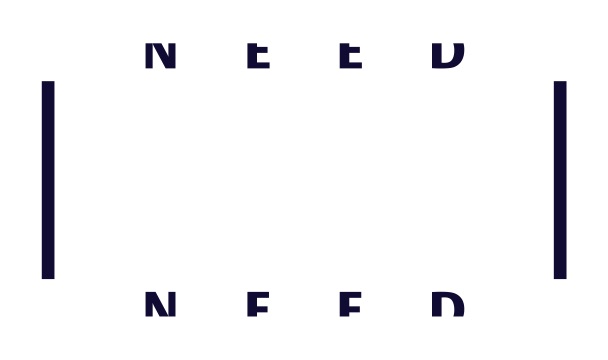Cinergie : Pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé, le moment où vous avez décidé de prendre la caméra pour filmer votre mère ?
Caroline Guimbal : Les tout débuts remontent à une dizaine d’années. J’ai commencé à filmer ma mère alors qu’elle traversait une période où elle s’enfonçait dans la précarité et la solitude. Cette situation réveillait en moi une question qui me hantait depuis l’enfance : pourquoi, malgré sa force évidente, ma mère ne parvenait-elle pas à s’en sortir ? Pourquoi revenaient sans cesse dans sa vie la violence et la souffrance ?
C. : Et puis, un événement a tout accéléré.
C. G. : Oui. Quelques années plus tard, on a appris qu’elle avait un cancer incurable. Elle n’avait que 53 ans. Là, l’urgence de faire un film s’est imposée, accompagnée d’un sentiment de profonde injustice : elle allait partir trop tôt, alors qu’on n’avait pas tout compris du passé, ni du sien, ni du notre. Il y avait encore tant de confusion. J’ai appris au même moment que j’étais enceinte. La naissance et la préparation à la mort se sont retrouvées intimement liées. J’ai su que je filmerai ma mère jusqu’au bout, mais aussi que je partirai à la recherche de ce que je nommais, enfant, sa « magie ».
C. : La caméra, pour vous, était-elle une façon de la « sauver » ?
C. G. : Au départ, je cherchais à résoudre ce nœud, mon incompréhension face à ce cycle de violence. Puis la caméra a agi comme une médiatrice, créant un espace privilégié d’écoute, de soin et de douceur. Elle m’a permise d’accéder à l’univers de ma mère, de le rendre sensible. Et enfin ce film est aussi le portrait de notre relation.
C. : Filmer votre mère a-t-il changé votre relation ?
C. G. : Son passé s’est révélée à moi sous l’angle de la domination patriarcale. En la filmant et en racontant son histoire, je lui ait offert la reconnaissance qu’elle n’a jamais eue. J’ai pu aussi lui dire : « Tu as fait tout ce que tu as pu, et ce n’était pas de ta faute ». Alors que je posais un regard plus politique sur sa vie et elle, elle m’a offert sa poésie, sa vision métaphysique. On s’est inspirées l’une l’autre.
C. : Une forme de résilience, donc ?
C. G. : Elle a crié dans le vide toute sa vie, la police, les institutions et son entourage fermaient les yeux. Comment guérir, comprendre, quand personne ne vous reconnaît ? La résilience est presque impossible sans reconnaissance.
C. : Pouvez-vous nous parler des épreuves traversées par votre mère, et de la façon dont le film les retrace ?
C. G. : Le film retrace à la fois les systèmes de domination que ma mère a subis — dans ses couples, au travail, avec l'administration— et les actes de résistance dont elle a fait preuve, elle n’est jamais restée passive. Mais à chaque fois qu’elle réussissait à se réinventer, à s’émanciper, elle se heurtait de nouveau à la violence. Elle a accumulé les traumatismes jusqu’à ne plus pouvoir rebondir.
On revisite le passé mais le film est ancré dans le présent, à mesure que la maladie avance, ma mère avance aussi vers une forme de libération, de guérison intérieure.
C.: Pourquoi était-il si important pour vous de faire ce film ?
C. G. : Ma mère a une histoire inspirante : celle d’une femme qui à l’aube de sa mort a réussi à guérir de ses souffrances. C’est un message fort : l’émancipation est possible, même jusqu’au tout dernier instant. La préparation à la mort devient une expérience de vie, de naissance et de transmission.
C. : Quand vous filmez votre mère, comment a-t-elle vécu ce rapport à la caméra ? Était-elle d’accord, souhaitait-elle partager ?
C. G. : Tout s’est fait de manière très intuitive. Ma mère avait besoin que ce qu’elle a traversé soit reconnu mais elle ne voulait pas se plaindre, elle avait envie de partager ce qu’elle avait de plus beau : son rapport poétique au monde, son émerveillement, son amour. Elle écrivait des poèmes, faisait de la photographie, et la nature était pour elle un refuge, un espace de résistance. Filmer ensemble est devenu un moyen d’échanger et de créer. Elle guidé mon regard.
C. : Comment s’est passé le montage, avec toutes ces images et cette voix off ?
C. G. : J’ai revisité les rushes un an après sa mort. J’ai commencé le montage toute seule, de manière intuitive, presque en association libre, dans une forme qui allait, je le sentais dès le départ, vers une forme poétique. Je suis aussi retournée dans les lieux qui ont marqué nos vies, pour filmer ces paysages de nature qui étaient pour elle mais aussi pour nous des espaces de refuge, de liberté et de poésie. La nature, très présente dans le film, symbolise les cycles de vie, de mort, de renaissance. Elle est à l’image de sa vie, avec ses tempêtes mais aussi ses surgissements presque magiques. La voix et le montage image n’ont cessé d’être travaillés en parallèle, l’un influençant l’autre, et ce jusqu’à la version finale. Le film est construit comme un poème, il lui ressemble.
C. : Combien de temps a duré la création du film ?
C. G. : L’idée a germé il y a dix ans, mais le tournage s’est intensifié à l’annonce de son cancer. A partir de là, ça a pris 5 ans au total.
C. : Avez-vous travaillé seule sur ce film ?
C. G. : Au début, oui, par nécessité mais également aussi car le geste de départ était instinctif. Puis j’ai replongé dans les rushes et le film s’est construit. Quand j’ai rencontré ma productrice Anne-Laure Guégan, j’avais déjà une version très solide du film. Nous avons grâce à cela obtenu des soutiens financiers pour terminer le film et m’entourer de Cécile Mavet pour l’écriture de la voix off, Lydie Wisshaupt-Claudel et Thomas Schira pour le montage et Mim pour le montage son. Leur regard a été précieux.
C. : En tant que cheffe opératrice, vous avez travaillé sur des films très intimes, où la rencontre et l’attention aux personnes sont centrales. Est-ce un choix délibéré ?
C. G. : J’ai vraiment aimé mon métier à partir du moment où j’ai compris que la caméra permettait de porter une attention privilégiée aux personnes filmées, de donner à ressentir ce qu’elles vivent. C’est pour cela que je suis attirée par les films intimes.
C. : Votre premier film, Il fait nuit dehors, co-réalisé avec Léa Tonnerre, explore aussi cette idée de résistance et de création malgré les difficultés. Y a-t-il un fil conducteur avec L’Éclipse de la lune rouge ?
C. G. : Oui, il y a un point commun : montrer comment, malgré les systèmes de domination, les personnes arrivent à trouver des contre-pouvoirs, à résister et à créer des espaces de beauté et de liberté. Ces espaces, personne ne peut les leur enlever.
C. : Votre parcours de cheffe op a-t-il préparé le terrain pour L’Éclipse de la lune rouge ?
C. G. : Absolument. Tout ce que j’avais appris avant m’a permis de poser ce regard attentif et reconnaissant sur ma mère. J’avais déjà posé ce regard sur d’autres personnes, dans d’autres films. Avec elle, c’était une urgence : comprendre sa souffrance, briser le cycle de la violence, et choisir ce qu’on transmet.