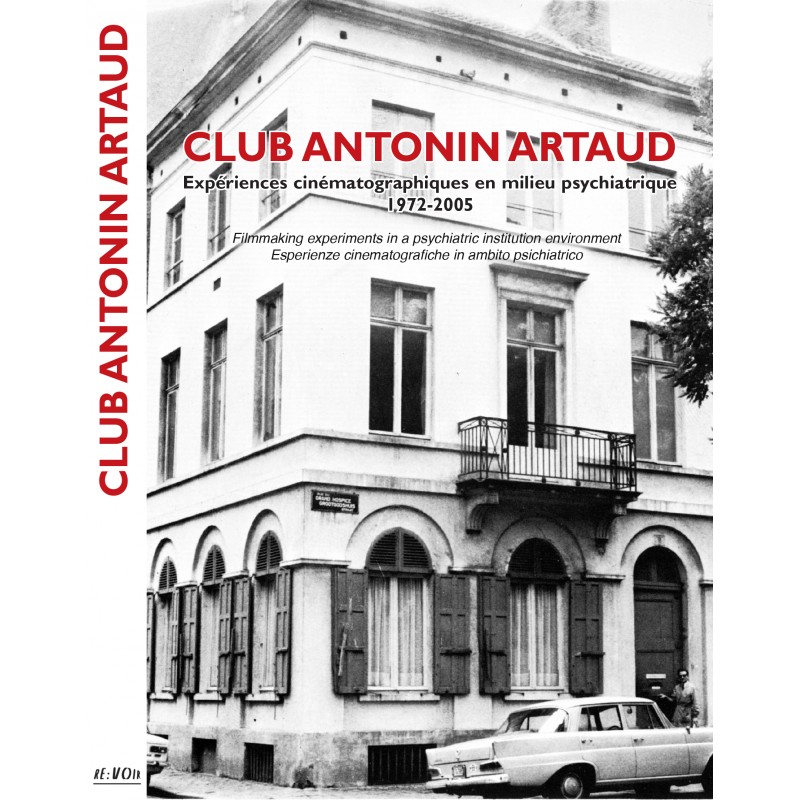DVDphiles : Collection Truffaut partie 2, la saga Doinel et deux polars
.jpg)
Des dizaines et des dizaines de livres lui sont consacrés, les plus grands le citent comme référence. Avec les années, et particulièrement en 2004, pour les vingt ans de sa mort, François Truffaut semble être devenu la référence ultime du cinéma français, à tel point qu’on soupçonnerait bien certains d’en parler sans vraiment le connaître. Bien entendu, pour le néophyte, il n’est pas pire repoussoir que cette publicité bien loin de l’idée d’un cinéma populaire et de qualité qu’incarnait le cinéaste parisien. Et pourtant, si on nous bassine tant avec Truffaut, il doit bien y avoir une raison. Et une bonne, une excellente. Et bien, après l’édition événement des films du cinéaste par mk2 en 2002, tout le monde va pouvoir en juger sur pièce grâce à la réédition d’une grande partie de son catalogue en deux coffrets économiques dans la collection CineFiles Classique que Cinéart a lancé dans notre plat pays. Et ceux qui découvriront le maître à cette occasion ne seront pas déçus.
Les titres rassemblés dans le deuxième coffret qui vient de paraître permettent de mettre en évidence une dichotomie essentielle dans la prolifique carrière de Truffaut. Celle qui le pousse à la fois à s’illustrer dans un cinéma « d’auteur », héritier de la Nouvelle Vague - dont il fut bien sûr, un des fers de lance et qui consacre une certaine tradition française -, et un cinéma plus directement inspiré de « l’entertainement » américain. Et sans que ces tendances soient liées à une période de sa vie puisque Tirez sur le Pianiste et Vivement Dimanche, tous deux tirés de polars sans envergure particulière, sont respectivement le deuxième et le dernier film de François Truffaut. Si je cite ces deux films, c’est qu’on les retrouve dans le coffret qui nous intéresse, associés aux quatre longs métrages de la saga des « Aventures d’Antoine Doinel », dont le premier volet n’est autre que le célébrissime Les 400 Coups, sensation du Festival de Cannes 1959 (bien qu’il n’y obtint pas la Palme d’Or, mais celle de la mise en scène) et film fondateur de la Nouvelle Vague avec Hiroshima mon Amour d’Alain Resnais (59) et A Bout de Souffle de Jean-Luc Godard (60).
Doinel à travers les années
En 59, donc, Truffaut se trouve piégé. Avec son premier long qui n’est que son deuxième effort comme réalisateur (le réjouissant court métrage Les Misions où les bases des 400 Coups sont posées, est visible dans les bonus du coffret), il se retrouve projeté sous les feux de la rampe. Le film est un succès commercial et d’opinion, alors que l’année précédente seulement, Truffaut était encore un critique qui, dans les Cahiers du Cinéma ou Arts, s’attaquait violemment au cinéma français post-Renoir et à l’establishment (y compris le festival de Cannes qu’il boycotte en 58) dont il fait désormais partie.
L’année suivante, Jean-Luc Godard se retrouve dans une situation similaire avec son film coup-de-poing A bout de souffle (sur une histoire de Truffaut). Avec un film qui tient plutôt du manifeste et dont la structure et le filmage éclatés et volontairement iconoclastes (malgré la prégnance du film noir hollywoodien) ne pouvaient être, et ne seront pas reproduits, Godard ne parvint pas à se dépêtrer de sa reconnaissance soudaine, sombrant lentement mais sûrement dans un cinéma égocentré et hermétique. Cette rupture avec le public s’accompagne d’ailleurs d’une houleuse rupture de sa relation d’amitié avec François Truffaut.
Pour Truffaut, la clef du salut sera la diversité. Il refuse de faire « Les 401 Coups » et son deuxième film, Tirez sur le Pianiste , est un polar teinté de comique avec Charles Aznavour (et une apparition-karaoké mémorable de Bobby Lapointe, alors débutant) adapté d’un roman de David Goodis. Rétrospectivement, mais sans que la traçabilité de ce que j’avance soit très sûre, on peut voir, dans les dialogues automobiles interminables, les accès de violence et la structure en flash-back du film, un genre de précurseur de Pulp Fiction. Quoi qu’il en soit, et bien que la gouaille et Paris soient toujours de la partie, on est effectivement bien loin du film attendu et le résultat est… un échec commercial cuisant ! Qu’importe. Pour Truffaut, « un succès est bien plus difficile à gérer qu’un échec » et sa carrière, forte de 22 films, sera une succession de succès et d’échecs, commerciaux s’entend car artistiquement (à l’exception notable du surréaliste Une Belle Fille comme Moi en 1972) il reste irréprochable, et nombre de films mésestimés à leur sortie sont admirés aujourd’hui. Un phénomène que Truffaut cherche lui-même à provoquer en ressortant en 1984 Les Deux Anglaises et le Continent (1971), dans un des rares « director’s cut » du cinéma français.
Sur le tournage de Tirez sur le Pianiste
Il continue de passer d’un genre à l’autre et parvient à faire succéder aux 400 Coups, des chefs-d’œuvre reconnus de tous, tels que Jules et Jim (1962), L’Enfant Sauvage (1970), La Nuit Américaine (1973) ou Le Dernier Métro (1980-10 Césars). Bien qu’au fil des ans Truffaut perde indéniablement ses qualités d’agitateur pour devenir un réalisateur un brin institutionnalisé et à la patte immédiatement (trop ?) reconnaissable, il faut souligner qu’il poursuit une quête d’expérimentation. Dans Antoine et Colette (court métrage extrait du film à sketches L’Amour à 20 ans de 1962), il accepte de retrouver Antoine Doinel, le héros des 400 Coups, et celui qui deviendra son acteur fétiche, Jean-Pierre Léaud, âgé seulement de 18 ans. Le récit du film est fait à la première personne et sans aucune distance. Truffaut utilise des caches pour créer des cadres dans le cadre, et accorde au son un traitement particulièrement soigné et original (Antoine presse des disques chez Philips et est membre des jeunesses musicales). S’étant attaché autant à Léaud qu’à ce personnage hybride qui synthétise leurs deux personnalités, Truffaut fait rencontrer à Doinel la femme de sa vie (la rayonnante Claude Jade, qui manque d’épouser le cinéaste) dans Baisers Volés (1968).
Tourné dans la tourmente de « l’affaire Langlois », véritable prémisse aux événements de Mai 68 (André Malraux voulait déloger le fondateur et directeur de la cinémathèque française – événements évoqués par Bertolucci dans The Dreamers en 2003), le film surprend par sa nostalgie, et est d’une vitalité, d’une spontanéité et d’un humour rares qui en font un vrai chef-d’œuvre. Tiré d’affaire grâce à son comité de soutien très « people », c’est Langlois qui pousse Truffaut à faire se marier Antoine/Léaud et Christine/Claude Jade dans Domicile Conjugal (1970). Ce film comprend la célèbre scène du lit où Christine flirte par procuration en lisant une biographie de Noureev alors qu’Antoine s’instruit sur Les Femmes Japonaises pour séduire sa maîtresse, une scène à laquelle feront écho les Scènes de la Vie Conjugale de Bergman en 1973.
Neuf ans plus tard, et après une série de films plus lourds comme le splendide et toujours inédit en DVD La Chambre Verte, c’est sous la pression du public et sa volonté peu claire d’en finir avec Doinel et Léaud qu’il signe L’Amour en Fuite, un film qui se veut être une comédie mais reste désespéré et que Truffaut regretta avant même de l’avoir achevé. Et pourtant, il y expérimente un procédé timidement amorcé dans Antoine et Colette. Antoine voit littéralement défiler sa vie devant ses yeux quand le destin l’amène à retrouver son premier amour alors même que Christine et lui signent le premier divorce par consentement mutuel et qu’il sort avec une disquaire bien plus jeune que lui, interprétée par Dorothée (oui, celle de la télé, mais avant TF1 !). L’originalité étant que les nombreux flash-back, un, participent peu ou prou de la narration, deux, sont constitués d’extraits des autres films de la saga Doinel, indistinctement mélangés à des scènes tournées pour l’occasion et à des scènes détournées de La Nuit Américaine, interprétées en 1973 par Léaud. Un procédé qui, même s’il rend le film un peu bancal, reste passionnant et ludique et participe au charme d’une œuvre sous-estimée, rehaussée d’une chanson originale d’Alain Souchon, connexion artistique on ne peut plus sensée.
L’Amour en Fuite 1979
S’il y a clairement une rupture entre Les 400 Coups, récit de l’enfance malheureuse proche du néo-réalisme et largement autobiographique, et les autres films de la saga Doinel, comédies amoureuses parfois amères, que dire de Fahrenheit 451 ?! Avec le succès de Jules et Jim en 1962, Truffaut devient un cinéaste mondial et s’intègre particulièrement bien dans les milieux américains. Inutile sans doute de rappeler qu’il signera en 1967 un livre d’entretiens désormais incontournable, le Hitchock-Truffaut. Aux USA, Easy Rider a sonné le glas du cinéma de studio de la même façon que la Nouvelle Vague, en France. D’ailleurs, on appelle ces jeunes réalisateurs frondeurs et ambitieux qui, à terme, vont redéfinir le marché (on parle de Friedkin, Bogdanovitch, Lucas, Coppola, Spielberg, Scorsese…), le Nouvel Hollywood. Truffaut est fortement pressenti pour mettre en scène Bonnie and Clyde, mais, finalement, il ne tournera jamais aux USA. Par contre, il va se lancer dans une longue collaboration avec United Artists qui produira dès lors une grande partie de ses films, indéniablement français par ailleurs (40 ans avant la polémique stérile autour de Jean-Pierre Jeunet et son pacte avec la Warner).
C’est que Truffaut a un projet ambitieux en tête. Il veut adapter un roman de science-fiction (lui qui ne montre, d’ailleurs que peu d’intérêt pour ce genre) de Ray Bradbury (l’auteur des Chroniques Martiennes). Il rencontre l’auteur qui se montre enthousiaste mais le projet tarde à se concrétiser. Dans l’intervalle, il tourne La Peau Douce , sans doute son film le plus abouti grammaticalement de par la superbe photo noir et blanc de Raoul Coutard et le rôle culte de Françoise Dorléac. C’est finalement en Angleterre que se monte Fahrenheit 451. D’emblée, Truffaut surgit avec une idée superbe, mais qui va lui mettre les producteurs à dos :confier le double rôle de la femme et de la maîtresse du héros à Julie Christie. Le héros, pompier d’un genre particulier puisqu’il est chargé de brûler les livres, est incarné par Oscar Werner, l’interprète de Jules et Jim dont l’ego va le brouiller à mort avec Truffaut. Ajoutez à cela la langue anglaise, que Truffaut ne parviendra jamais à maîtriser, et vous comprenez qu’il garde un mauvais souvenir du tournage. La qualité du film, par contre, est réelle. Planté dans l’austérité du béton et des plaines, avare en effets spéciaux (et heureusement car ils ont très mal vieillis), le film (assez éloigné du livre) reste isolé dans l’histoire de la SF, choque, intrigue, et finalement séduit. Quand on sait que Frank Darabont (La ligne Verte, Les Evadés ), prépare une nouvelle adaptation, on se dit que, malgré tout son talent et la technologie numérique, il aura du mal à égaler la poésie et la densité de l’unique film anglophone de Truffaut.
Truffaut, qui préférait toujours suggérer la violence, ose le chaos dans Fahrenheit 451.
Si Truffaut ne tourne plus à l’étranger, le lien qui le lie au cinéma américain est réel. Nous avons vu que le Nouvel Hollywood s’inspira de la Nouvelle Vague, tout comme celle-ci lorgnait sur le Néo-Réalisme et les maîtres américano-britanniques comme Chaplin ou Hitchcock. Hé bien, en 1977, un jeune cinéaste, dont l’univers est a priori à mille lieues, et qui vient de créer le block-buster avec Jaws, vient chercher Truffaut pour faire l’acteur dans son film de science-fiction (encore !), Close Encounters of the Third Kind. Ce que Steven Spielberg cherche chez François Truffaut, c’est son regard d’enfant, qu’il a décelé dans L’Enfant Sauvage où Truffaut, quasiment seul avec ledit enfant pendant tout le film, s’était accordé le rôle principal afin d’être au plus près de son jeune interprète pour pouvoir le diriger pendant les prises. Et c’est bien vrai que Truffaut et Spielberg partagent cette qualité de savoir filmer les enfants comme ils sont (des adultes miniatures comme c’est dit dans Jurassic Park ) avec leur cruauté et leur révolte, et pas uniquement comme des créatures inexpérimentées et attendrissantes. Mais il s’agit aussi pour ce jeune cinéaste, issu d’une mouvance qui veut bousculer le système tout en parvenant à l’intégrer, de trouver en Truffaut la reconnaissance qui lui apportera de la crédibilité chez les cinéphiles. Au-delà de sa réussite artistique indéniable et de la prestation inoubliable quoique totalement décalée de Truffaut, Rencontre du Troisième Type reste pour l’histoire comme le témoignage du lien entre la Nouvelle Vague et le Nouvel Hollywood. L’héritage de l’une étant tristement moribond, l’autre ayant triomphé, non sans tomber dans les dérives qu’il dénonça jadis. Voilà pourquoi on pouvait encore lire dans «La Libre Match » de mai dernier une interview où George Lucas déclarait que ses cinéastes préférés étaient Kurosawa et Truffaut. Etrange lien tacite et puissant sur lequel il convient de méditer.
Haute concentration de talent au mètre carré sur le tournage de Rencontres du Troisième Type En effet, si nous devons aujourd’hui prendre des leçons de François Truffaut - au-delà du simple et recommandable plaisir de spectateurs auquel nous invitent les deux coffrets édités par Cinéart - ce serait sur trois points. Primo, cette fascination pour le cinéma américain dont je parlais à l’instant. En effet, aujourd’hui, l’hostilité est de mise, on prête à Hollywood (au sens large car cette notion n’a strictement plus aucun sens) tous les maux du marché cinématographique européen. Et c’est vrai que leurs films trustent nos salles. Pourquoi alors le cinéma français, Luc Besson producteur en tête, cherche-t-il à copier ou singer ce cinéma qu’il ne peut sensément pas égaler ? Paradoxe absurde qui permet certes quelques succès qui, selon la formule consacrée, suscitent des bénéfices qui profitent aux « petits » films, mais qui, artistiquement et d’un point de vue identitaire, est très dangereux. La mondialisation est partout et à l’heure où les autorités tentent, maladroitement, de bâtir une Europe de l’exception culturelle, cette notion est en train d’être vidée de son sens par ceux-là mêmes qui devraient s’en réjouir.
La démarche de Truffaut, et on le constate dans Tirez sur le Pianiste et Vivement Dimanche présents dans le coffret 2, tout comme celle de ses illustres camarades de la Nouvelle Vague (Chabrol encore aujourd’hui) était de s’emparer des mythologies et des techniques étrangères, non pas pour les importer dans le cinéma national, mais pour les digérer, les maltraiter et les régurgiter plus ou moins consciemment, parfois méconnaissables, dans leurs propres productions, dont le caractère typique provoque une identification forte qui, à son tour, peut être digérée par les cinéastes étrangers, sans que cela implique la condescendance de leurs aînés. Ce mouvement perpétuel, de curiosité et d’émulation, bénéfique pour chacun, et avant tout pour le spectateur, est complètement brisé aujourd’hui. Les Français ont quasiment coupé les ponts avec la tradition dont ils s’enorgueillissent, lui préférant celle, plus limitée, du grand-guignolesque et de la comédie franchouillarde type Le Gendarme et les gendarmettes ou copient, mal, les Américains. Il nous reste quelques Despleschin, Podalydès ou Bacri-Jaoui, mais jusqu’à quel point ? Les Américains, eux, « remakent » à tout vent les succès asiatiques ou leurs propres mythes en les vidant de leur substance. Un tableau certes un peu alarmiste mais, tout de même : autre temps, autres mœurs.
Deuzio, la liberté que s’accorde Truffaut. A la tête des Films du Carrosse, Truffaut se rêve comme un cinéaste indépendant, chose que les fluctuations commerciales de ses films ne lui permettent pas tout à fait. Il n’empêche, qu’il ne semble se mettre aucune barrière. Tout en travaillant dans un style reconnaissable, avec des obsessions récurrentes et para-filmiques, avec une série de collaborateurs fixes, il touche à la comédie, au drame, à la science-fiction, au polar, au cinéma du réel comme à la fantaisie, au film d’époque comme à la chronique sociale, aux succès annoncés comme aux projets plus exigeants. Et chaque fois, il fait mouche. C’est ce qui est fascinant chez lui. A travers chacun de ses films, c’est lui qu’on lit en filigranes, et ses films se parlent entre eux de façon pragmatiques (répliques, plans, accessoires, situations, … scandés à travers les années). Chaque fois, cette découverte est renouvelée, diversifiée avec une constante qualité. Tout cela conférant à son œuvre une intimité sans faille avec le spectateur, une relation de confiance et de fascination mutuelle. Quiconque a succombé, et est devenu « truffaldien », sait qu’à travers ses films et les nombreux ouvrages qui lui sont consacrés (le plus incontournable étant la biographie de Serge Toubiana et Antoine de Baecque), le cinéaste devient notre ami. Et, parfois, un mythe, tout auréolé d’une mort romantique, quoique réellement tragique puisqu’il succombe à une tumeur au cerveau à 52 ans seulement, des projets plein les armoires et une carrière que l’on aurait tant voulu voir continuer.
Et ceci m’amène au dernier point digne d’inspiration pour les cinéphiles et surtout les cinéastes d’aujourd’hui. C’est la passion dévorante, exclusive que Truffaut vouait au cinéma. Dès son enfance, celui-ci est sa plus belle porte de sortie d’un quotidien bien gris. Il fonde un ciné-club éphémère, devient le protégé de Bazin puis de Rosselini. Critique féroce, mais capable du même regard sur son travail. Tous ses centres d’intérêts, la littérature, la musique et, surtout, les femmes, sont exploités dans une œuvre dense et cohérente, impossible à résumer ici, un terrain d’exploration jouissif pour les spectateurs et, avant tout, une sacrée collection de films allant du « très bon » au « tout bonnement sans faille » et brossant, à travers ses interprètes, un portrait de famille plus que flatteur du cinéma français. Toute sa vie, il s’est demandé si le cinéma était plus important que la vie, et nous sommes les bénéficiaires de cette réflexion abyssale. Ce n’est déjà pas mal pour un seul homme, non ? Alors tentez l’expérience grâce aux coffrets de Cinéart et leurs bonus (version light de ceux proposés par mk2) qui vous feront découvrir l’homme au travail, et vous comprendrez pourquoi : « Des dizaines et des dizaines de livres lui sont consacrés, les plus grands le citent, etc., etc.».
Films de François Truffaut, 2 coffrets édités par Cinéart, dans la collection CinéFiles - classiques, Distribution Twin Pics.