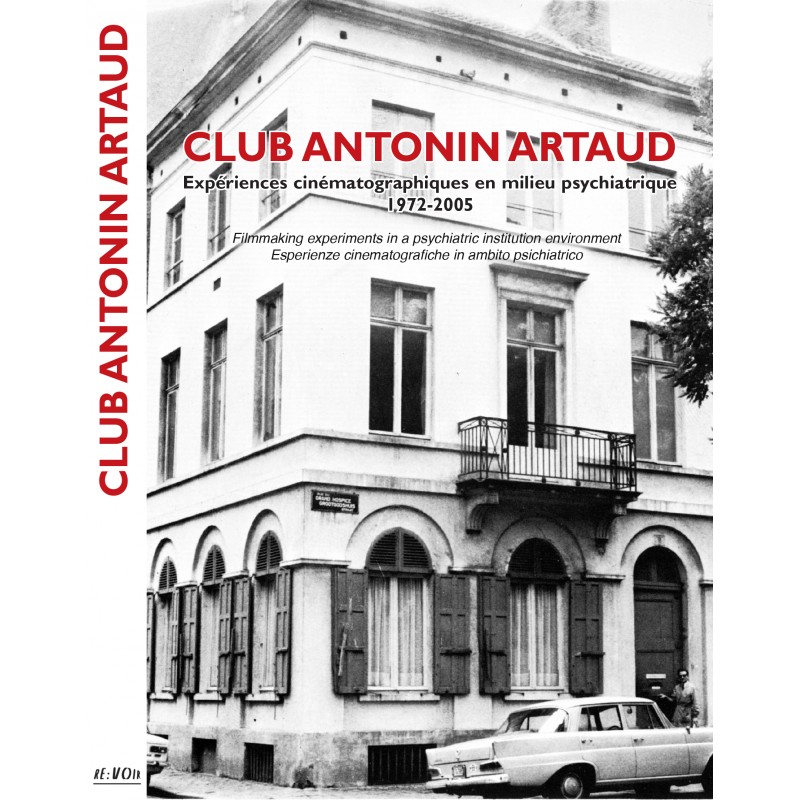Ingmar Bergman

La tendresse et la désolation
Ingmar Bergman est mort cet été à l’âge de 89 ans. Il vivait seul, en ermite, à Farö, l’île où il avait tourné Persona, L’heure du Loup, Une passion... Une île rêche faite de galets et de pins tordus. Pour lui rendre hommage, Boomerang réédite l’intégrale de son œuvre en DVD. 35 films, deux sur chaque DVD, des classiques du cinéma qui sont sans cesse à redécouvrir, inlassablement. Car la seule unité esthétique du cinéma de Bergman, c’est cette sorte de geste épique, de tentative sans cesse renouvelée d’approcher la réalité. Elle se nourrit de l’angoisse, pur sentiment existentiel, sentiment de la désolation. Elle se résout dans ce qu’il nomme la « tendresse », instant de grâce ténu et fragile, incarnée par la Piéta de Cris et Chuchotements. Elle prend la forme, enfin, d’une œuvre cinématographique en perpétuels questionnements, réinventions, renouvellements.
Il faut absolument lire le Hors Série des Cahiers du Cinéma paru à la rentrée sur Bergman et Antonioni parce que ce petit numéro qui se consacre pour moitié au réalisateur suédois est une petite merveille qui réunit, outre quelques articles de circonstance, quelques hommages et quelques analyses transversales, tous les textes, ou presque, parus dans les Cahiers depuis 1958. Par la grâce d’une rétrospective à la Cinémathèque française cette année-là, Godard redécouvre Monika. Dans un article intitulé « Bergmanorama », il fait de Bergman, « l’auteur le plus original du cinéma européen moderne », celui dans lequel lui et ses comparses se reconnaissent : l’emblème du renouveau du cinéma tant attendu et célébré par ceux qui formeront bientôt la Nouvelle Vague.
Cet article fera date parce qu’à travers Bergman, il définira le surhomme du cinéma : «L’artiste moderne » qui ne se revendique d’aucune école, d’aucun style, qui, en quête de l’instant de grâce, du juste, du vrai, « marche la tête haute », « car est neuf, nous prouve Bergman, ce qui est juste, et sera juste ce qui est profond… Est profond ce qui est imprévisible ». Et quand Godard redécouvre Monika en 1958 à Paris, le film est sorti six ans plus tôt en Suède. La carrière de Bergman a commencé en 1945.
Boulimique, obsessionnel, il arrive au cinéma en répondant à une commande, déjà connu pour ses mises en scènes au théâtre, il écrit des pièces et des scénarios, et il tourne, il tourne, apprenant son métier sur le tas, ne cessant jamais de travailler pour le théâtre, son premier amour. En 1958, Bergman a quarante ans, il a déjà réalisé 19 longs métrages. Après septante années de carrière, il a fait 53 films, dont quelques documentaires. Dans cette œuvre si riche, si diversifiée qu’il est difficile de la ranger sous une étiquette générique, on peut cependant distinguer quatre périodes.
Une première partie, plutôt néoréaliste, s’étend de Crise (1945) jusqu’à Sourires d’une nuit d’été (1953). Les premiers films de Bergman sont très proches du cinéma français des années quarante, de l’expressionnisme et du réalisme « sordide ».
La société suédoise traverse une crise de conscience, conséquence de sa neutralité chèrement payée pendant la Seconde Guerre Mondiale, et affronte, comme toute l’Europe, le traumatisme collectif de la Shoah. Bergman filme alors une jeunesse désemparée, en révolte, qui cherche à préserver un bonheur que la société, le monde des autres, piétine. À partir de Vers la joie (1949), ce réalisme se fait nettement moins dur, teinté de plus de fantaisie et d’ironie. Certains films sont des comédies de mœurs qui firent une partie du succès du réalisateur.
Tout en se rapprochant des comédies ‘érotiques’ de Maurice Stillzer, autre réalisateur suédois qui influença le cinéma de Bergman, elles peuvent rivaliser avec les comédies américaines des années cinquante, celles d’un Lubitch ou d’un Cukor. La seconde moitié des années 50 est marquée par une période plus symboliste, qui débute avec Le Septième sceau (1956) et s’achève avec L’Œil du diable (1960).
L’influence de Victor Sjöstrom, qui incarne le personnage principal des Fraises sauvages (1957) et qui fut l’un des pionniers du cinéma muet, se fait nettement sentir dans le cinéma de Bergman à cette époque. Entre les années cinquante et le début des années soixante, ses films sont axés sur la quête du sens et la question de Dieu. Fondement du sens, mais aussi du langage, Dieu, peu à peu, se désagrège dans la croyance de l’homme parce qu’il n’a pas répondu. À partir de là, va surgir le couple.
Au même moment, au théâtre, Bergman met en scène des auteurs comme Camus, Sartre ou Beckett. Au cinéma, il filme des personnages désemparés qui ne peuvent plus vivre qu’à la lisière du monde. C’est une troisième période de son œuvre, qui commence avec « la trilogie de chambre », composée d’À travers le miroir (1961), des Communiants (1963) et du Silence (1963) et qui s’achève avec Cris et chuchotement (1972). Période sans doute la plus novatrice de son œuvre, Bergman se libère de toute influence pour bouleverser son cinéma sur le plan narratif comme esthétique. Il épure ses intrigues, les concentre sur un ou deux lieux, brise les chronologies, s’attache à un nombre très restreint de personnages, trois, quatre. Et il expérimente, n’hésitant pas à se répéter pour creuser, toujours plus loin, les motifs et les formes qui le fascinent.
Son cinéma devient le cinéma de l’affect, le cinéma de l’angoisse pure. Rêve, fantasme et folie contaminent l’histoire et la forme du film. Persona est sans doute l’apogée expérimentale de cette période quand Cris et chuchotements en est sans doute l’apogée esthétique. Quand, dans l’après-guerre et les années qui suivirent, la psychanalyse et l’existentialisme battent leur plein dans les idéologies, Bergman est portée aux nues par la critique et les spectateurs. Sa grande époque va de la fin des années cinquante jusqu’au milieu des années septante.
À partir de là, on va lui reprocher de se répéter (ce qu’il a toujours fait), on accuse son maniérisme, ses drames existentiels, son symbolisme poussif, trop lourd, trop appuyé, on s’ennuie désormais devant les longs monologues face caméra et les immenses gros plans qui dévisagent et scrutent, et son évitement du champ/contrechamp, sa marque de fabrique : deux visages dans le cadre en même temps.
On le lui reprochera quand on aura oublié dix ans, vingt plus tard qu’il était celui qui avait inventé ces motifs. Cette dernière période de son œuvre, si elle revient vers des formes cinématographiques plus classiques, plus réalistes comme Sonate d’automne ou Scènes de la vie conjugale, n’en est pas moins faite de nouvelles expériences, de découvertes et de recherches. C’est dans cette dernière période qu’il signe l’apogée « bergmanienne », Fanny et Alexandre (1982), sommet de son œuvre où s’enlacent tous les thèmes, tous les caractères et toutes les formes de son cinéma avant l’immense et tout dernier film, Saraband (2004).
Il conçoit Scènes de la vie conjugale comme Fanny et Alexandre pour le petit écran, des romans fleuves diffusés en plusieurs épisodes, il adapte, dans le même esprit, La flûte enchantée (1975), réalise un chef d’œuvre pour la télévision allemande : De la vie des marionnettes (1980). Avec En présence d’un clown (1998) et Saraband, c’est à l’utilisation du numérique, dans la toute fin de sa vie, que Bergman va se frotter. Pour la télévision, encore. Dans cette dernière période de son cinéma, il dissèque les couples et la famille, ce qui reste de la société à la fin du XXème siècle, seul fondement possible après l’échec du sens social et spirituel. Mais la famille telle qu’elle est représentée par le réalisateur fait l’objet d’une profonde critique et d’un douloureux constat d’échec : elle repose sur un couple toujours en perdition. Jusqu’à Saraband.
“Je ne puis m’empêcher de croire que je manie un instrument si raffiné qu’il nous serait possible d’éclairer avec lui l’âme humaine d’une lumière infiniment plus vive, de la dévoiler encore plus brutalement et d’annexer à notre connaissance de nouveaux domaines du réel. Peut-être découvririons-nous même une fissure qui nous permettrait de pénétrer dans le clair-obscur de la surréalité, de raconter, d’une façon nouvelle et bouleversante.”, écrit Bergman dans Lanterna Magica. Son cinéma n’a jamais cessé de tenter d’appréhender le réel pour le révéler.
C’est un cinéma qui n’a fait que filmer des hommes dans cette lutte-là, la sienne. Elle se marquait stylistiquement dans certaines figures cinématographiques - le cadre dans le cadre - ou dans certains symboles - les miroirs, les spectacles, la magie, la mise en scène du rêve. Puis elle se généralise par la représentation du spectacle dans le spectacle lui-même, la machine cinématographique s’exhibe comme machine à rêve. Il n’y a plus de Dieu, plus vraiment non plus de réalisateur. Le film se désigne lui-même comme film, expose ses rouages en devenant lui-même spectacle, se construit seul et se montre en construction. C’est Persona. Ce qui est filmé ainsi est toujours flottant, jamais garanti, jamais soutenu par une énonciation. Le film épouse directement les affects des personnages. Bergman résume : « Mes films sont l’explication de mes images », qui donne son titre au récent livre de Jacques Aumont. Obsessionnel, torturé, angoissé, hanté par la rigidité protestante de son éducation, il tisse des histoires autour des images qui le hantent. C’est aussi la marque de son cinéma, onirique, fantastique, halluciné. L’esthétique de Bergman est une perpétuelle interrogation sur le statut de la réalité et celui de l’identité, tous deux, de concert, toujours menacées et menaçantes, une hésitation vacillante entre réalisme et onirisme, la tentation de la folie. Images vénéneuses ou tendres, rêves et cauchemars, images obsédantes, envahissantes, venues de trop loin pour pouvoir être racontées, digérées, traduites. Images autour desquelles on ne peut que tourner. Images brûlantes. Images-visions. Les images du dedans que son cinéma va mettre en scène.
Et si tout est si symbolique chez Bergman, c’est qu’en effet, tout se donne à voir, se livre, se cherche parce que justement, tout vient se condenser dans ces images qui, en même temps, résistent au discours, au sens. Il n’y a pas de perlaboration. Alors, c’est du noir sur blanc : le silence (de Dieu, des hommes), les cris, les chuchotements, l’incapacité à dire, l’impossibilité à se dire soi, à se raconter, les marionnettes que nous sommes, que nous jouons, que nous faisons jouer, l’enfance, sa nostalgie, ses rêves et ses traumatismes, l’île partout où nous sommes, que nous sommes. Et les femmes, bien entendu. Toutes ces femmes. Le visage. Le silence. La Honte, et l’humiliation Le Lien et Une passion… Rien que les titres de ses films. Tout est à prendre au pied de la lettre, comme dans les rêves, justement.
Et puis Saraband. Le dernier. La musique. La musique, enfin, pour ne faire qu’effleurer tout ce qui ne peut se dire. Finalement, après avoir tant fait parler ses personnages, après avoir tant cherché à dire, à dire cette impossibilité à se dire, à dire ce silence devant la quête d’un sens qui toujours se dérobe, Bergman s’en va sur la musique, sur ce magnifique chef-d’œuvre, le résultat d’une quête de toute une vie, un testament venu déjà un peu de l’au-delà. Pour une seconde de tendresse enfin retrouvée, deux corps nus et usés qui se tiennent chaud, se réconfortent dans la nuit de leurs angoisses, dans la nuit de la mort qui tombe. Une toute dernière Piéta que l’on ne verra pas à l’écran car Johan veut que Marianne éteigne la lumière. C’est dans la nuit qu’on se met à nu.