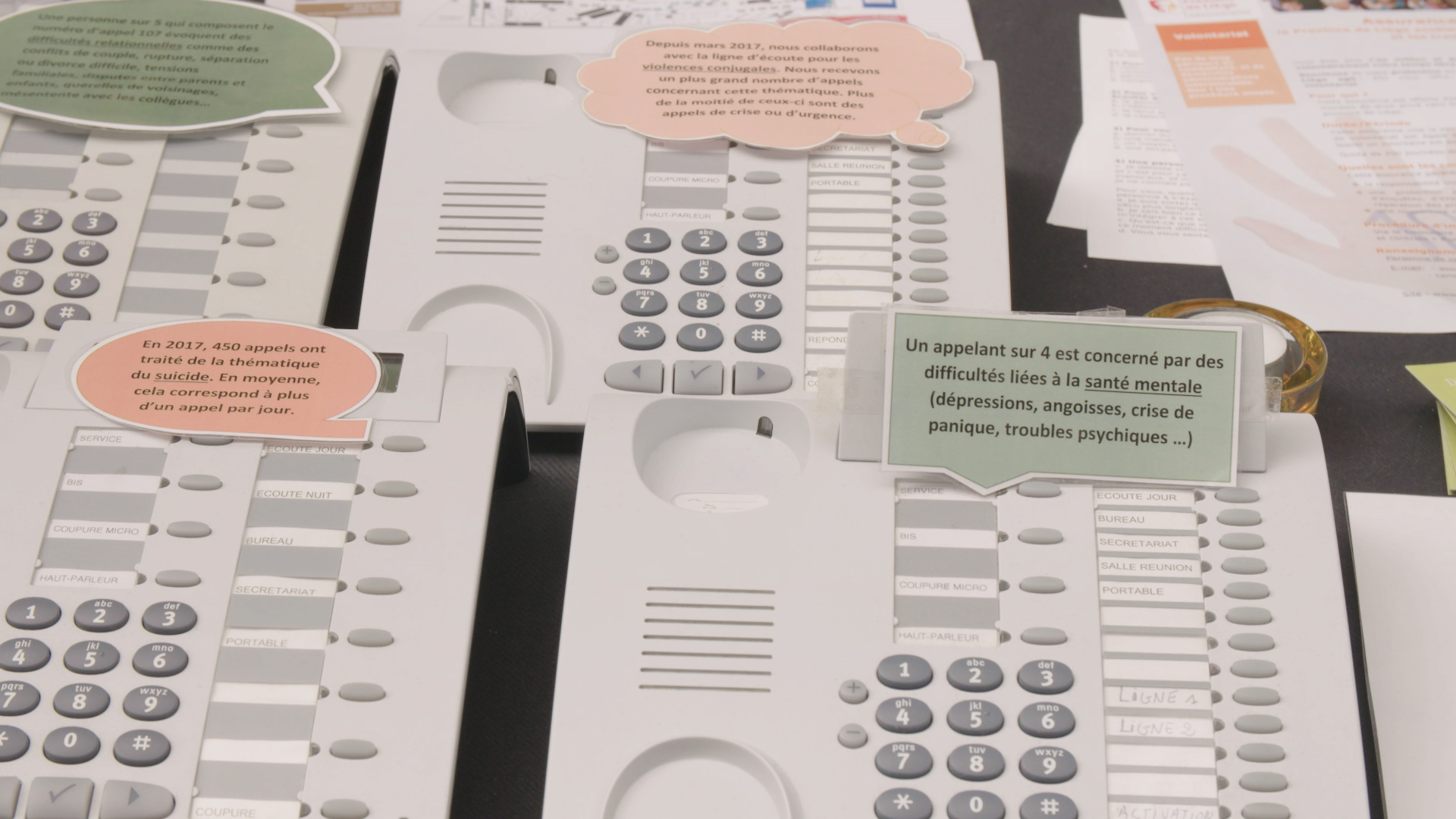Avec Planète B (2024), Aude Léa Rapin s’aventure dans les territoires de la science-fiction pour livrer une dystopie à la fois politique, féministe et ancrée dans nos angoisses contemporaines. Le film suit Julia, une jeune militante écologiste incarnée par Adèle Exarchopoulos, projetée dans un futur proche où les activistes sont condamnés à une prison virtuelle appelée « Planète B ». Isolée dans un monde numérique déshumanisé, Julia doit lutter pour préserver sa mémoire, son engagement et sa liberté intérieure. À travers ce récit, Rapin explore les dérives autoritaires, la criminalisation des luttes sociales, et la place des femmes dans les récits d’anticipation, tout en posant une question centrale : que reste-t-il de nous quand on nous arrache à la réalité ?
Planète B d' Aude Léa Rapin

Le film traite avant tout de liberté sur plusieurs plans : le permis de séjour, la surveillance, la loi martiale, la liberté de la presse, et le cas carcéral. En effet, nous suivons principalement deux femmes, Julia, une militante de la liberté, et Nour, une journaliste immigrée d’Irak. Nous comprenons très vite que le monde du libéralisme s’est refermé sur lui-même au point où la France, symbole de la révolution, est devenue un état fermé qui règne sous la loi martiale. Ainsi, Nour qui se bat pour prolonger son visa de séjour et rassembler les fonds pour s’expatrier au Canada, symbolisé comme une terre libre, embarque dans une aventure inattendue pour rendre justice aux supplices cachés que la France fait subir à ses prisonniers.
Il y a donc dans ce film une volonté de dénonciation d’un certain système carcéral et d’un avenir proche, 2039, assez sombre. On comprend assez facilement que la disparité sociale s’est creusée et qu’il n’existe plus de nationalité à proprement parler. Tout le long du film, les personnages parlent anglais comme français. Fondamentalement, le récit s’ancre dans un désir de justice. Rapin l’explique très bien dans un entretien pour le CNC, où elle exprime le changement de paradigme dans la science-fiction. Là où Luc Besson proposait des futurs lointains dans des mondes aux voitures volantes, aujourd’hui nos sciences-fictions annoncent un avenir sombre, dur et déshumanisé.
Ainsi la fin agit comme un message pour un avenir plus radieux où la lutte ne fait que commencer. Nour choisit de remettre toutes les preuves de la torture exercée en prison pour qu’elle soit révélée au monde, dans un ultime appel à l’aide. La libération par les rebelles avec une bande sonore de news qui dénonce les abus autoritaires sous les premiers rayons de soleil du vrai monde devient le symbole d’un espoir.
Car, les prisonniers ne sont pas simplement dans un lieu enfermé. Ils sont emprisonnés dans une réalité virtuelle où les forces de l’ordre ont, eux, toute la liberté de les torturer pendant leur séjour sans qu’aucun mal tout en préservant leur enveloppe charnelle. La réalité virtuelle a finalement été détournée à des fins de torture, jusqu’au décor paradisiaque en opposition au monde sale et enfumé de la pollution.
Planète B ne se contente pas de projeter un futur dystopique : il en trace les contours déjà perceptibles dans notre présent. En ancrant son récit dans une France autoritaire, cloisonnée et technologiquement aliénante, Aude Léa Rapin alerte sur les dérives d’un monde qui sacrifie la liberté au nom de la sécurité, et la vérité au profit du contrôle. À travers Julia et Nour, deux figures féminines puissantes et lucides, le film redonne souffle et voix à celles et ceux qu’on cherche à faire taire. La science-fiction devient ici un miroir politique, un outil de résistance et d’émancipation. La lumière finale, celle d’un soleil retrouvé, n’efface pas les ténèbres, mais rappelle que l’espoir, tant qu’il reste des images et des mots pour le dire, est toujours une possibilité.