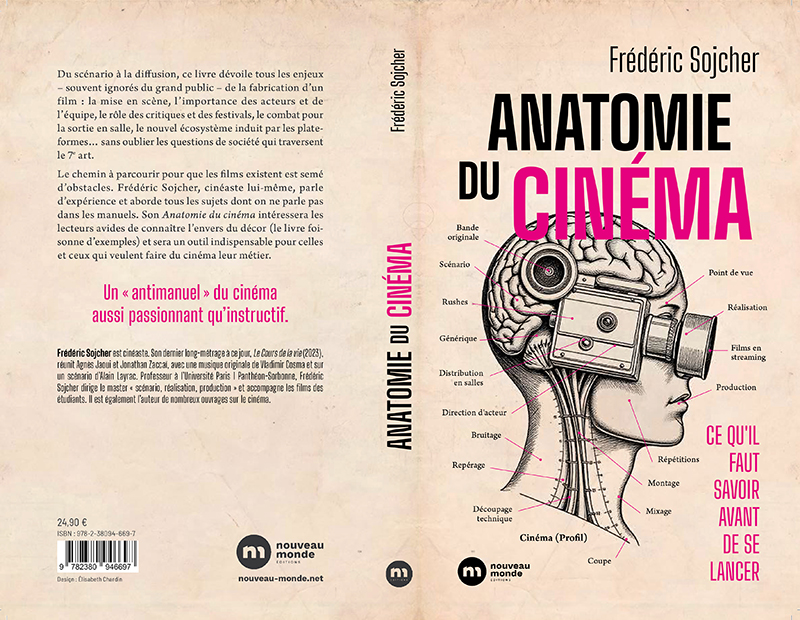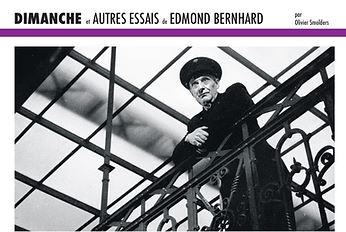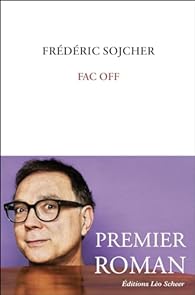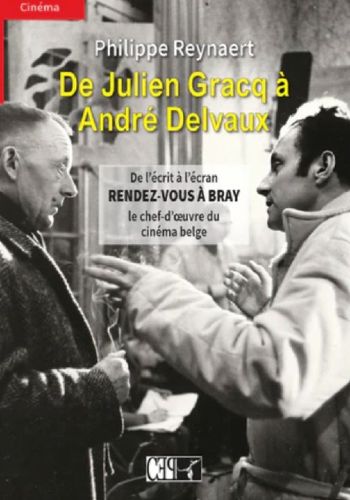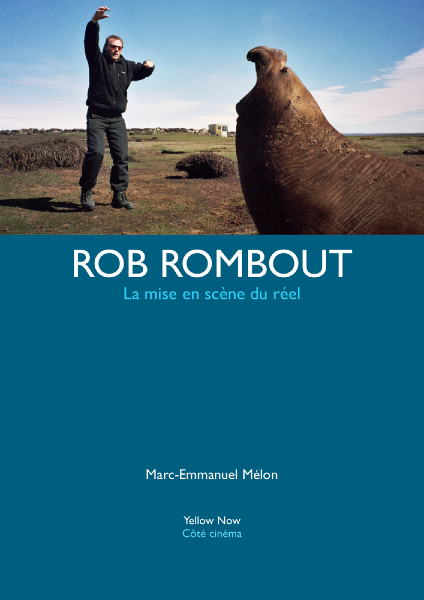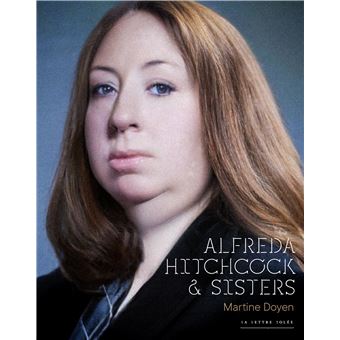La forme et le contenu à Hollywood, de 1960 à 1990

Après un premier tome consacré à l'âge classique, Le temps des géants(des origines aux années 60) Pierre Berthomieu parcourt désormais, dans le second tome, des années 60 à 90). Un moment pendant lequel la perfection classique des studios a été confrontée à la modernité et va s'y adapter.
Berthomieu met en évidence la forme cinématographique, et pas seulement la diversité du contenu autour des thèmes et des mythes de la culture américaine, notamment via les différents genres (comédie, western, thriller, mélodrame, etc.) Cette pertinence de la forme, qu'elle soit classique (linéaire, narrative, mimétique, emphatique) ou dans les variations qu'offre le parcours de la modernité est aussi importante que le contenu (1). L'un des intérêts du livre consiste également à nous montrer les liens entre le cinéma américain et le cinéma européen. Ceux-ci n'arrêtent pas de se déployer en pli et en repli.
Les cinéastes et critiques de la Nouvelle vague ont découvert Jean Seberg via deux films d'Otto Preminger, cinéaste charismatique et indépendant qui représente l'un des ponts entre l'âge classique et la modernité. Le charisme de son style s'impose comme celui d'Hitchcock pour les futurs cinéastes des Cahiers du Cinéma. À travers deux de ses films : Sainte Jeanne et Bonjour Tristesse, Jean Seberg, dirigée et chorégraphiée par Preminger séduit Jean-Luc Godard qui l'engage pour incarner le personnage de Patricia dans À bout de souffle.
On y voit d'ailleurs Seberg se glissant dans une salle de cinéma qui projette Le Mystérieux docteur Korvo de Preminger. Celui-ci a tourné Bonjour Tristesse en cinémascope et n'hésite pas à passer du noir et blanc à la couleur suivant le passage narratif d'une époque à l'autre. Avec malice, le réalisateur inverse le classicisme chromatique : le présent est froid (donc en noir et blanc), le passé plein de souvenirs sublimés est chaud (donc en couleur). Le passage s'effectue, tout au long du film, dans le flottement émotionnel de Cécile. Au rythme de ses pensées, la frontière entre deux mondes qui coexistent s'estompe, se dissout imperceptiblement. La couleur utilisée par Preminger proche de la peinture de Matisse a inspiré Le Mépris de Godard.
Le lien entre les deux continents est déjà perceptible avec la génération autour d'Elia Kazan. Celui-ci offre une première alternative au style glamour des studios d'Hollywood. Le masque disparaît au profit de l'innocence brute qu'offrent Marlon Brando et Eva Marie Saint dans Sur les quais. « Le refus de la séduction plastique s'étend chez Kazan, écrit Berthomieu, à toutes les iconographies traditionnelles. Malgré un héritage de grands rites de l'âme chrétienne (l'ascension du prêtre dans Sur les quais, les pleureuses dans Viva Zapata ), Kazan se défend de tout symbolisme de type sulpicien ». Ce qui ne l'empêche pas, et c'est son paradoxe, de renforcer à la galerie des mythes avec la sensualité d'acteurs comme Marlon Brando, James Dean et Montgomery Clift. Trois acteurs sortis de l'Actors studio qu'il a créé en 1947, à New York.
Pour l'Europe, et ensuite pour les Etats-Unis, le regard de la modernité va s'incarner via la grammaire de Michelangelo Antonioni. Son usage du plan long, la relation instable de ses personnages, sa géométrie des interstices, sa fiction flottante, sa défiance envers le monde classique. L'horizon du thriller, à l'américaine, mais dans un tout autre style, hante Antonioni dès ses débuts avec Chronique d'un amour (1950). Zabriskie Point tourné en 1969 à Death Valley (Californie/Nevada), marque la rencontre d'Antonioni avec l'Amérique. Il capte la contre-culture et la révolte des étudiants contestataires à travers un duo (Daria Halprin et Mark Frechette) qui se déploie dans un trip véhiculant les archétypes de la contre-culture. Une errance dans un espace sans repère. Les séries d'autoroutes, vues d'avion, dévoilent que l'espace américain s'est transformé en réseau de signes vidés du sens de l'environnement..
Lorsque Daria apprend la mort de Mark, abattu par un policier, le film s'achève par l'explosion de la maison de son patron. Antonioni filme, de loin, de près, puis dans les détails, le catalogue d'objets matériels et d'ordures confondues, d'un quotidien devenu aseptisé par la consommation-destruction.Le tout dans un montage qui fusionne le ralenti et la répétition du mouvement sur une musique des Pink Floyd. Pour Berthomieu, le film représente une forme idéale d'une sorte de « modernité américaine », une sorte de patron pour le cinéma hollywoodien des années septante. Après avoir vu Blow-Up (1967) d'Antonioni, Alfred Hitchcock, cinéaste sensible au style et à la modernité, envisage de tourner Kaleidoscope, un projet inspiré par le fait-divers d'un serial-killer séducteur. Il fait les repérages du film en demandant de photographier des actrices qui sont des mannequins de mode (des photos de ce fragment de film sont montrées). Les studios Universal refusent de le suivre. Le film deviendra Frenzy, tourné à Londres en 1972. Plus étonnant encore dans ce que nous signale Berthomieu, outre le triangle Brian De Palma avec Hitchcock et Antonioni (Body Double et Femme fatale), une sorte de retour du refoulé chez Antonioni vers Sir Hitchcock. Dans son dernier film, Identification d'une femme (1982), le cinéaste italien filme l'escalier en spirale à partir duquel Nicolo cherche l'insaisissable Mavi, escalier éclairé de la même façon que celui de la mission espagnole dans Vertigo où James Stewart cherche à rejoindre Madeleine (Kim Novak).
Photographe, joueur d'échec invétéré, Stanley Kubrick cherche, dès son entrée dans le monde du septième art, a être original. C'est dire si l'esthétique des studios hollywoodiens est en inadéquation avec sa recherche permanente et intense de la créativité des images. Spartacus lui sert de passeport pour Hollywood. Dès Lolita, il s'installe à Londres pour gérer lui-même son œuvre, la contrôler comme il l'entend, tout en restant en contact avec les studios. Kubrick, souligne Berthomieu, est un réalisateur dans la veine moderne. D'une part à cause de son goût pour l'innovation technique, et d'autre part par son ton anti sentimental et satirique qui prédomine dans ses films. Il se détache de la dette romantique en effectuant un retour aux modèles classiques pré-romantiques avec « une conscience aigüe de l'histoire de l'art et de ses dispositifs formels qui explique en partie la syntaxe de ses films ».
Kubrick n'utilise le cinémascope que dans deux de ses films : Spartacus et 2001 l'Odyssée de l'espace. Il préfère l'effet de symétrie qu'offre un cadre proche de la peinture classique. Ses autres films sont donc distribués et projetés en format 1.66 (carré) ou 1.85 (rectangle, Spielberg privilégiera ce format qu'il considère comme étant le plus proche du champ naturel de l'œil humain).
Dans Clockword Orange, Alex est perçu, au début du film, via un gros plan de son œil, puis l'ensemble de son corps est visible parmi des corps-objets de vestales érotiques au Korova milk bar. Clockword est une machine assimilant le vivant au mécanique. Une tentation que les forces de la technique offrent à la pulsion prométhéenne de l'homme moderne. Ce diagnostic satirique et visionnaire de Kubrick se retrouve lors du lavage de cerveau d'Alex pendant le traitement Ludovico. On y voit l'œil ouvert du garçon obligé de regarder des horreurs en écoutant le rythme énergique de la neuvième symphonie de Ludwig von Beethoven. Ce musicien, créateur démiurge, ne pouvait qu'inspirer Kubrick.Il n'est d'ailleurs pas seulement dans les oreilles d'Alex, on le trouve aussi dans Eyes wide shut (Les yeux largement fermés) puisque fidélio (unique opéra du compositeur) est le mot de passe pour pénétrer dans une orgie fondée sur une cérémonie secrète autour d'un rituel artificiel des corps. Bill y plonge abasourdi et manque de s'y noyer les yeux ouverts et fermés pour Alice, sa femme. Celle-ci dit à Bill, son mari, au début du film : « Tu ne m'as même pas regardée ».
La flamme créatrice qui anime Francis Ford Coppola repose sur l'idée d'un septième art qui puisse combiner les autres : le théâtre, la peinture et la musique. Coppola trouve dans le classicisme une synthèse organisant différentes expériences esthétiques. Si le récent l'Homme sans âge peut être considéré comme un retour de flamme vers la révolution hollywoodienne des années 1970-1980, Le Parrain 1,2,3 représentent, quant à eux, un retour aux principes formels de la tradition classique.
Avec l'émergence des blockbusters de Steven Spielberg et Georges Lucas, a-t-on assisté à un retour de l'esthétique classique ? Berthomieu pose la bonne question : « Hollywood fut-elle jamais moderne ? » Malgré l'accélération du montage, la vitesse speed qu'ont imposé les clips musicaux, et le moule de l'esthétique publicitaire dans les années 80, le désir du retour à l'âge d'or d'un style formel utilisé par les grands studios n'a jamais quitté le territoire du cinéma hollywoodien. Sauf pendant le très bref épisode du Nouvel Hollywood. Cela semble n'avoir été que la seule intrusion d'une modernité européenne dans la Babylone du cinéma.
Différents chapitres de l'ouvrage examinent les styles spécifiques utilisés par les cinéastes majeurs des années 60-90 : les essais formels de Blake Edwards et de Richard Quine, l'œil baroque et la liturgie des images en puzzle chez Brian De Palma, le spirituel mis en valeur dans l'expérience stylistique de Martin Scorsese, les micro-mouvements de la nature qu'observe Terrence Malick, le rythme en convergence avec le Jazz dont s'inspire Clint Estwood, le désir de réaliser le film absolu qui hante Coppola.
Ce n'est qu'un petit aperçu de ce qu'offre ce livre de près de 750 pages, illustré de cinq mille images dont les approches transversales et les liens entre différents films et différents réalisateurs sont stimulants et permettent de mieux comprendre tout un pan des liens du cinéma et de l'usine à rêve étasunienne.
(1) Sur le contenu et les normes formelles : « Cet idéalisme du contenu (de production ou de signification) ne tient jamais compte de la forme. Cet idéalisme du message oublie que ce qui s'installe derrière leur circulation accélérée, c'est l'hégémonie d'un code » (Jean Baudrillard in Pour une critique de l'économie politique du signe, éditions Gallimard).
Hollywood moderne, le temps des voyants, de Pierre Berthomieu, éditions Rouge profond, coll. Raccords, France, 745 pages, 2011, 28cm, ISBN 978-2-915083-38-5