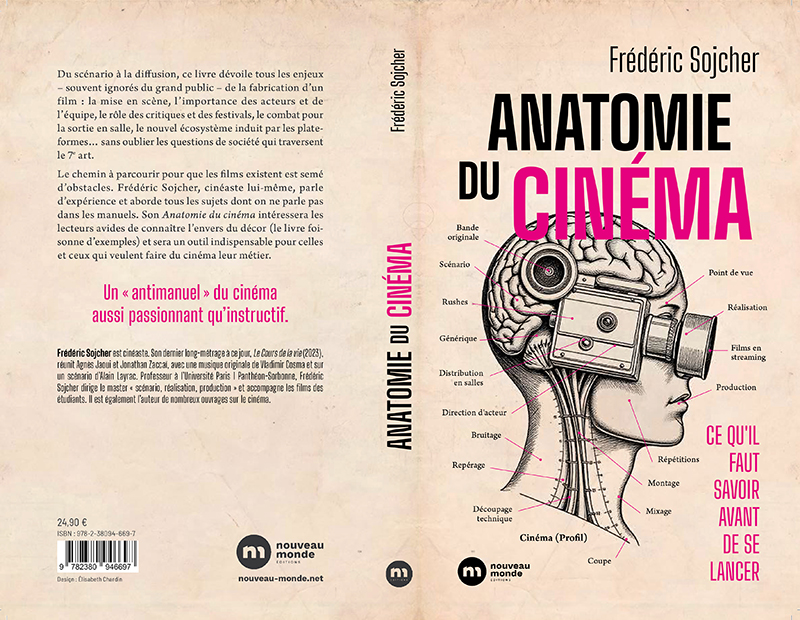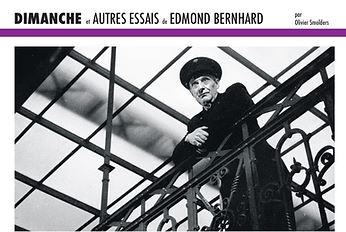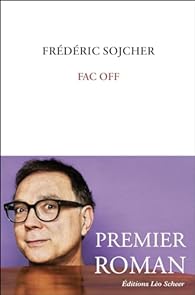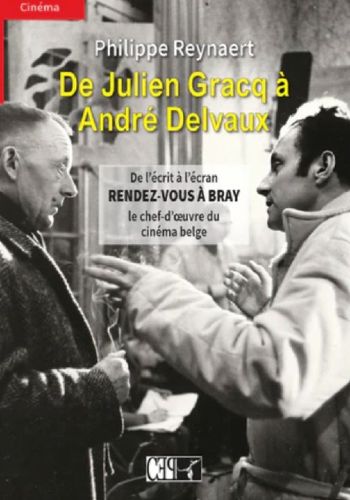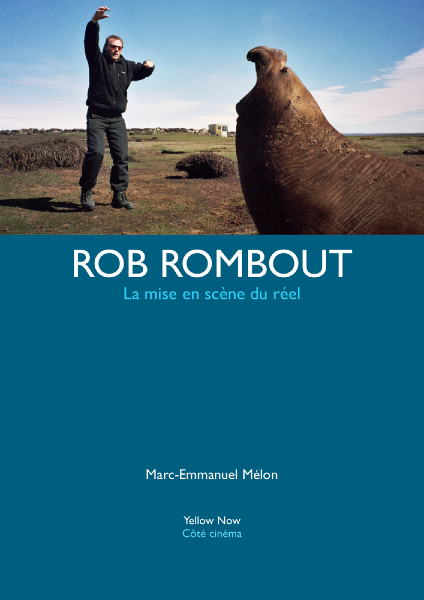Trafic 67 - automne 2008

Pour les apôtres de l’éloge du scénario, dominés par la production télé, il peut paraître surprenant de lire les propos tenus, en 1960, par le grand cinéaste japonais Kijû Yoshida. Ce dernier prône l’enregistrement de la complexité du réel, plutôt que le visuel du scénario.
« Fort de l’influence de la Nouvelle Vague française, écrit-il, il nous faut soutenir l’idée que le cinéma n’a aucune obligation envers le récit. Le cinéma doit se concevoir comme images, comme la mise en rapport productive des mots du récit et de fragments prélevés directement dans le réel. Sur la base du documentaire, nous devons attendre la revitalisation du cinéma d’un art de l’enregistrement ayant fait abstraction de l’histoire. Le scénario n’est qu’en dernier lieu la caution des images d’un auteur. Quant à la caméra, rendons-la à sa fonction essentielle : vers le réel, au cœur du réel ». Ainsi s’ouvre, dans Trafic 67 (notre revue favorite), trois textes de et sur Kijû Yoshida, l’un des trois réalisateurs mythiques (avec Nagisa Oshima et Masahiro Shinoda) de la Nouvelle Vague japonaise. Ceux-ci, grands admirateurs de Godard, Truffaut, Resnais, Antonioni, assistants des films de la Shoshiku dirigée par Shiro Kido (genre de phénomène semblable à un Louis B. Mayer à Hollywood), vont pouvoir y réaliser, en 1960, leurs premiers films.
L’image comme écriture définit les règles, et non l’inverse. On ne prend pas une caméra « pour illustrer les pages d’un scénario », pour lui donner le visuel qui lui convient. Mieux, l’essentiel d’un film consiste en une perception des indices du réel. Il y a donc une nécessité, pour le réalisateur, de pratiquer un abandon face à la richesse du réel plutôt qu’une maîtrise du réel via un récit. Plus encore, rappelons les options de Godard déclarant que le sujet n’existe pas en soi. Il devient. Il est un « work in progress », comme l’affirmait James Joyce. Godard pianote sur un thème : l’époque dans tous ses états. Il expérimente, il cherche.
Revenons à Yoshida : « Livré au silence où le laisse son abandon dans l’image comme manifestation complexe du réel, l’auteur, pour Yoshida, se maintient au bord du vide, à l’instant décuplé de la chute, miné par l’obligation absolue de ne pas tomber. Concevoir le cinéma comme image veut qu’on y invite un principe forcément destructeur, son effondrement, un point d’obscurité – image, abîme – d’où il tire son origine et sa vitalité ». Ce brio, dans la perception d’un monde opaque, les spectateurs d’Eros+Massacre (Erosu purasu Gyakusatsu - 1969) ont pu le percevoir.
De ce film, Matthieu Capel nous rappelle la scène de la douche où un cache – censure japonaise oblige – recouvre le sexe d’Eiko. « Le cache fait partie de l’image, il entre dans sa composition (…) Grâce au cache, l’œil glisse indéfiniment à la surface du plan. En réponse, Eiko appuie son corps à la vitre de la cabine de douche comme elle s’appuierait à l’image elle-même. Le ruissellement de l’eau en souligne le grain, auquel Eiko se mélange ; voici donc la source du plaisir ».
Face à la moiteur et à la souplesse du toucher, Kijû Yoshida constate la froideur du regard. Dans une rencontre avec autrui on peut se dissoudre dans le toucher, dans la chaleur de la peau. Il y a une fluidité réciproque. En comparaison, le regard impose une vision bien plus froide dont le toucher est exclu. « L’impossible incarnation du regard, nous explique Yoshida, cette nature ascétique à l’excès qui l’empêche de s’intégrer à notre propre corps, sont précisément les raisons pour lesquelles voir est tout en état de cause indispensable à la connaissance. Bien sûr connaître, dans la mesure où il s’agit de connaître l’inconnu, ce qui encore nous échappe, présuppose l’hétérogénéité de son objet, mais aussi qu’une distance de cet écart a beau être évidente, nous répugnons semble-t-il à l’admettre ».
La rencontre chez Yoshida (cette « logique de la négation de soi ») croise le chemin d’un monde érotique. Un érotisme qui n’a strictement rien à voir avec le visuel pornographique présenté sur Internet. « Passer dans l’image, se donner comme image, ne veut pas dire forcément s’offrir au regard, de même que construire une image ne signifie pas soumettre le réel aux lois du visible, comme le prétend par exemple la pornographie. À l’approche d’autrui, se forme une image sans laquelle nulle rencontre n’est possible, mais qui, dans le même élan, dérobe ce qu’elle me donne à percevoir. Très concrètement, n’est-ce pas, dans l’amour, cette part qui toujours résiste à l’échange, qui jamais ne peut occuper l’espace qui me lie à l’être aimé ».
Matthieu Capel conclut en nous rappelant que l’érotisme prôné par les cinéastes japonais dans les années 60, comme contestation voire comme révolution d’un monde issu des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, va devenir une source de profit pour les grandes compagnies de cinéma. « L’érotique de Yoshida y résiste, comme elle résiste à l’anecdotique, parce qu’en elle s’énonce la question de l’histoire et sa transmission – parce qu’en elle s’énonce aussi nécessairement la question du politique ».
Suivent le texte de Shiguéhiko Hasumi (Kijû Yoshida, Ombres et Fictions) et celui de Kijû Yoshida, lui-même, (Un mouchoir dans le vent, la photo d’une star) qui démarre sur un passage superbe consacré à la jeunesse de Jean Renoir, lorsque celui-ci, accompagné de Gabrielle, sa nurse, voyait des films muets dans le Paris de la fin du XIXème siècle.
Orson Welles est à l’honneur dans Trafic 67. Tout d’abord, dans Macbeth et son dédale, un article de Youssef Ishaghpour qui évite le cliché "ranplanplan" d’un Welles comme homme de la Renaissance. Orson Welles est un Américain du XXème siècle. Il nous rappelle que « dans la lutte que le New Deal – dont Welles a été l’un des intellectuels les plus représentatifs – a menée contre ceux qu’on appelait "les barons brigands" ou les "royalistes économiques", à l’instar d’un Charles Foster Kane : l’impérialisme financier, dont les pratiques ont été la cause de la grande dépression économique mais aussi de la crise définitive des lumières en Occident ».
Revenons à la Renaissance, à la crise de l’harmonie qui se vit lors du changement de cap qui lui succède. « L’homme de la Renaissance qui, en réalisant sa grandeur, devenait le réceptacle de Dieu, et l’individualisme moderne qui se voudra cause de soi et souverain de l’être en rompant avec la transcendance, c’est dans ce temps que naît la subjectivité qui, dans l’entre-deux guerres, s’éprouve comme démesure et hybris. Macbeth, pour Welles, est la tragédie d’une rencontre impossible entre deux mondes devenus incompatibles.»
Belle analyse aussi de la différence entre classicisme et modernité. L’idéal du cinéma classique des années trente repose sur « la beauté des apparences » comme révolution du sens, de la clarté et de la simplicité de John Ford et Frank Capra. Orson Welles, avec Citizen Kane, « brise cet idéal par la mise en question de l’image de la réalité par la recherche du secret ».
D’où, comme l’a souligné, dès 1950, André Bazin, l'utilisation de la technique des grands angulaires, des plongées et contre-plongées et des angles de vision oblique. Le film de Welles est constitué comme un labyrinthe. « La construction de ses films, souligne Ishaghpour, ce sont des jeux de reflets qui créent le labyrinthe, et ce n’est pas un hasard s’il y a toujours, on le voit aussi dans Macbeth, un miroir au centre du labyrinthe. Dédale de contradictions, le labyrinthe a pour accessoire principal le miroir : lieu d’interrogation sur l’identité, dont la quête engendre la forme labyrinthique des œuvres. »
André Bazin signalait que le monde de Capra et de Ford se définit « à partir de leurs scénarios, de leurs thèmes, des effets dramatiques recherchés, du choix des scènes. Il n’est pas dans le découpage en tant que tel. Chez Orson Welles, au contraire, le découpage avec profondeur de champ devient une technique constitutive du sens du scénario. » (1)
Avec une analyse passionnante autour de la problématique de la tragédie et du désir du pouvoir absolu par Orson Welles lui-même du Dr Faustus de Marlowe et du Macbeth de Shakespeare, possédé par ces monarques absolus, ces tyrans ou ces "citizens", chefs d'entreprise.
Suit La lettre volée, l'article de Jonathan Rosenbaum à propos de F for fake d’Orson Welles, dont Lotte Eisner disait qu’il ne ressemblait pas beaucoup à du Welles. Réflexion confirmée par l’auteur lui-même expliquant à Bill Krohn « qu’il a évité tout plan qui aurait pu être considéré comme typiquement welsien.»
Au départ, le film co-réalisé par François Reichenbach s’appelait Question Mark (Point d’interrogation) avant de devenir F for fake (Vérité et mensonge), scénarisé par Olga Palinkas (le vrai nom de la sublime Oja Kodar). En traitant de l’imposture en matière d’art, Welles veut créer un « nouveau genre de cinéma ». Orson, en cape de magicien, une pièce de monnaie qu’il fait disparaître et reparaître entre les doigts d’une main face à un petit garçon, annonce : « Tout ce que vous verrez dans l’heure qui suit est absolument vrai », ce qui est faux, of course. Portrait gigogne du vrai et du faux dans l’art. Qu’est-ce que la vérité, qu’est-ce que le mensonge ? Allez savoir ! La fille que Picasso reluque, la belle Oja Kodar, n’est autre que sa sœur qui porte la même robe. Welles n’hésite pas ici à faire étalage de la beauté et du sex-appeal d’Oja Kodar (on n’a jamais vu cela chez Orson, pas même avec Rita Hayworth dans The Lady from Shanghai).
Séquence-clé pour Jonathan Rosenbaum : « Etant donné la tactique de cache-cache élaborée de toute la séquence – comme une mosaïque en quasi perpétuelle fragmentation – il va s’en dire que deux plans très brefs prétendant révéler ce que nombre d’angles de prises de vues précédents nous avaient dissimulés peuvent aisément nous tromper en cachant l’évidence juste sous nos yeux, exactement comme dans La Lettre volée d’Edgar Allan Poe »…qui a fait le bonheur du séminaire d’un certain Jacques Lacan.
Autres articles sur André Bazin de Dudley Andrew et Roger Leenhardt ainsi que Johnnie To par Alain Gester, à suivre, le mois prochain.
(1) Orson Welles d’André Bazin, éditions Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma.
Dans la préface de François Truffaut, succédant à celle d’André S. Labarthe, Truffaut donc nous rappelle que selon Pauline Kael, « le célèbre "rosebud" serait le seul élément du scénario de Citizen Kane dont Mankiewicz et Welles refusent d’endosser la paternité (…) si décidément personne ne s’en empare qu’on fasse courir le bruit : Il paraît que c’est Truffaut qui a inventé "rosebud", je m’engage à ne pas démentir ».
Trafic 67, Automne 2008
.