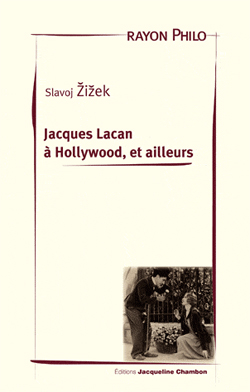Holly quoi ? Hollywood Žižekisée
Prologue
Slavoj Žižek, ayant étudié la philo à Paris (Université de Paris VIII) a survécu face à l'écran des salles de cinéma du quartier latin, pour nous faire sourire, grâce aux films, et mieux encore pour nous faire éclater de rire. Véritable « bombe à fragmentation », le philosophe slovène, professeur à Ljubljana, Columbia et Princeton, vient de sortir, en français, l'un de ses aérolites favoris : Jacques Lacan à Hollywood et ailleurs.
Après Lacrimae rerum (Kieslowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch) cet insaisissable trublion se sert de Lacan pour nous parler du cinéma, ou l'inverse (lorsqu'il nous signale, par exemple, la nature illusoire de la réalité, cette grimace du réel, comme nous disait Lacan). Découvrons donc des parcelles de ce que ce boulimique du cinéma nous conte avec son style hégélien imparable, (trois versions possibles - la thèse, l'antithèse et la synthèse).
Charlie et la cinématographie
City Lights, Les lumières de la ville de Charlie Chaplin, est une sorte d'hommage au rôle du go-between. Le vagabond y figure dans une interposition entre la jeune aveugle qui vend des fleurs et un homme riche (prince charmant dans les rêves de la jeune fille pauvre). Le vagabond va occuper une place qui n'est pas la sienne, car il permet à la jeune fille, avec de l'argent volé, de faire l'opération qui lui rendra la vue. L'invisible vagabond est donc un homme riche pour la jeune femme, voyante devenue, désormais à la tête d'un commerce de fleurs florissant et à la recherche de son riche prince charmant inexistant si ce n'est dans l'écran de ses fantasmes. Comme le souligne Žižek, il s'agit de l'une des belles idées de Chaplin d'avoir compris que l'homme riche ne pouvait exister que dans les rêves de la jeune fille, être un prétendant fantasmatique comme concurrent pour le pauvre vagabond (il est aussi invisible pour le spectateur que pour elle). Žižek cite cette belle phrase de Deleuze, qui nous éclaire sur la spécificité du cinéma par rapport au visuel : « Ce que le cinéma doit saisir, ce n'est pas l'identité d'un des personnages, réel ou fictif, à travers ses aspects objectifs et subjectifs. C'est le devenir du personnage réel quand il se met lui-même à fictionner, quand il entre en flagrant délit de légender. » (1)
Tout ce que la jeune femme connaît de son prince charmant est sa voix et son toucher. Elle ne peut, fidèle à son désir, qu'ignorer le ridicule vagabond. Au moment où, par compassion, elle lui glisse une pièce de monnaie dans la main, le toucher lui fait découvrir instantanément son vrai prince (2). Žižek met en avant l'importance de ce dialogue final dans le silence complet : « Nous lisons les mots prononcés sur des placards qui s'interposent entre les images comme dans les muets ». Ce qui explique mieux la décision de Chaplin « de produire un muet à l'heure du parlant, car l'efficacité globale de la séquence est due au fait que nous – spectateurs – savons que les films sont déjà parlants et faisons donc l'expérience de ce silence comme absence de voix ».
L'éthique de Stromboli
Tout d'abord, le miracle de la rencontre entre Roberto Rossellini et Ingrid Bergman illustre, à merveille, l'idée qu'une lettre arrive toujours à sa destination.
Ingrid Bergman découvre, par hasard, dans un petit cinéma new-yorkais, Rome, ville ouverte et Païsa de Rossellini. Troublée par ces deux chefs-d'oeuvre néoréalistes de Roberto R., elle lui écrit une lettre témoignant que « l'histoire d'amour débuta avant même le premier échange de regards ». Elle lui propose de jouer n'importe quel rôle puisqu'elle parle Anglais, un peu Allemand et très peu Italien, seulement deux mots : « Ti amo ». Cette lettre reste, sans être ouverte, dans les bureaux du studio qui subit un incendie. En fouillant les décombres, les employés la retrouvent et téléphonent à Rossellini, qui, alors en conflit avec le studio, leur raccroche au nez. Lorsque, enfin, la lettre lui parvient, il envoie, rapido presto, un télégramme à Ingrid Bergman.
Le premier des films du couple Rossellini/Bergman est Stromboli. L'histoire de Karin, émigrée estonienne se retrouvant, après la guerre 1940-1945, dans un camp de réfugiés, sur l'île volcanique de Stromboli, en Italie. Karin désire émigrer en Argentine, mais n'obtient pas de visa. Désespérée, elle se marie à un pauvre pêcheur en espérant échapper au camp, et tombe dans un autre désespoir parmi une société au comportement patriarcal et archaïque, autrement dit une nouvelle vie aussi sombre que la précédente. Elle fuit le village, mais en pleine ascension du volcan, la fumée et les vapeurs qui s'en échappent l'intoxiquent et elle s'effondre. « Face à la puissance primordiale du volcan, indique Žižek, l'ensemble des réflexes sociaux se volatilise dans l'insignifiance, elle se voit réduite à son pur « être-là » : fuyant l'oppressante réalité sociale, elle rencontre quelque chose d'incomparablement plus horrifique, le réel ». Autrement dit la réalité est construite symboliquement et devient inconsistante par rapport au trauma du réel. D'où la réflexion de Žižek : « Karin, dans Stromboli, naît deux fois : en faisant l'expérience de l'horreur en regard de laquelle la misère de la communauté îlienne fait pâle figure – la vie des pêcheurs se voit ainsi exposée dans toute sa nudité ».
La fin de la version américaine, diffusée par la RKO, diffère de celle que Rossellini a présentée en Europe. Karin made in USA se relève le lendemain matin, redescend au village. En voix-off, on entend que, grâce à Dieu, Karin va « retrouver la paix qu'elle espérait en retournant au village ». Version Rossellini, Karin répète, hors champ, « Mon Dieu ». Retournera-t-elle au village ? Rossellini a toujours dit : « Je ne sais pas. Ce serait le début d'un autre film ». « L'acte réalisé, nous dit Žižek, (ou pour le dire de manière plus pertinente : enduré) par Karin est celui du suicide symbolique : un acte consistant « à tout perdre », à se retirer de la réalité symbolique, un acte qui nous permet de repartir à nouveau du « point zéro ».
Le leurre de la femme fatale dans l'univers noir
Žižek constate que les écrits consacrés au film noir ne sont, le plus souvent, que des variations stéréotypées concernant le style visuel de ce genre de cinéma (expressionnisme, angles de vues originaux, ombre et lumière du noir et blanc). N'oublions donc pas la chaîne causale, « c'est-à-dire que la vision existentielle de l'individu dépend de l'expérience historique collective (qui dans le cas du film noir, coïncide avec ce référent historique que Deleuze évoquait comme l'arrière-plan du glissement conduisant de « l'image-mouvement » à « l'image-temps »(3). Et puis, il y a la femme, la femme fatale, comme nulle part ailleurs dans le cinéma.
Bien, bien mais comment au juste : comme écran, miroir, leurre ?
À la fin de The Maltese Falcon (Le Faucon maltais) de John Huston d'après un roman noir de Dashiel Hammet, la confrontation entre Sam Spade et Brigid O'Shaughnessy se termine par la chute de celle-ci, véritable stéréotype du démon de la femme fatale. « Dans l'univers noir, se demande Žižek, le mal n'est-il pas incarné par la femme fatale qui représente la menace (…) L'axe de l'univers du film noir ne doit-il pas être recherché, par conséquent, dans la relation du détective mâle à la femme en tant que symptôme ? » De quoi au juste ? La femme fatale ne serait-elle qu'un appât ?
« La femme fatale, poursuit Žižek, n'est qu'un leurre dont la présence fascinante masque le véritable axe traumatique de l'univers noir, la relation au père obscène, c'est-à-dire, le défaut de la métaphore paternelle » ; autrement dit, le père primordial, cruel à l'extrême, maître absolu, obscène parce que tout puissant, escroc, imposteur, qui oblige le fils à se retirer dans la pureté ascète.
Plus explicitement, on le découvre, traité comme tel, dans Apocalypse Now par Kurtz (Marlon Brando) d'après le livre de Joseph Conrad, Au coeur des ténèbres (du même auteur, voir Mister Brown dans Lord Jim ou encore le père de Magnus Pym dans Un Pur espion de John Le Carré).
Après les innombrables remakes des films noirs dans un blabla devenu habituel (l'épisode de la répétition au second degré de la post-modernité) nous avons eu, oh surprise, une innovation avec Twin Peaks. De Sam Spade, nous sommes passés au Dale Cooper de David Lynch. La première moitié de la série joue avec des variations sur les thèmes habituels de l'univers noir : le dévoilement de la corruption sous l'apparence idyllique d'une petite ville. La seconde nous fait découvrir que l'assassin de Laura Palmer est son père, instrument inconscient de « Bob », sorte d'esprit maléfique qui demeure dans la « Red Lodge ». Face au mal (Bob), le bien est incarné par Saint Cooper, un prophète rêveur.
« En résumé, souligne Žižek, la logique consistant à dévoiler la corruption cachée sous la surface idyllique ne fonctionne plus, puisque la corruption est déjà partie intégrante de cette idyllique vie quotidienne. Seule, en conséquence, une intervention faite d'une pure et sainte innocence (Cooper), dont la contrepartie ne peut être alors un mal ordinaire, social, mais un mal « surnaturel » externalisé, est à même de réellement perturber le circuit normal ».
« Bob » et Cooper, son corollaire asymétrique, sont nés pour une série de 30 épisodes (2 de 90 minutes et 28 de 45 minutes).
On y trouve encore d'autres réflexions sur les différents films de Chaplin, Rossellini, sur le remake d'Hitchcock par Van Sant (Psycho) et la méprise de Matrix sur le grand Autre (l'ordre social), mais on vous les laisse lire pas à pas (petit à petit, l'oiseau fait son nid).
(1) in L'Image-Temps, p. 196-197, éditions de Minuit.
(2) Luce Irigaray, autre lacanienne intrépide, nous a signalé que le toucher était féminin et le regard masculin in Ce sexe qui n'en est pas un, éd. De Minuit.
(3) Rappelons les propos de Gilles Deleuze sur le passage de « l'image-mouvement » à « l'image-temps » à la suite de la seconde Guerre Mondiale qui a déchiré le lien entre l'homme et le monde détruit par la Shoah et Hiroshima) et ses rêves d'une société fraternelle. On a pu croire que les ambitions libératrices du cinéma feraient en sorte que les populations seraient responsables de leur propre Histoire. Or, le cinéma va contribuer à leur assainissement à travers la propagande d'état, les mises en scènes politiques (Hitler et Staline). Comme le souligneront Serge Daney et Paul Virilio, la mise en scène de la guerre économique (phase dure ou soft) exhibe des leurres (le visuel) pour fasciner les populations et éviter qu'elles ne progressent dans leur rêve d'émancipation.
Jacques Lacan à Hollywood et ailleurs de Slavoj Žižek, éditions Jacqueline Chambon/Actes Sud