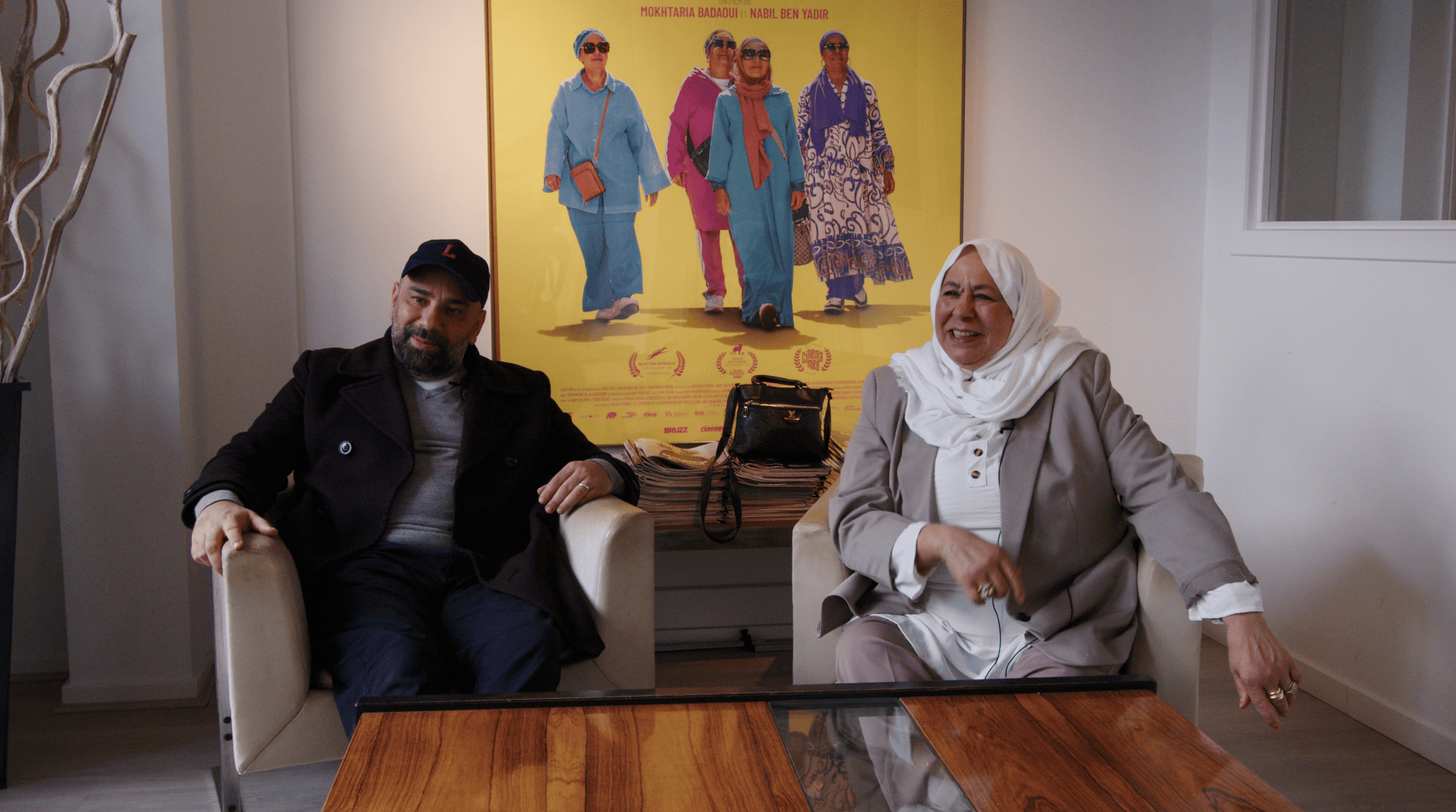Depuis l’aube du siècle Serge Meurant anime le festival Filmer à tout prix que la regrettée Micheline Créteur a animé pendant deux décennies. Nous avons demandé à Serge Meurant de faire le bilan de la situation du documentaire à l’heure ou celui-ci vit le paradoxe de ne plus intéresser une télévision happée par la spirale infernale du formatage (c’est quoi au juste la ménagère de plus de cinquante ans qui intéresse tant les publicitaires : un fantasme ou une icône ?) mais de susciter l’intérêt des spectateurs de salles de cinéma. D’autant que celles-ci équipées d’un projecteur numérique sont à même de diffuser des films qui n’ont plus besoin du kinescopage en 35mm.
Entrevue avec Serge Meurant à propos de Filmer à Tout Prix

Cinergie : Quel bilan tires-tu du récent festival Filmer à tout prix ?
Serge Meurant : C’est un bilan diversifié. Tous les films que nous avons programmés, qu’ils soient belges ou étrangers, sont tous des films animés par un désir de cinéma et pas de télévision, présentant des qualités d’écriture et d’invention d’écriture. Ce que l’on constate, c’est que la fragilité de ces films s’amplifie, qu’elle soit financière ou de fabrication.
C. : La télévision impose-t-elle son formatage au film ?
S. M. : C’est certain. Je constate aussi -mais c’est le passage du temps – que les grandes figures comme Johan Van der Keuken, Frank Wiseman, qui ont marqué le documentaire d’une façon radicalement autre, ont disparus ou sont sur le point de disparaître. Et que la relève de ces cinéastes-là, doit encore faire ses preuves et s’affirmer. Bien sûr on commence à avoir des cinéastes tels que Claire Simon, Nicolas Philibert mais c’est grâce à ces figures tutélaires qu’ils ont pu s’orienter. Ces aînés ont capté et saisi tellement de choses, montré un tel univers qu’après eux on a l’impression d’être devant des fragments et des essais. Trois prix sur quatre qui se sont inscrits au Palmarès du festival ont été fait sans l’aide de la télévision. On a l’impression, aujourd’hui, en Communauté française, depuis deux ans environ que les documentaires se font avec beaucoup plus de difficultés, beaucoup moins d’argent. Cela se reflète dans la manière de filmer. Cela signifie que sur les 200 films belges que nous avons visionnés en deux ans, on en a retenu 25. Pour cette édition plus que pour les autres on a favorisé la dimension de l’essai. C’est-à-dire d’une réflexion dans l’acte de filmer qui, même si elle n’aboutit pas à des formes parfaites ouvre sur de la curiosité, de l’inconnu, sur de nouvelles choses.
C. : Quel est ton avis sur cet essai de favoriser le singulier ?
S. M. : Il faut établir un rapport entre ce qui existe à l’étranger et les films de notre communauté. C’est la raison pour laquelle on a voulu montrer 10 films de l’Ecole de Cinéma de Munich pour offrir des exemples aux cinéastes qui sortent de nos écoles ou y sont encore. Par exemple à Munich, lorsqu’on demande, en première année de filmer sur pellicule et en noir et blanc on arrive à des œuvres intéressantes parce qu’il y a à la fois ce qui relève d’une solidité de construction et du poétique. Cela peut inspirer nos écoles. De même que le parcours d’un auteur comme Sergueï Lonitza qui a assimilé aussi bien le cinéma russe que le cinéma européen.
C. : Que penses-tu du rôle croissant des sorties en salles de documentaires ?
S. M. : L’accès aux salles est né de la frustration des gens qui aiment le cinéma. Ils ont envie de voir autre chose que ce que leur présente la télévision, des films documentaires ayant les mêmes qualités qu’un film de fiction. C’est-à-dire, avec un regard, avec des propositions avec des transgressions, etc. Sans compter le plaisir de consacrer un temps qui ne s’inscrit pas dans le flux télévisuel pour découvrir des choses et pouvoir y réfléchir ensuite. J’ai lu ce matin dans Le Monde une réflexion sur la télé de Breton qui vient de publier un essai chez Grasset. La voici : « La télé ne parle pas de réel, elle prétend seulement le laisser parler. La télé nous fait entendre une parole vraie qui n’est dite par personne. Elle nous fait croire à l’existence d’une parole sans sujet. La télé n’est pas hégémonique par ce qu’elle dit mais par la manière dont elle montre ce qu’elle dit ». Cette absence de sujet dans les reportages TV est peut-être justement ce qui définit le type de documentaire que nous défendons par rapport à la conception qu’en a la télévision. C’est-à-dire ce qui relève des relations entre la parole et le discours. Je pense que les films doivent relever de la parole et du singulier. À partir de là être tourné vers l’autre et acquérir son universalité à partir de cette parole singulière. S’il n’y a personne qui parle, devant quoi nous trouvons-nous ? On nous fait voir beaucoup de choses mais il s’agit d’un décor vide.
C. : Cela fait penser à MacLuhan : Le message est le médium. L’emballage prime sur le contenu. Il n’est pas sûr que la télé soit l’avenir du documentaire ou même du cinéma, hormis quelques chaînes singulières. Lorsqu’on voit le succès en salles de films comme Arbres de Roudil et Bruneau, Etre et avoir de Philibert, on peut se dire que le documentaire peut trouver un public qui déborde celui des cinéphiles.
S. M. J’écris de la poésie. Je sais que ce n’est pas un genre qui produit un best-seller. Est-ce que pour autant j’en apprécierai moins la poésie et que je vais cesser d’écrire. Non. Il y aurait deux catégories d’images. Celles qu’on ne veut plus voir, celles de la guerre ou de violences véhiculées par l’actualité. Et, à côté de cela, il faudrait dans le domaine du documentaire des images apaisantes d’une vie qui puisse servir de modèle pour concentrer la bienveillance de l’audimat. C’est dans ce paradoxe que nous nous trouvons. Nous ne voulons pas nous trouver face au réel sauf lorsque ce réel est déjà passé par le filtre de formes usées, d’un discours sur le monde plutôt que d’un regard sur le monde. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les gens vont voir des documentaires qui montrent autre chose. Des films où il y a à la fois, un auteur, une expérience du cinéma.
C. : Quel est la place de la technologie numérique dans le documentaire ? Est-ce que c’est une autre manière de filmer, voire un handicap par rapport au support de la pellicule?
S. M. : La plupart du temps on utilise le numérique pour des raisons économiques. De toute manière il y a toujours eu des réalisateurs qui pratiquaient un cinéma de mobilité comme Johan Van de Keuken et cela dans des formats différents, ce qui donnait quelque chose d’assez unique. Peut-être n’a-t-on pas exploré toute les possibilités du numérique et que le résultat actuel est parfois pauvre. On est a mi-chemin.
C. : Quelle a été la tendance de l’édition 2004 par rapports aux éditions antérieures ?
S. M. : Il me semble que la transmission entre Van der Keuken, Kramer ou Wiseman s’est opérée pas toujours en ligne droite mais plutôt par capillarité. La question du respect de l’autre qui était centrale chez les aînés est restée centrale dans le cinéma documentaire d’aujourd’hui. De même on a été très sensible au fait que les réalisateurs n’hésitent pas à se remettre eux-mêmes en question à travers une pratique. Cela permet de penser que nous n’étions ni dans la superficialité ni dans la secte parce que c’est ce qu’il y a de plus universel dans le cinéma documentaire.