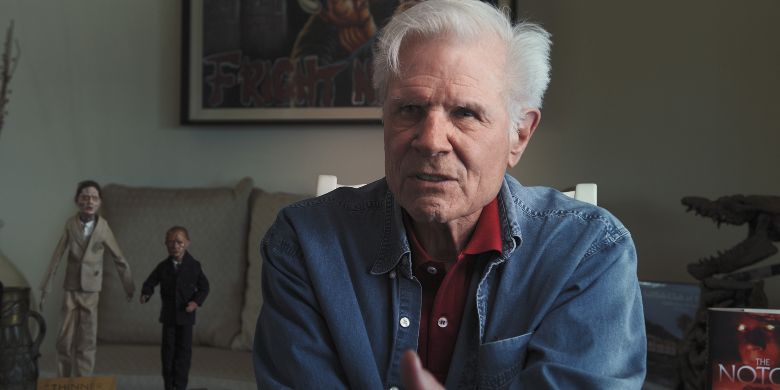Hail to the King!
Évoquer les adaptations de Stephen King au cinéma et à la télévision en 1h45 n’est pas une mince affaire, mais c’est le défi que s’est lancé la documentariste belge Daphné Baiwir (Deauville et le Rêve américain, Olivia De Havilland, l’insoumise). Depuis la sortie en 1976 de Carrie, de Brian De Palma, sublime adaptation du premier roman du natif du Maine, King a vu ses œuvres adaptées à 90 reprises (cinéma, téléfilms, séries), sans compter une bonne vingtaine de projets déjà annoncés et à divers stades de production. Depuis 1974, cet écrivain particulièrement prolifique a publié 67 romans (dont bon nombre sont des pavés de 1 500 pages), 10 recueils de nouvelles, plusieurs essais, et signé lui-même une vingtaine de scénarios. Alors, par où commencer?