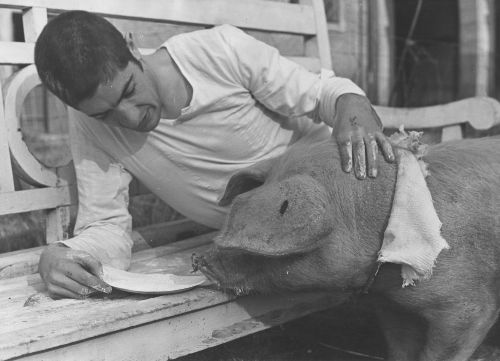Canines acérées. Pâleur cristalline. Sourire carnassier. Cape au vent. Depuis sa naissance, le 7e art flirte avec cette créature de la nuit, qu’est le vampire.
Le Vampire au cinéma : reflet d’une époque

Comme le rappelle l’auteur K.M. Schmidt, à l’aube du nouveau millénaire, pas moins de 650 films sur les vampires hantent déjà l’histoire du cinéma, et notamment celui de la Belgique. Depuis, les XXe et XXIe siècles n’ont pas été en reste avec une accélération significative ces dernières années, notamment du côté des États-Unis qui, avec des films comme Rendfield (2023) de Chris McKay, Morbius (2022) de Daniel Espinosa et le futur remake de Nosferatu (2024) par Robert Eggers, n’en démordent pas. Des grosses productions, surtout, même si le cinéma d’auteur s’est également réapproprié l’immonde créature. Le Vourdalak (2023) de Adrien Beau et Marinaleda (2023) de Louis Séguin pour la France. El Conde (2023) de Pablo Larraín pour le Chili. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (2023) d’Ariane Louis-Seize. Côté dents pointues, la Belgique n’est pas en reste. En attendant la nuit (2024), le récent film vampirique de Céline Rouzet en est la preuve. Mais tout en s’inscrivant dans la longue tradition des buveurs de sang, il tend aussi à renouveler le genre, à moderniser le mythe, à broder une nouvelle légende : celle d’un vampire à notre image, plus victime que coupable.
Une nouveauté dans la présentation d’un monstre de cinéma qui, adossé à la recrudescence des films vampiriques, donne envie d’en savoir plus sur cette figure de monstre sanguinaire. Et si sa transformation dans le temps avait un quelconque lien avec une société en constante évolution ? Et si le vampire était une métaphore politique et sociale, exutoire de nos craintes et de nos passions ? Et si le vampire n’était finalement, et paradoxalement, que notre reflet dans le miroir ?
Une créature d’un autre temps...
Bête immonde et cruelle, le vampire n’a pas attendu les frères Lumières pour imposer son ombre à la culture humaine. S’il aura fallu attendre 1752 pour voir apparaître le terme de vampire en France dans le dictionnaire de Trévoux, la chauve-souris habite les cauchemars de l’humanité depuis ses prémices. Comme l’explique le médiéviste Claude Lecouteux, le vampire que l’on connaît actuellement s’est nourri d’une multitude de récits et de peurs millénaires. Cette créature morte-vivante emprunte ainsi autant aux démons, en tant que cousin de la strige, qu’au revenant ancêtre du zombie.
Puis, la littérature de la vieille Europe s’est nourrie de ces contes passés de bouche à oreille. Les premiers poèmes de Heinrich en 1748, La Fiancée de Corinthe de Goethe en 1797 jusqu’au texte fondateur de John William Polidori en 1810 sobrement intitulé Le Vampire, ouvrent la porte à une fascination pour cet être reclus et blafard. Puis, Théophile Gautier, Paul Féval, Tolstoï, et bien sûr Le Fanu et Bram Stoker donnent à cet être de sang ses lettres de noblesse, jusqu’à ce que le cinéma se saisisse de ce mythe ailé. Des expérimentations de George Méliès avec Le Manoir du Diable (1896), au Vampire féministe de Alice Guy (1920), sans oublier l’expressionniste Nosferatu (1922) de Murnau, le 7e art s’est approprié la créature pour à jamais changer son aspect.
D’abord miséreux et issu de la plèbe, le vampire monte alors peu à peu en grade en s’immisçant sur grand écran. D’un physique ingrat, gonflé et rougeaud, gorgé de sang, il tend peu à peu vers des traits plus saillants avec l’entrée en scène dès 1921 du Comte Dracula. D’abord dans le film Drakula halala de Karoly Lajthay, il passera ensuite de main en main avant de trouver sa forme parfaite devant la caméra d’un certain Francis Ford Coppola dans Dracula (1992). Amaigri, pâle, enfermé dans un cercueil le jour pour fuir les rayons du soleil qui le terrassent, il se terre dans des territoires isolés. De belles demeures calfeutrées, des forêts ou les branches prennent en tenaille la lumière du jour. Le vampire déploie ses ailes la nuit, durant laquelle il dépèce les êtres humains. Quasi insensible, notamment au temps qui passe, le vampire possède aussi çà et là, en fonction des cultures, des lieux et des époques, des pouvoirs de séduction ou de manipulation. Mais aussi une capacité qui rappelle le loup-garou : celle de prendre la forme d’animaux.
Souvent représenté sous les traits d’un homme, il se fait aussi parfois femme, notamment dans le film franco-germano-belge Les Lèvres rouges de Harry Kümel (1971). Tout droit inspiré de la tyrannique et sanguinaire comtesse Elisabeth Báthory, pendant féminin de Dracula, arpente les ruelles de Bruges, Bruxelles, Meise et Ostende, faisant du plat pays le terrain de ses méfaits de buveuse de sang.
Pour se protéger de cette créature caractéristique du cinéma gothique, des répulsifs existent. Ail, rosier sauvage, crucifix. À l’image de certains insectes volants finalement, le vampire n’aime pas les odeurs trop puissantes. Ces créatures, de par leur lien avec le Malin, seraient aussi repoussées par des objets sacrés comme les crucifix et autres chapelets. Quand on vous dit que les démons à l’image de celui de L’Exorciste (1973) de William Friedkin ont des liens avec Dracula.
Il est aussi reconnu que pour qu’un vampire puisse entrer chez vous, il faut l’y inviter. Comme dans Salem de Stephen King, adapté en 1979 par Tobe Hooper (Massacre à la Tronçonneuse) sous le nom Les Vampires de Salem et plus récemment par Gary Dauberman et James Wan (le film n’est pas encore sorti) sous le nom de Salem’s Lot, il n’est pas franchement recommandé d’ouvrir une fois la nuit tombée.
Si la protection n’est pas une fin en soi, il reste toujours possible de prendre la vie d’un vampire, même si ce dernier est déjà mort… Pour ce faire, il est possible de décapiter le vampire ou de lui tirer une balle en argent. La solution la plus efficace reste selon le traité de vampirologie de Calmet de planter un pieu dans le cœur de l’immondice comme dans la version de 1964 de Je suis une légende signée de la main de Ubaldo Ragona et Sidney Salkow.
Un monstre qui semble plus que jamais inscrit dans le panthéon européen des bêtes cauchemardesques. Pourtant, dans le même temps, le vampire d’une époque à l’autre, d’une région du monde à l’autre, change de forme. S’adapte, se fait reflet d’une époque, porteur de ses luttes sociales et politiques, miroir de ses peurs…
… à l’image de nos sociétés
Si au 18e siècle, la strige cousine du vampire effraie, dégoûte, cela n’a rien d’anodin. Au siècle des Lumières, où la rationalité tente de s’imposer dans les cours royales, l’obscurantisme est bien souvent encore l’explication dans les milieux populaires. Le vampire est cause de tous les maux. Il symbolise la maladie (un motif que reprendra la série The Strain de Guillermo Del Toro), tout autant que les peurs sociales (comme les tueurs en série) à une époque où la Terreur a fait des ravages. On se méfie de tout le monde, et cette peur prend la forme d’une créature nocturne.
Le Nosferatu de Murnau ne dit d’ailleurs pas autre chose. En 1922, alors que le fascisme s’installe en Italie et que l’Allemagne subit de plein fouet le Traité de Versailles, l'expressionnisme allemand transforme une impression de spoliation, de richesses sucées par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, un mal-être qui gonfle, en monstre. Le vampire est ici sombre, dénué de la moindre parole : il est une créature difforme et cruelle. Pas étonnant que dans la situation actuelle, où l’extrêmisation des discours se fait critique, de voir un cinéaste atmosphérique comme Robert Eggers redonner vie au monstre de Murnau.
De la plume de William Polidori, aux pamphlets de Voltaire, le vampire se fait aussi figure aristocratique contre laquelle il faut lutter. Pas étonnant alors que le Comte Dracula, qui prend vie dans de très nombreux films du 20e siècle, soit de la noblesse. Combattre Dracula, c’est se battre contre la vampirisation des richesses par les classes sociales dominantes.
Devant la caméra de Francis Ford Coppola, le vampire va aussi commencer à s’humaniser, en gagnant un supplément d’âme : il devient synonyme de fantasmes, de passion sensuelle, de pulsions sexuelles qui peuvent se révéler mortelles. Or, le Dracula de Coppola sort en 1992, dans un contexte post-libération des mœurs mais aussi après que le sida ait fait beaucoup de victimes. Le vampire exprime donc, avec une grande subtilité, ces deux dimensions très politiques.
Après la peur et le sexe, notre chasseur nocturne déclenche en nous une autre pulsion : celle du rire. Dans le contexte de la crise des subprimes de 2008, qui a sucé le sang de bon nombre de foyers, tout en laissant les marchés financiers libres de toute condamnation, les comédies vampiriques jouent un rôle cathartique. Mords-moi sans hésitation (2010) d’Aaraon Seltzer et Jason Friedberg, pastiche de Twilight,
Vampires en toute intimité (2014) de Taika Waititi et le très belge Vampires (2010) de Vincent Lannoo tournent en dérision la figure de cet être jusqu’alors synonyme de domination.
Dans le cinéma d’aujourd’hui, plus que jamais, la bête aux grandes dents quitte les châteaux ténébreux de Transylvanie pour s’intégrer dans les ambiances flottantes des banlieues résidentielles. Vient hanter la classe moyenne. Sous l’influence d’Anne Rice et des adaptations de son chef d’œuvre Entretien avec un vampire (un film de Neil Jordan en 1994, et une série TV sortie en 2022) tout autant que la saga Twilight, les vampires deviennent de véritables amants fidèles, héros romantiques beaux et courageux. Ils s’humanisent, deviennent plus moraux, mangent « bio » et dans le respect des humains.
Enfin, loin de la représentation de la tradition, d’une forme de pensée réactionnaire, le vampire est de plus en plus porteur d’un progressisme social. Féminin dans le film Grave de Julia Ducournau, adolescent et socialement mis à l’écart dans En attendant la nuit, issu d’une minorité dans la série Vampires sortie sur Netflix, le vampire est désormais la victime, celui dont la différence fait peur et que l’on rejette.
La figure mystique du vampire se fait alors, depuis tout temps et encore plus aujourd’hui, symbole. De nos peurs de l’autre : ce bouc émissaire qu’on finira par tuer, un pieu dans le cœur, pour catalyser la violence d’une société entière.
Mais promis, « Aucun humain n’a été maltraité » pour écrire cet article !