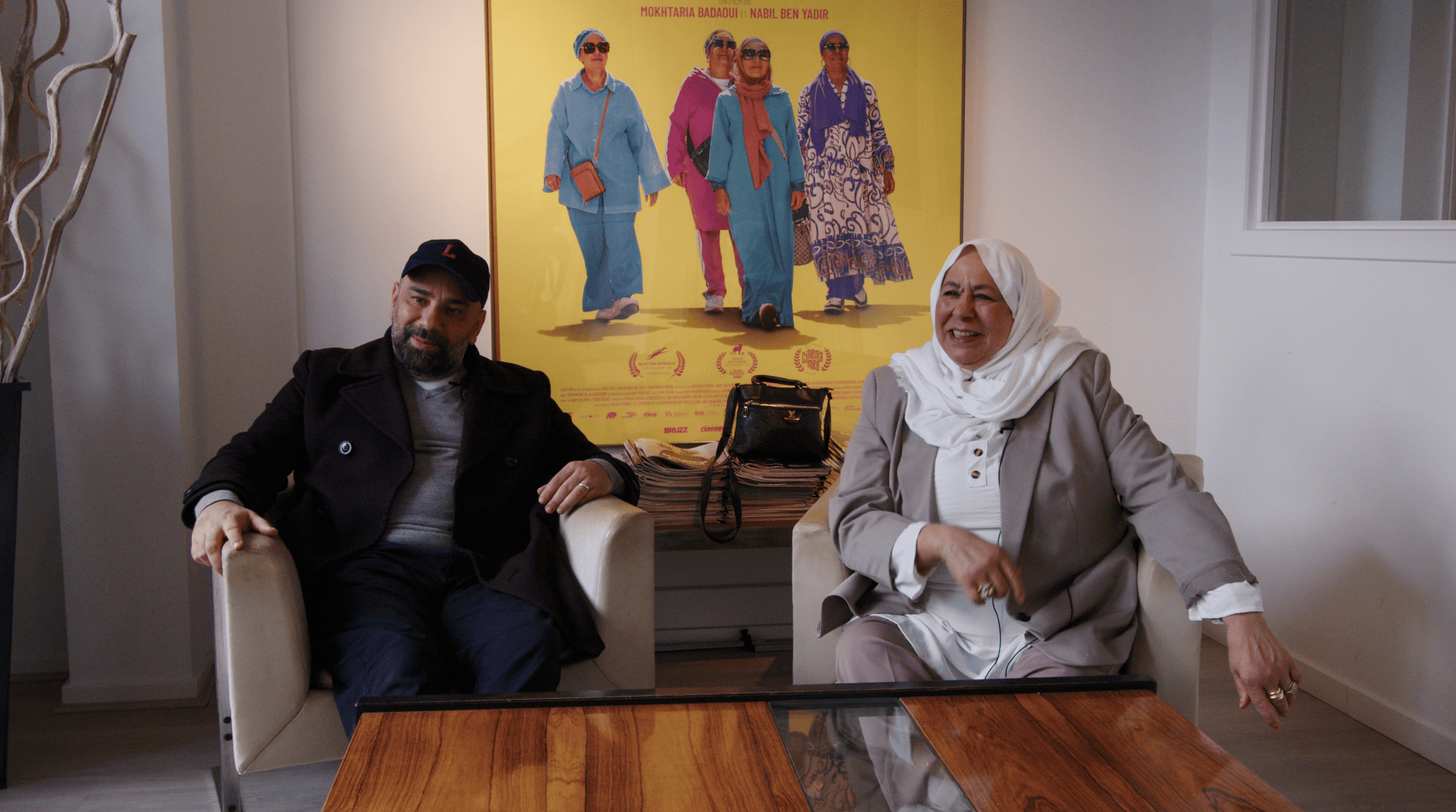Rétrospective du cinéma belge au 12e Festival CINEMATIK, à Piešťany, Slovaquie.
« La Belgique n’a aucun sens. La Belgique est absurde. La Belgique est incompréhensible. La Belgique est trop petite pour être si divisée et pourtant… elle l’est ! Mais tout ça n’a pas vraiment d’importance car c’est dans son manque ou sa recherche d’identité que le cinéma belge, flamand ou francophone, se construit, film par film. De toute façon, comme le disaient nos humoristes : "La Belgique est un plaisir et doit le rester". »