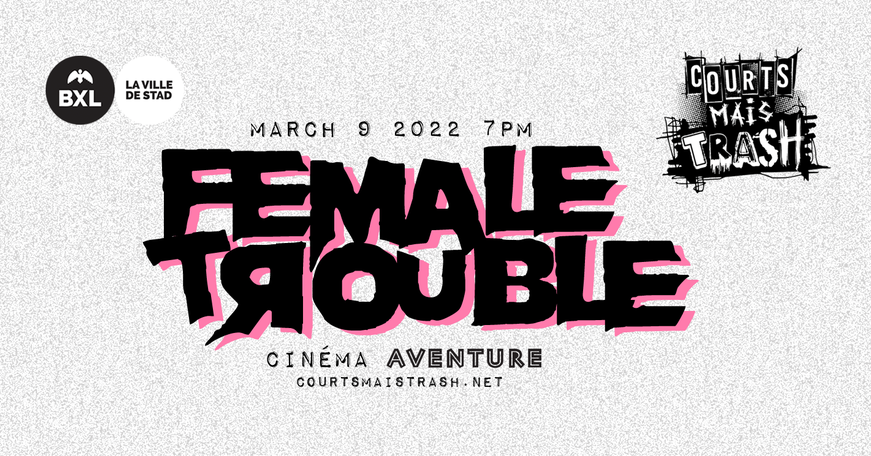Cinergie : Nous avons été séduits par la force de ton film dans lequel tu fais corps avec tes protagonistes, tu as pris des risques, tu as montré ton regard et ton point de vue sans vraiment prendre de recul.
Zoé Brichau : C’est en effet un film très proche, proche des gens avec qui j’étais et je pense que ce n’est pas grâce à moi mais grâce à ces protagonistes. C’est un hasard qu’on se soit trouvés. On s’est très bien entendu humainement, on s’est fait confiance et c’est cela qui a permis que tout cela sorte d’eux.
Je pense que ce sont aussi des personnes qui sont très conscientes de ce qu’elles vivent, très conscientes du cinéma. Par exemple, Claudia que je suis principalement pendant tout le film est une plus grande cinéphile que moi. Il y a énormément de rushes où je parle avec mes protagonistes. Je ne voulais pas être dans le montage du film parce que je ne trouvais pas ça intéressant du tout. On était ensemble tout le temps et cela leur a permis de comprendre ce dont j’avais vraiment besoin pour le film. Ils parlaient parfois de sujets juste pour que je les filme, ils savaient ce que j’attendais. Ce qui est drôle, c’est que ces passages n’apparaissent presque pas au montage. Le moment où Claudia parle de son frère en disant qu’elle l’aime sauf quand il est habillé en flic était une conversation qu’elle répétait pour que je la filme.
C. : Ce qu’ils t’ont dit en se mettant en scène, tu n’as pas voulu le prendre parce que ce n’était pas assez naturel ?
Z. B. : Non, ce n’est pas ça du tout. Je pense qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le film soit aussi personnel. Ce sont des personnes très engagées qui parlent beaucoup de politique et quand je suis rentrée, j’avais énormément de rushes. Je savais que je n’allais utiliser que 10% de cette matière filmée. J’avais besoin de filmer tout le temps mais je devais être tout le temps alerte comme je filmais sans stabilisateur, je devais aussi faire attention au son parce que j’étais toute seule. Ils parlaient aussi beaucoup de la situation politique chilienne. Par exemple, ils parlaient de personnes qui soi-disant se suicidaient alors que c’étaient des assassinats par la police, ils expliquaient comment c’était mis en scène. Je trouvais ça très intéressant mais je trouvais ça plus intéressant encore, et plus touchant, d’être proche de leur vie et de leur personne en tant que telle pour comprendre à quel point les inégalités qu’ils vivaient les poussaient à cette révolte-là. On voit qu’ils se battent dans leur quotidien.
On aurait pu faire un film tout à fait différent et cela les a étonnés que le film soit si personnel alors qu’ils m’ont demandé de filmer certaines scènes que je n’aurais pas filmées toute seule.
C. : Comment les as-tu rencontrés ?
Z. B. : J’ai rencontré ces personnes tout à fait par hasard. Je suis arrivée au Chili en collaboration avec l’Université de Valparaiso mais quand je suis arrivée, tout était en grève, tous les étudiants étaient dans la rue, la situation était chaotique. Je suis allée à Santiago chez un garçon que j’avais rencontré à une manifestation à Bruxelles par hasard. Là, j’ai suivi des danseurs et des musiciens que j’ai filmés et qui apparaissent au début du film. Après, je suis quand même allée à l’université parce que les étudiants faisaient un meeting pour s’organiser face à cette crise. J’ai vu Claudia parler et j’ai vu quelque chose d’intéressant en elle. Je voulais lui parler et j’ai su qu’elle avait besoin d’un ordinateur pour monter un film qu’elle était en train de faire. Du coup, je lui ai proposé d’utiliser le mien et dès le début je l’ai filmée. Ils ne connaissaient même pas mon nom que je les filmais déjà. Quelque chose de très naturel s’est passé.
C. : C’est ta manière de procéder habituellement ? La caméra, c’est ton troisième œil ?
Z. B. : C’est mon seul œil. Je pense que la caméra est une grande protection, je ne me rendais pas compte du danger dans lequel j’étais jusqu’à ce que j’arrête de filmer ou quand je regardais les rushes. Quand on regarde à travers la caméra, on regarde aussi la technique, on fait attention, on essaie de trouver ce qu’on cherche. Par exemple, dans la manifestation, je cherche les plans sans me rendre compte du danger dans lequel je suis.
C. : Dans les plans de la manifestation au début du film, on voit que tu es totalement dedans.
Z. B. : J’ai filmé énormément d’heures de manifestation. Jorge, un des personnages du film, est photographe et est allé filmer les personnes aux barricades, aux premières lignes. C’est très bien organisé : les gens qui sont en première ligne protègent les gens qui sont derrière pour qu’ils manifestent et soient en paix. Ils se battent avec les policiers avec des armes inégales et Jorge prenaient des photos d’eux. Je trouvais ça intéressant mais je ne voulais pas faire un film sur des gens qui caillassent des policiers parce que c’est complexe. Il y a trop de rage, de haine autour d’eux et on risque de les catégoriser. Je comprends les gens qui le font mais cela ne veut pas dire que je sois d’accord avec eux. Je comprends qu’à un moment un flic soit surmené et qu’il finisse par tirer. Ce n’est jamais tout blanc ou tout noir, il faut essayer de comprendre. Ce n’est pas LA police ou des manifestants qui caillassent, ce sont des individus qui sont pris dans une émulsion de groupe. Jorge m’a dit qu’il prenait des photos de ces gens mais qu’il était incapable de lancer une pierre. Même s’il avait vraiment la rage, il serait incapable de se pardonner si elle tombait sur la tête d’un policier qui aurait un problème à cause de lui. Claudia, dont le frère est policier, avait la rage contre lui aussi.
C. : Dans cette scène où tu les retrouves chez eux pendant laquelle vous avez une discussion politique, comment cela s’est passé avec la famille de Claudia ?
Z. B. : Rien de ce film n’a été préparé. J’étais toujours avec mes objectifs, mon son, mon casque et ma caméra et je parlais aux gens mais j’avais ce matériel en plus. J’étais très concentrée mais ça ne m’empêchait pas d’avoir des discussions ou d’intervenir. Chaque fois que Claudia me présentait à des gens elle disait que j’étais en train de filmer, que je faisais un documentaire pour la Belgique. Quand j’ai rencontré ses parents, je la suivais en sortant du métro, je suis arrivée dans la voiture où il y avait ses parents et je filmais déjà parce que je trouvais la scène belle. Donc, ce n’était pas préparé et je leur en suis très reconnaissante. Quand j’ai vécu cette scène avec les parents, j’avais la chair de poule. Je pense qu’on peut tous s’identifier dans cette scène parce qu’il y a un choc de générations. Ils ont vécu une époque différente, ils ont vécu la dictature, ils ont vécu Pinochet. J’ai parlé avec des gens qui me racontaient que quand ils ont vu les militaires sortir dans la rue, ils ont soit fondu en larmes soit ils ont eu une crise d’angoisse parce qu’ils se souvenaient de Pinochet et qu’ils voyaient des cadavres partout dans les rues. Pour les parents, on n’arrivera à rien en faisant cela, ils n’ont plus d’espoir. C’est pour ça que c’est bien aussi d’avoir l’avis des plus jeunes qui n’ont pas peur, qui pensent qu’ils peuvent changer les choses. Ils veulent essayer au risque de se faire tuer parce qu’il y en a beaucoup qui sont morts…
C. : As-tu eu des contacts avec des communautés chiliennes ici à Bruxelles ?
Z. B. : Pas trop. Quand on a commencé à monter le film, j’ai dû travailler sur des tournages pour l’INSAS, puis il y a eu le confinement.
Je ne suis pas vraiment restée en contact avec les gens du Chili parce que c’était très compliqué. Je devais revoir Claudia parce qu’elle voulait faire un autre documentaire mais c’était très difficile pour elle d’avoir des fonds. J’ai dû remplir des documents avec elle pendant une semaine pour qu’elle ait ces fonds. Après son court-métrage de fiction qui est magnifique, elle fait maintenant des documentaires particuliers, assez expérimentaux, qui me plaisent beaucoup.
Ce serait très intéressant d’avoir le point de vue de cette communauté chilienne mais il y a toujours le sentiment de ne pas être légitime pour parler de ça et de montrer ça à des expatriés. Je ne me sens peut-être pas encore prête pour contacter ces personnes maintenant. J’ai besoin de temps pour ce film que j’ai mis de côté pour me consacrer à d’autres projets, je vais peut-être travailler un peu sur la diffusion pour échanger avec ce public.
C. : Parle-nous de ton film de fiction de fin d'études.
Z. B. : J’ai réalisé dans mon film de fiction ce que j’avais en tête quand j’étais au Chili : raconter l’histoire d’un policier qui décide de désobéir. On était en confinement, je devais rendre un dossier pour la Commission. Réaliser ce film de fin d’études est la meilleure opportunité qu’on puisse avoir à l’INSAS mais je ne voulais pas le faire parce que je ne comprenais pas l’intérêt de faire un film de fiction à ce moment-là. J’avais envie de repartir dans un autre pays, de voir des gens, de voir des choses vraies, d’être dans l’action et de prendre des risques.
Pour un film de fiction, on risque son orgueil, son honneur alors que dans un documentaire, on a plus les mains dans la pâte. C’est en tout cas ce que je ressens maintenant. C’était très difficile pour moi d’écrire ce film, je ne pouvais pas aller dans les rues, dans les cafés pour observer les gens, m’inspirer, construire les personnages. J’ai fait beaucoup de recherches pour le personnage du policier mais finalement, c’est beaucoup venu de mon esprit donc je trouve que ce personnage me ressemble beaucoup. J’ai décidé de faire des choix pour ce film comme tourner en pellicule pour me mettre des contraintes pour m’amuser. Je trouve que la fiction est trop clean et pas assez sale. Au départ, je voulais que ce soit très brut et c’est pour ça que j’avais choisi le côté rugueux de la pellicule. Mais on travaille tellement que finalement c’est parfait et je déteste ça. Je pense qu’on a réussi à expérimenter beaucoup de choses au montage et au tournage aussi et je suis très heureuse de la manière dont on a travaillé sur ce film.
C. : C’est quand même étonnant que tu aies fait un film sur un policier alors que le frère de Claudia l'est.
Z. B. : Son père l'était aussi. Au Chili, quand on est policier, on vous fait croire que vous avez plein d’avantages. Il existe un hôpital rien que pour les policiers. On pense qu’il est meilleur mais les médecins sont tout aussi débordés et n’ont pas beaucoup plus de moyens. On leur fait croire qu’ils auront une meilleure retraite, qu’ils seront reconnus dans la société alors que c’est complètement faux. Ce n’est pas très bien expliqué dans le film mais le père de Claudia a eu aussi un AVC et il n’a pas eu beaucoup d’aide de la part de la police ni du gouvernement. Pour Claudia, ce qui était dur, c’est qu’elle était en train de se battre pour ses droits à Valparaiso et elle savait que son frère tirait sur des gens à Santiago. Parfois, elle allait manifester à Santiago et elle en angoissait mais elle en riait aussi. Il y a énormément d’amour entre eux, un amour très compliqué surtout qu’ils ont une grande différence d’âge.
Je ne suis pas allée au Chili avec l’idée de filmer un policier. C’est quand je suis arrivée sur place que j’ai été interloquée par leur attitude. Certains prenaient de la pasta, une forme de coke, avant les interventions. C’étaient vraiment des chiens de garde qu’on excitait. Ils tiraient sur les gens mais ils se retrouvaient à 20 devant des foules de plus de milliers de personnes.
Avant de partir au Chili, je ne sais pas si je me considérais comme féministe, j’estimais que les choses évoluaient dans la bonne direction mais au Chili, j’ai changé d’avis. Les gens ne me laissaient pas rentrer seule et me disaient que si je croisais des flics, ils pourraient m’embarquer et ce n’était pas faux. J’ai vu beaucoup de filles qui se faisaient violer ou torturer par des policiers.
Les policiers aspergent les manifestants d’un liquide qui brûle. Un jour, j’ai été aspergée, je suis entrée dans une maison et je me suis rendu compte que tout me brûlait et que le seul endroit épargné, c’était ma caméra. Les gens avec qui j’étais m’ont raconté que leurs amis avaient été torturés. C’est connu qu’il y a encore une culture de la dictature. C’est pour cela qu’ils manifestent, ils veulent changer la Constitution qui avait été faite sous Pinochet car ils trouvaient ça aberrant d’être toujours sous cette Constitution et ils l’ont obtenu, c’est une petite victoire quand même.
C. : Qu’en est-il de la situation sur place maintenant ?
Z. B. : Je sais que le confinement a été très dur parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Du coup, beaucoup de gens ne pouvaient plus aller travailler et n’avaient plus d’argent. C’était déjà le cas avant parce que le Chili est un pays néocapitaliste par excellence où on s’endette jusqu’à la mort. Beaucoup de gens se suicident, des personnes âgées qui ne supportent pas être à la charge de leurs enfants.