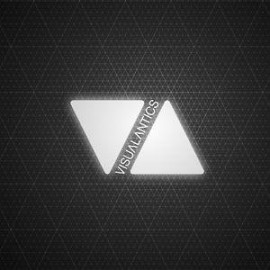Cinergie : Quelle est la genèse de ce projet
Lydie Wisshaupt-Claudel : Nous étions en pleine crise migratoire à l’automne 2015, et j’avais en tête avec mon compagnon d’accueillir. En parcourant la page FB de la plateforme citoyenne pour trouver un contact pour les joindre, je tombe sur un lien vers le blog de La Petite école et je découvre une page avec des associations d’images et de mots, des descriptifs de ce qu’elles font : c’était d’une grande poésie. On voit rarement ça dans les initiatives humanitaires. J'ai été surprise, et j’ai tout de suite voulu découvrir ce lieu et les deux femmes, Marie Pierrard et Juliette Pirlet, qui mènent ce projet.
Au départ, je n’avais pas spécialement l’idée de faire un film, je voulais les rencontrer. Je passe les voir et elles me disent qu’une caméra ne pourrait jamais entrer dans leur classe. Le projet est naissant, et les enfants ont besoin de calme pas d'une caméra braquée sur eux. Le temps passe. On se retrouve par hasard, on discute, on se revoit, on échange de manière de plus en plus soutenue et l’idée et l’envie d’un film naissent. Comme je ne peux pas entrer avec ma caméra directement, un processus se met progressivement en place, je prends peu à peu conscience des enjeux du lieu et des questions autour de la pédagogie qui s’applique entre elles et les enfants. Et ce qui m’intéresse aussi, je m’en rends compte une fois sur place, c’est la question qu’elles posent à l’institution scolaire. En étant elles-mêmes saisies par les questions que les enfants leur posent, pour la plupart issus de l’exil et n’ayant pas connu l’école, elles se demandent comment faire école avec des enfants qui ne la connaissent pas et quelles questions ça pose à l’institution scolaire qui les attend.
C. : Cette Petite école vise des enfants qui n’ont pas connu l’école et qui ont vécu des situations telles qu’aller à l’école est presque impensable pour eux. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficultés à sortir du cocon familial. Est-ce qu’elles ont imaginé rassembler ces enfants avec leurs parents dans cette petite école ?
L. W. : Tous les enfants réfugié.e.s ne sont pas sans passé scolaire. Elles ont été saisies par cette question parce qu’elles ont rencontré des familles syriennes installées à Bruxelles depuis longtemps qui n’avaient pas eu le réflexe, l’envie ou n’avaient pas ressenti la nécessité de scolariser leurs enfants. C’est propre à cette communauté-là, la communauté Dom. Mais dans les familles de réfugié.e.s, il y a aussi beaucoup de familles qui arrivent et qui, une fois stabilisées, veulent rescolariser rapidement les enfants, même si ce n’est pas évident. La particularité des familles syriennes Dom, dont sont issus beaucoup d’enfants dans les premières années du projet (c’est moins le cas aujourd’hui), c’est qu’elles ont fait une très longue route d’exil. Elles sont passées par l’Afrique du Nord, voire par la Mauritanie. Il y a des gens qui ont passé trois ans sur la route. Les enfants sont né.e.s sur la route et ne se sont jamais séparé.e.s. Les habitudes de vie avant l’exil sont déjà très serrées : on vit ensemble, on fait tout ensemble. Imaginer lâcher ses enfants dans une institution, déjà dans son propre pays, c’est une chose mais dans une institution étrangère dans un pays où l’accueil ne va pas de soi, c’est encore plus compliqué. Donc, il y a tout ce trajet d’aller vers l’école à effectuer.
L’idée d’accueillir les familles n’a jamais été leur souhait. L’idée initiale, c’est que, pour pouvoir entrer sereinement à la grande école, les enfants doivent pouvoir sortir de leur milieu familial même si cela représente une forme de violence dont elles ont conscience. L’idée, c’est que les enfants accèdent à un autre type de relation qu’avec celle de leur famille et puissent grandir ici en tant qu’adultes, pouvoir être lié.e.s à d’autres qu’à leurs parents. Mais l’école est complètement ouverte aux familles. L’école est ouverte sur la rue, les familles restent boire un café, arrivent plus tôt. L’école est un lieu de socialisation important et de soutien, de médiation culturelle. Les familles sont fatiguées d’être confrontées à tant de guichets différents en fonction des questions qu’elles se posent. La Petite école est là pour donner un soutien psychologique, social, pour traduire un document, une facture, etc. Elles prennent beaucoup en charge, c’est sûr, et ça pose la question des limites qu’on met aussi. Tous le personnel social autour de ces familles ont les meilleures intentions du monde, mais il est débordé, manque de moyens, et la relation qui est établie reste institutionnelle. Au milieu de tout ça, La Petite école apparaît comme un lieu de rencontre et de repos.
C. : Quel est le parcours des deux fondatrices ?
L. W. : Elles sont toutes les deux anciennes professeures de secondaire. Elles se définissent comme enseignantes-chercheuses. Elles invitent des pédopsychiatres, du personnel social, elles sont en lien avec des chercheurs et chercheuses universitaires avec qui elles sont en dialogue constant pour réfléchir aux problématiques auxquelles elles sont confrontées.
C. : Elles reçoivent peu de subsides donc elles se battent aussi à ce niveau-là.
L. W. : C’est tout l’enjeu et la difficulté de savoir comment être reconnu. Être reconnu financièrement, cela implique d’être reconnu administrativement et cela implique d’autres contraintes. Aujourd’hui, elles sont plus soutenues que lors des mandats précédents par le cabinet Désir dans l’éducation et dans l’aide à la jeunesse par la Ministre Glatigny. Ce soutien ne peut pas être structurel, cela dépend de qui est élu et de la part qu’il ou elle veut accorder à ces questions. Jusqu’à présent, le projet Petite école ne peut pas se contraindre à des choses comme un programme ou un système d’évaluation spécifique. Les choses évoluent et il faut suivre peu à peu ce que les cabinets acceptent d’imaginer. En attendant, leur soutien reste essentiel, tout autant que le soutien constant issu de donations privées, fidèles à l’école depuis son ouverture.
C. : Si le projet est soutenu, c’est qu’on reconnaît l’utilité de cette Petite école qui amène à la grande école.
L. W. : C’est le prétexte de départ, cela reste la vocation officielle de l’école. Puisque l’école est obligatoire en Belgique, c’est un droit et un devoir. Mais elles sont convaincues qu’une partie de ces enfants dans ces situations particulières ne sont pas prêt.e.s à apprendre et à se poser. L’enjeu sera de les préparer à se rendre accessibles aux apprentissages et se familiariser à nos codes scolaires. L’idée n’est pas de les contraindre. La Petite école est un lieu de liberté où on s’apprivoise. Certain.e.s ont besoin de quelques mois, d’autres plus. Si certains enfants ne veulent pas se rendre dans l’espace où on fait la classe pour travailler sa motricité fine, ou pour prononcer les lettres, par exemple, et qu’ils et elles ont simplement besoin de temps pour dormir, c'est possible. Il n’y a pas de contrainte, il y a une invitation à faire les choses mais au rythme des enfants.
Il ne s’agit pas d’être sûr qu’en arrivant à la grande école, les enfants pourront lire et écrire mais qu’ils et elles puissent allumer quelque chose qui va donner envie d’aller à l’école pour des raisons qui leur sont propres. Ce n’est pas l’idée d’imposer encore une contrainte extérieure de la part d’une institution. L’idée, c’est de donner une chance à ces enfants pour que l’école soit une expérience positive. Car souvent, c’est compliqué quand il n’y a jamais eu d’école ou une pause de plusieurs années. Il faut sortir du vocabulaire du « retard » par exemple, ces enfants ont une autre vie, ils n’ont pas de retard mais ils ont acquis d’autres choses. La question est de savoir comment utiliser ces choses, et une fois à la grande école, pour le reste de la classe aussi.
Leur envie de départ, c’est vraiment de favoriser une arrivée à l’école plus sereine, plus douce. Mais ce dont elles se sont rendu compte, c’est d’ailleurs un des enjeux irrésolus de la situation, c’est que pour certain.e.s, la question est de savoir si c’est vraiment à l’école qu’ils et elles doivent aller, si l’école en l’état ne leur fera pas plus de mal que de bien.
L’institution scolaire francophone a prévu un système, celui des DASPA, auparavant appelées les classes passerelles, qui sont des petites classes d’accueil au sein de la grande école qui accueillent des enfants qui ne sont pas francophones. L'initiative est pleine de qualités, mais ne prend pas en compte le passé scolaire des enfants, même s’il n’y en a pas. L’idée, c’est de s’acclimater au programme scolaire à travers un apprentissage de la langue un peu accéléré. Les profs, qui font ce qu’ils et elles peuvent avec les outils disponibles, au sein de l’institution scolaire et avec des enfants aux passés traumatiques ou loin du cadre scolaire, se retrouvent dans des situations compliquées. Les enfants, et surtout les adolescent.e.s, vont avoir du mal à accrocher, et à envisager un parcours scolaire sur le long terme.
C. : Cette Petite école donne une certaine structure, un certain cadre mais ne pourra pas répondre à toutes ces demandes.
L. W. : C’est pour cette raison que j’ai eu envie de les filmer maintenant alors que le projet est encore dans cette étape d’élaboration, de définition. Toutes les semaines, il y avait de nouveaux enjeux, de nouvelles questions, des choses irrésolues, l’invitation de la théorie en faisant venir des chercheurs en philosophie de l’éducation, en anthropologie pour nourrir ce qu’elles ont entre les mains. C’est mouvant en fonction aussi de l’équipe qui se transforme au gré des collaborations. Chacun vient avec ses souhaits, ses intentions, cela se transforme au fur et à mesure.
Mais, en suivant cette école pendant trois ans, j’ai eu la sensation qu’elle ne serait pas vouée à exister sur le long terme, en tous cas pas dans ce cadre. Elle ne prétend pas résoudre la problématique, mais en proposant ce lieu à une quinzaine d’enfants, elle soulève des questions et les pose à l’institution scolaire. Des enfants dans ces situations, il y en a beaucoup et il y en aura encore alors comment l’institution peut répondre à cette nécessité ? L’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage et de sociabilisation mais peut aussi être un lieu de repos, d’apaisement, d’épanouissement. Ce n’est pas une question nouvelle, les pédagogues travaillent sur le sujet depuis toujours, mais ici, d’autres problématiques s’ajoutent. On offre un droit à l’éducation aux enfants et on leur amène le devoir avec. Quelles questions ça pose sur l’oppression ? On parle de colonisation dans le film, comment on reproduit des choses malgré nous à travers un cadre institutionnel ? Ce qu’elles proposent dans ce lieu plus petit et plus ouvert qui sort des programmes, des sanctions, des évaluations, c’est de sortir au maximum d’un rapport vertical aux choses et d’opter pour un rapport mutuel de relation. Il n’y a pas un sachant et des apprenants. Chacun peut apprendre de l’autre même s’ils ont 6-7 ans.
C. : Comment s’est passé votre travail ?
L. W. : À mesure où je sentais que les choses pouvaient être passionnantes, elles m’ont dit que pour que cela soit possible il fallait que je fasse partie du paysage. Les enfants devaient savoir qui j’étais. J’ai commencé une rentrée avec elles et j’étais là tous les jours. En novembre, j’ai commencé à faire des repérages avec une équipe, je ne voulais pas filmer seule, et j’avais envie que l’équipe soit toujours la même. Les enfants s’étaient habitué.e.s à moi, je n’étais pas une entité pédagogique mais les enfants m’ont acceptée par la constance. Je prenais des notes comme une observatrice.
L’équipe est venue et on a filmé cinq jours et on a senti que c’était possible. Ils étaient peu nombreux durant ces cinq jours, ce qui a aussi été la cause d’une certaine nervosité dans le groupe. C’est très fluctuant parfois il y a 3 enfants présents, parfois il n’y a personne, parfois ils sont 15. Mais, on a acquis la confiance de l’équipe de l’école qui s’est rendu compte qu’elles pouvaient aussi tirer quelque chose de ce témoignage.
On est revenus tous les deux-trois mois avec la même équipe, Colin Lévêque à l’image et Thomas Grimm-Landsberg et Lucas Lebart qui se sont alternés au son. Durant trois années scolaires, deux ans et demi de tournage, on est revenus par sessions de trois à cinq jours dans l’école.
C. : Pourquoi tourner seulement pendant quelques jours ?
L. W. : Parce que c’était épuisant pour l’équipe de l’école et pour les enfants. Et, comme le souhait était de filmer une évolution, c’était aussi plus intéressant de revenir à intervalles réguliers : le mobilier change, les méthodes de travail changent, les activités aussi. L’idée, c’était d’avoir un maximum de situations différentes pour que cela nourrisse leur recherche.
C’est un petit lieu de quatre pièces avec une dizaine d’enfants. Ajouter trois personnes en plus, cela change le dispositif scolaire dans lequel elles sont. Elles ne modifiaient pas ce qu’elles faisaient en fonction de nous, on était dans un cinéma direct, d’immersion mais notre présence impliquait un poids et une fatigue. Ça faisait beaucoup d’adultes pour ce petit nombre d’enfants.
C. : On se rend compte que ces enfants portent en eux une souffrance, un vécu qui n’est pas de leur âge. Et ils l’expriment parfois de manière forte et violente. Cela ne doit pas être évident d’être confrontée à ces réactions et de trouver la bonne manière de réagir.
L. W. : Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. La relation entre l’adulte et l’enfant est relative. Elles essaient de sortir du jugement et des attentes. Elles leur souhaitent quelque chose, elles leur offrent un lieu pour qu’ils puissent trouver quelque chose pour eux-mêmes. Si on n’attend pas d’un enfant de réussir à tel moment de l’année scolaire, on se libère de nombreuses contraintes. Si on sort du temps linéaire et qu’on considère les choses dans un rapport à l’espace, on élargit les possibilités. Elles parlent d’atlas plutôt que de ligne du temps et ça ouvre les champs. Elles se demandent évidemment si elles font bien et atteignent leurs limites tous les jours, c’est humain. Elles expliquent comment sortir de ses propres conditionnements pour pouvoir aborder l’autre autrement. L’apprentissage de l’adulte vers l’enfant passe par plein d’autres manières de faire. Elles ne s’improvisent pas et ne se prétendent pas psychologues. Elles cherchent à créer des outils pour être en relation autrement. Il se trouve que c’est le cadre scolaire, la question de l’école mais on pourrait en inventer plein d’autres.
C. : Qu’est-ce que ce projet vous a apporté en tant que réalisatrice. D’habitude, vous faites du montage et parfois, il y a des sujets qui vous prennent et vous vous dites que c’est vous qui devez faire le film et ne pas attendre que quelqu’un d’autre le fasse à votre place ?
L. W. : Je me suis souvent considérée comme une monteuse qui fait des films. Oui, il faut que les choses me saisissent. Ici, ça m’a saisie et je ne l’avais pas prévu. J’ai appris à faire un film avec des personnages que j’ai suivis. Avant, c’était plutôt moi qui étais itinérante quelque part et qui passais ou d’un lieu à l’autre ou d’une personne à l’autre, sans jamais nourrir une relation sur le long terme. Cela a été très formateur, très riche et très beau pour moi. Évidemment, cela donne envie de recommencer. J’y ai trouvé une source d’inspiration dans mes relations humaines quotidiennes, avec mes filles par exemple. Je me demande tous les jours qui je suis, qui j’ai envie d’être pour mes filles, ce qu’est l’éducation, si c’est nécessaire d’avoir le contrôle sur le corps d’un enfant et je me pose des questions sur la confiance que je leur accorde.
C. : Comment s’est passé le cadre de travail pour ce film ?
L. W. : J’ai eu le plaisir d’être épaulée par Joachim Thôme et Jérôme Laffont des Productions du Verger avec qui j’avais déjà collaboré sur Killing Time. C’est toujours un plaisir car nous sommes toujours d’accord sur le cadre de travail : beaucoup de jours de tournage. On conçoit la production du film autour de ça. On sait que les calendriers en documentaire sont longs mais la conception de départ, c’est vraiment de tourner longtemps et sur longtemps. En montage, c’est pareil. L’année covid nous a été bénéfique puisque tout s’est suspendu et on a pu passer beaucoup de temps sur le montage avec Méline Van Aelbrouck. Ce fut un long travail de dérushage minutieux. Le film a pris beaucoup de formes avant sa version finale et je m’estime très chanceuse d’avoir pu encore une fois travailler longtemps.
C. : Quelles sont vos autres réalisations?
L. W. : J’ai réalisé deux films en autoproduction. Le premier, que j’ai présenté comme film de fin d’études à l’INSAS, date de 2006. C’est un journal de voyage en Islande intitulé Il y a encore de la lumière. Puis, j’ai fait un film de plus de trois heures, Sideroads, à partir d’un voyage que j’ai fait aux USA, pays qui me passionne. C’est au cours de ce voyage d’ailleurs que j’ai découvert la ville de Twentynine Palms où je suis retournée pour Killing Time. J’ai été soutenue et épaulée par l’ASBL Les Renards, un collectif dont je fais partie et qui m’a aidée pour la fin du film.