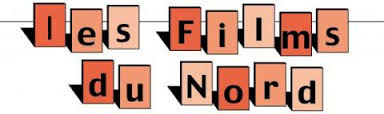Cinergie : Pour commencer, parlez-nous un peu de vous.
Rémi Durin : Rémi, co-fondateur avec Jérémie et Paul [Jérémie Mazurek et Paul Jadoul, ndlr] du studio l’Enclume. Un collectif que l’on a créé au début plutôt pour se rassurer, s’appuyer les uns les autres. Petit à petit, nous sommes devenus une vraie association, et nous avons pu développer chacun nos projets à tour de rôle. Aujourd’hui, nous sortons notre premier long-métrage, et il s’avère que c’était mon tour.
C. : Qu’est-ce qui vous anime dans votre travail de cinéaste ?
R.D. : Ce que j’aime beaucoup, ce sont les dessins. Je suis plutôt instinctif, et j’adore tout ce qui relève du graphisme, de l’illustration. Les livres pour enfants, la bande dessinée, ce sont des univers qui me parlent, et que j’adore voir bouger, être sonorisés, mis en récit. Bien sûr, les bonnes histoires sont importantes, mais j’adore par-dessus tout créer un plan, faire se mouvoir des images. Il y a quelque chose de simple et de magique à la fois.
C. : Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ?
R.D. : C’est Arnaud Demuynck qui est à l’initiative de ce film. Cela fait presque quinze ans qu’on bosse ensemble, c’est lui qui a produit mon premier court, et nous sommes en quelque sorte des compagnons de route. C’est également lui qui est venu avec ce projet de comédie musicale, avec son univers et ses idées. Avec l’Enclume, nous sommes arrivés dans un second temps pour répondre à quelque chose qu’il a pensée, imaginée et proposée. À partir de là, nous avons créé un trio avec Paul, qui a endossé le rôle de directeur artistique, et nous avons pu confronter notre vision à celle d’Arnaud, échanger et s’accorder pour créer une œuvre commune. Cela n’a pas toujours été sans désaccord, mais la collaboration c’est aussi ça.
C. : Comment passe-t-on du court au long-métrage ?
R.D. : En fait, on n’y passe pas vraiment. Nous n’avions jusque là fait que des moyens-métrages ou des courts-métrages, et pour Yuku nous avons abordé le projet comme un court-métrage très ambitieux. À la fois par amateurisme et par l’envie de ne pas trop se mettre la pression, nous avons d’abord choisi de conserver un processus artisanal, une façon de travailler très personnelle. Lorsque le film a grandi et que nous avons débuté la collaboration avec les équipes suisses et françaises, il a fallu s’organiser, mais tout en gardant un esprit relax. Faire un long-métrage, on ne s’y prépare pas, un peu comme les enfants [rires]. On apprend sur le tas, avec des mauvaises mais aussi de bonnes surprises.
C. : Dans Yuku, vous utilisez à la fois l’animation 2D et la 3D, comment avez-vous fait ce choix esthétique ?
R.D. : C’était d’abord une volonté technique. Paul, qui a un univers plutôt issu de l’illustration, travaille en deux dimensions. Il utilise des couleurs très particulières, des aplats, des projections de peinture, bref quelque chose de très graphique. En même temps, pour la faisabilité du film, nous voulions expérimenter une manière de fonctionner qui nous permettrait d’avoir un bon équilibre. Paul a développé une technique qui lui a permis d’intégrer son univers et ses couleurs dans l’animation 3D, avec cette idée de pousser le logiciel dans ses limites pour revenir toujours plus à un graphisme d’illustration. Cela passe par une manière de penser les ombres, les personnages. Il n’a jamais laissé la 3D prendre le dessus, et cela est passé par de nombreuses expérimentations.
C. : Votre rôle, c’était celui de chef-d’orchestre, entre ces différents pôles ?
R.D. : C’est là qu’on apprend beaucoup. Ma responsabilité était d’abord à la mise en scène, mais de là découle l’ensemble du film. Ce n’est pas uniquement proposer un storyboard à partir d’un scénario, c’est aussi proposer des idées qui vont donner du sens et de l’intérêt aux scènes. Ce n’est pas un travail que l’on conduit tout seul, et j’ai eu la chance d’avoir une équipe de quelques personnes autour de moi qui m’ont aidé à réaliser ce travail important, et parfois éreintant. Il faut pouvoir reconnaître qu’on est pas génial tout le temps, et partager le travail permet d’échanger les idées, de se répondre les uns aux autres, et d’arriver à un résultat optimal. Autour des séquences musicales par exemple, nous avons collaboré avec le studio breton Vivement lundi ! et un réalisateur spécialisé dans ce type de scènes, là où je me sentais un peu moins à l’aise. Pour qu’une histoire soit bien racontée, il faut trouver une manière de raconter chaque scène avec un réel intérêt, avec un contexte qui raconte lui aussi quelque chose du film. Et pas un simple champ contre-champ. Dans quel décor cela se passera-t-il ? Avec quelles palettes de couleurs ? Le travail de la mise en scène, c’est de piocher les bonnes idées pour trouver les meilleures manières de raconter. C’est cela qui crée ce tout.
C. : Qu’est-ce que ça implique de faire du cinéma d’animation en Belgique aujourd’hui ?
R.D. : Si l’on veut faire un film d’une certaine ampleur, il faut partager le travail et les budgets. Travailler en synergie avec d’autres acteurs nationaux et internationaux, c’est un aspect quasi structurel de notre manière de fonctionner. Il n’y a pas assez de financements en Belgique pour produire en solo, ce qui nous amène dès les débuts du projet à réfléchir avec qui on va se partager le projet, comment, et c’est ainsi que naissent les collaborations. Avec notre expérience, nous avons l’avantage d’avoir déjà eu des interlocuteurs privilégiés, des studios avec qui nous avons pu créer une relation de confiance. C’était le cas avec Nadasdy Film en Suisse. Mais cette recherche de financements nous a aussi permis de collaborer avec de nouveaux partenaires comme Vivement Lundi !, et de faire de belles rencontres. Dans ce processus, il ne faut pas avoir peur d’être curieux, et d’aller vers des boîtes qui nous parlent, qui nous inspirent. Travailler de cette manière, cela permet d’éviter d’emblée les frustrations, et tout s’est très bien passé, dans l’intérêt du film.
C. : Un très beau résultat, mais tout de même avec un sujet difficile…
R.D. : C’est vrai, mais je pense qu’il est important de parler aux enfants de choses qui ne sont pas toujours joyeuses. En fait, ils y pensent déjà sans nous. L’idée de la mort, de la perte d’un être cher, l’idée du deuil, c’est un peu abstrait lorsqu’on a quatre, six, huit ans. Proposer un film qui prend les devants, qui explique que, quoi qu’il arrive, nous mourrons tous à la fin, c’est aussi préparer l’enfant plutôt que de lui mentir pour le préserver. Nous voulions pouvoir traiter de la mort sans pour autant la cacher, pour pouvoir en parler. Tous les enfants ont ces questions, et c’est bien d’en discuter. Il n’y a pas de fleur-miracle dans Yuku, car il n’y en a pas dans la vie. Mais ce n’est pas un constat fataliste, on ne cache rien au public. La mort est quelque chose de triste certes, mais aussi de naturel. Et c’était important pour nous que le film puisse renvoyer cette réalité.