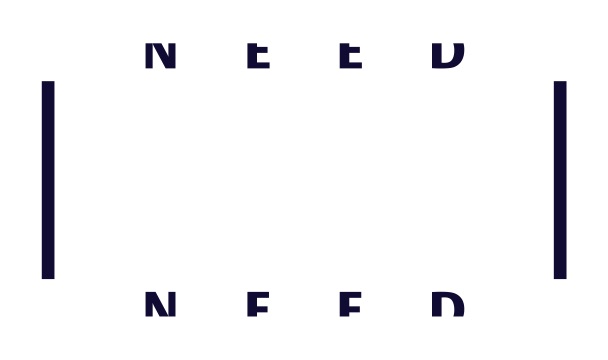Cinergie: Ce film est un prétexte pour montrer la danse à l’écran?
Delphine Lehericey: Je voulais aborder la création. J’aurais pu prendre la littérature, le cinéma, mais la danse est un vecteur de mouvement. L’art nous sauve et le fait de créer peut nous sortir de la tristesse, de la douleur et du deuil.
C.: La danse contemporaine est une danse plus à la portée de tout le monde?
D. L.: Avant de faire du cinéma, je travaillais avec des danseurs contemporains, amateurs et professionnels. Je faisais des vidéos pour la scénographie et je filmais aussi les danseurs. La danse, c’est beaucoup de travail, mais tout le monde peut danser. Cette danse s’inspire de qui on est et tous les corps peuvent s’exprimer à leur façon, c’est démocratique.
C.: Pour faire de la danse contemporaine, il n’est pas nécessaire de pratiquer depuis longtemps?
D. L.: On peut le faire et c’est toujours bien si on veut devenir danseur de développer une pratique. Il y a des bases, mais on peut faire tous les mouvements. Il y a une liberté autour de cette pratique, c’est l’inverse de la danse classique. Il y a des codes, mais ils s’inventent par les chorégraphes, par les corps des danseurs amateurs et professionnels. Les lignes peuvent bouger en permanence.
C.: Comment s’est passée la rencontre avec La Ribot?
D. L.: Je connaissais un peu son travail, mais je ne la connaissais pas personnellement. Mon producteur en Suisse, Thierry Spicher était directeur du théâtre L’Arsenic à Lausanne et avait déjà programmé La Ribot plusieurs fois. Quand j’ai commencé à écrire le film, je n’avais pas de chorégraphe précis. Je voulais prendre une actrice pour jouer la chorégraphe. Mon producteur m’a proposé de rencontrer La Ribot pour qu’elle coache l’actrice qui jouerait son propre rôle. On s’est rencontrées à Genève et on s’est vite adorées. Elle est très sincère, elle avait lu le scénario, elle l’avait trouvé drôle et elle fait preuve de second degré. Elle peut se moquer de son propre travail, parfois assez radical. Il y a une drôlerie dans cette radicalité. Elle fait des performances entre la danse et l’art contemporain. Elle comprend que pour le tout public, cela puisse être rebutant et elle aime provoquer. Elle a bien compris le scénario, mais je ne voulais pas me moquer de la danse contemporaine avec mon film. Je pense que la danse contemporaine peut transformer le public et les danseurs.
C.: Est-ce que tous les danseurs sont des danseurs professionnels?
D. L.: Il y a un mélange. Certains danseurs font partie de la troupe de La Ribot qu’elle a créée en même temps que le tournage du film, mais elle avait déjà travaillé plusieurs fois avec ces gens. Et il y a des comédiens comme Kacey Mottet Klein, Déborah Lukumuena, Astrid Whettnall qui se sont fondus dans la troupe. On a fait des répétitions avant le tournage où ils étaient vraiment dans la troupe pour que tout le monde soit à égalité, pour qu’ils connaissent les chorégraphies, pour qu’ils aient leur propre relation avec La Ribot.
Je voulais mélanger les corps. Dans la vie, il existe une diversité physique et je voulais que ça se voie. Ce n’est pas parce qu’on est long et mince qu’on peut danser. On peut être plus musclé, plus vieux, jeune, etc. C’est cette diversité qui fait aussi l’esthétique d’une pièce, de la création. C’est le travail de La Ribot qui travaille avec des gens de partout.
C.: La mise en scène était quelque chose d’assez naturel pour elle.
D. L.: On est partis de son travail. Dès que l’on a su qu’on ne prendrait pas une actrice pour jouer son rôle, j’ai voulu aussi raconter le travail de La Ribot. Comme les autres, elle avait une partition à suivre. Elle s’occupait de la partition et de la chorégraphie, de tout ce qui était le mouvement. J’avais en charge la mise en scène du film sur le plateau. On s’est réparti les choses, je lui disais quand elle devait jouer la chorégraphe pour qu’elle arrête de diriger les danseurs. Ils savaient ce qu’ils devaient faire et nous on faisait le film. Elle s’est laissé faire et c’était des moments drôles. Pour les danseurs, c’était facile parce qu’ils jouaient leur propre rôle, pour les acteurs qui n’avaient jamais vraiment participé à un spectacle vivant, il fallait qu’ils intègrent cette temporalité très différente. Au cinéma, on prépare beaucoup et pendant le tournage on a un temps précis et on doit être efficace tout de suite. Ici, on a laissé les choses se chercher. On filmait et on laissait des choses exister. La Ribot pouvait être elle-même et les acteurs devaient se faire diriger par elle et on attrapait des choses comme dans un documentaire. Je viens du documentaire, donc je voulais aussi amener une crédibilité au film.
C.: Pourquoi parler du deuil?
D. L.: Je voulais faire un film léger avec un sujet difficile. Tous mes films sont travaillés autour de la thématique de la famille qui me passionne et qui me passionnera jusqu’au bout. Ce qui m’intéresse aussi, c’est ce décalage entre la fatalité et comment on rebondit ou comment on ne parvient pas à rebondir. Je ne voulais pas que ce soit uniquement un drame. Dans la vie, il nous arrive des choses à la fois tragiques et belles. C’est intéressant de travailler ça au cinéma qui est le lieu du conflit. Je trouvais intéressant de faire jouer aux acteurs quelque chose de dramatique et qui fait rire en même temps comme le clown. Je viens de cette pratique et c’est parce que c’est tragique que ça nous fait rire. Je cherchais ce fil entre la comédie et le drame dans Last Dance et le deuil est le plus lourd des drames. C’est ce qui est le plus difficile à traverser quand on est vivant.
C.: Comment s’est passée l’écriture du film?
D. L.: Cela s’est fait assez rapidement. Mon film précédent devait sortir en salles, mais c’était compliqué parce que les salles ouvraient, fermaient, etc., on était à la fin de la pandémie, mais pas encore tout à fait sorti. C’était une année difficile et j’avais peur que personne ne revienne au cinéma. Quand tout s’est arrêté pour tout le monde, il y a eu un engouement pour la lecture, voir et revoir des films qu'on n'avait pas eu le temps de voir à leur sortie. L’art a réellement sauvé les gens pendant ce moment dramatique qu’était la pandémie. Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées qui râlaient qu’on décide pour elles, que c’était dangereux de sortir, de voir leur famille. Je voulais raconter l’histoire de mes grands-parents coincés dans leur maison de retraite où ils ne pouvaient rien faire. Tout ça me mettait en colère et a instillé l’inspiration de cette histoire. Comme je viens de la danse contemporaine, je me suis dit que ce serait marrant d’imaginer ce type vieux, à qui on ne laisse rien faire, qui rencontre cette troupe qui devient sa deuxième famille. Donc, le scénario est né en 6 mois.
C.: Comment avez-vous choisi le casting?
D. L.: On voulait faire vite, on avait déjà un financement en Belgique, en Suisse, le film était écrit. Les gens l’aimaient dans les commissions donc on s’est dit qu’on allait le faire rapidement. François Berléand voulait vraiment faire ce film qu’il trouvait triste, il le voyait comme une tragédie alors que c’est une comédie et c’est ça que j’aime. Cette rencontre était assez émouvante, car François Berléand est un acteur que l’on voit beaucoup dans des seconds rôles, mais jamais dans un premier rôle, contrairement au théâtre où il est l’acteur principal. Je pense qu’il était content de porter le film et il le fait très bien. Il m’a beaucoup émue pendant le tournage, il est très généreux et très drôle, il a un corps burlesque et en même temps, il est très émouvant.
Il y a d’abord eu La Ribot, puis François Berléand puis Jean-Benoît Ugeux avec qui je voulais travailler (et qui a un rôle très important dans la série tournée cet hiver), Astrid Whettnall que je connais depuis longtemps, Déborah Lukumuena pour qui je voulais écrire un rôle. C’est un peu ma troupe puisque je vais en retrouver certains soit dans le long métrage que je tourne l’année prochaine soit dans la série qui se termine maintenant.
C.: Comment s’est passée la construction du personnage de François Berléand?
D. L.: C’était très naturel parce que je l’ai pris aussi pour ce qu’il était dans la vie. C’est souvent comme ça que je fonctionne. Je rencontre les comédiens et si dans la vraie vie ils m’inspirent quelque chose pour le personnage ou s’ils lui ressemblent alors on travaille ensemble. Je pars toujours du réel et pas de ce que j’ai vu ou de ce que les acteurs ont l’habitude de jouer. Je trouve que l’on est dans une industrie dans laquelle on classe les gens et on manque d’imagination. C’est un peu fatigant pour les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs, les acteurs de se retrouver toujours dans les mêmes films, les mêmes rôles. La bougonnerie de François Berléand m’amuse, mais je sais que derrière, il y a quelque chose d’autre. C’est marrant qu’il soit enfermé dans des personnages comme ça et j’espère qu’il pourra jouer d’autres choses après ça. Au théâtre, il peut tout jouer.
C.: On note l’évolution de son personnage, il s’ouvre progressivement.
D. L.: Il s’agit ici d’une génération, il a un côté un peu vieille France. Il a plus de 70 ans, on a toujours tout fait pour lui, cela n’existe plus aujourd’hui. Certains jeunes qui ont vu le film sont émus, mais sont surpris que le personnage ne fasse rien, c’est comme si c’était de la science-fiction pour eux tandis que pour nous, c’est du vécu.
C.: Et c’est l’amour qui le fait changer, qui le pousse à agir?
D. L.: L’amour et les femmes. C’est l’amour pour sa femme à qui il a fait la promesse et cette chorégraphe qui le met en scène et qui ne le laisse pas s’écrouler. Elle lui donne une place et c’est le groupe qui apprend quelque chose d’autre. C’est une histoire plus complexe que celle qu’on croit voir, car il y a une découverte des uns et des autres. Eux découvrent un corps dans lequel ils n’avaient pas confiance et lui fait la découverte de son propre corps et de ses capacités, de cette jeunesse et de cet autre âge et de cet autre art. Tout cela est une histoire de rencontre et c’est une histoire d’amour.
C.: Comment avez-vous choisi la musique?
D. L.: Le musicien est toujours un partenaire dans mes films. Pour mon premier film, j’avais collaboré avec le groupe belge Soldout et depuis, je travaille avec un compositeur suisse, Nicolas Rabaeus. À chaque fois, je me rends compte que la musique dans mes films est comme un personnage. Ici, c’est une musique entre l’émotion et la drôlerie. Le morceau qui clôture le film est une reprise de O sole mio chantée par le compositeur du film lui-même et c’est drôle parce que Proust parle de O sole mio dans À la recherche du temps perdu. J’ai appris cela en faisant des recherches sur ce morceau qui est napolitain à la base et qui parle aussi d’amour.