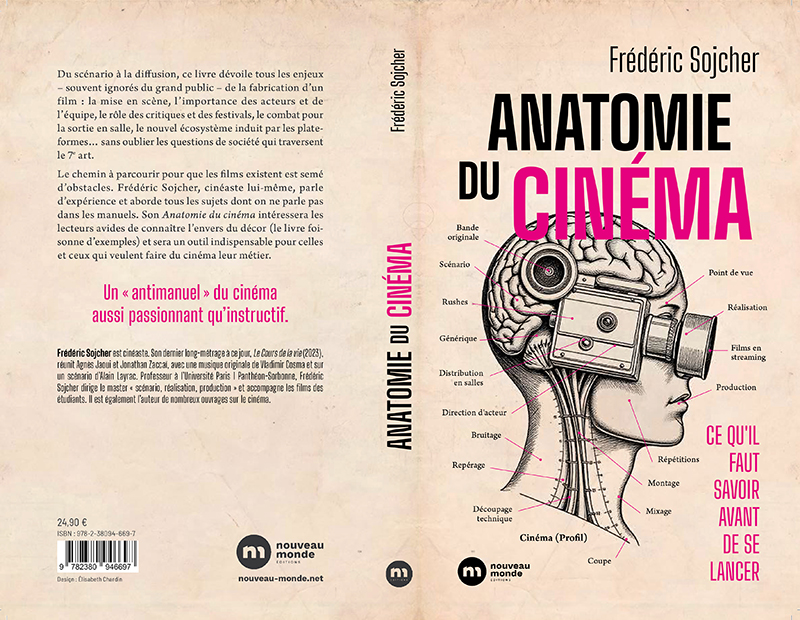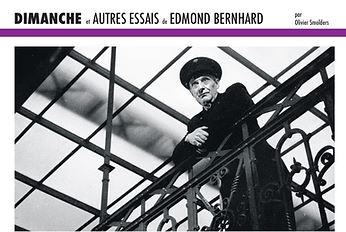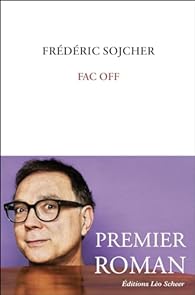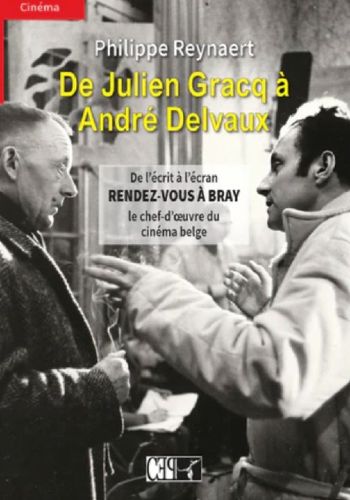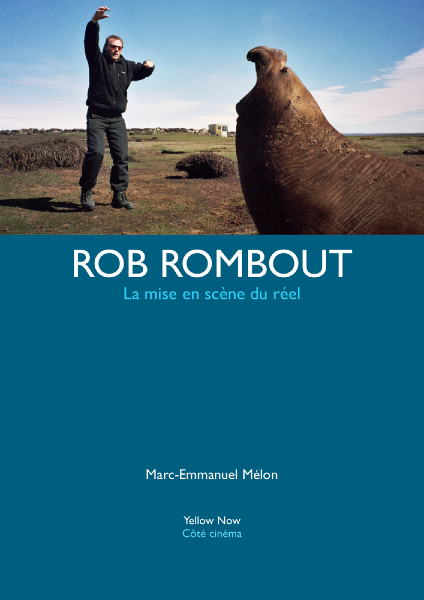Trafic 68 (1)

1. Prologue, Dardenne brothers
Avouons-le, nous sommes exaspérés par un certain public qui nous glisse (gênés, of course) lorsqu'on parle des films des frères Dardenne : « c'est trop réaliste, euh... pas assez sexy » ou « le réalisme social, c'est franchement pas ma tasse de thé » (à moi non plus, sauf qu'il y a naturalisme, réel et réalité). Que tous ces braves gens soient bernés par un cinéma formaté par la consommation rapide n'empêche pas l'incohérence des propos qu'ils ne cessent de répandre au profit des films de pur divertissement via une communication devenue de la manipulation (on ne confond pas avec l'information). Cela nous rappelle le récit du malicieux Abbas Kiarostami, qui, à partir d'un vécu, nous conte une jolie fable.
Invité à Florence par un ami, Abbas regarde un film. Après 10 minutes, ayant rapidement compris la suite et la fin, il ne peut que ronfler malgré un style hyper rapide changeant d'axe toutes les 7 secondes. Sorti de la salle située sur le piazzale Michelangelo, après 20 minutes, son ami lui parle de la liste astronomique des ventes de ce film. À l'extérieur, il pleuvine. Kiarostami, attiré par le Ponte Vecchio désire s'en approcher, ce qui arrange l'ami architecte qui peut alors lui en parler depuis sa construction en l'an 974 et signaler qu'à chaque inondation, ce pont en bois s'effondre pour être reconstruit. Le réalisateur de Ten est, pour sa part, captivé par un peintre (ressemblant à un Romain de l'Antiquité) qui observe, sur le pont, le manège que fait un jeune Florentin pour draguer une Américaine qui ne comprend pas grand-chose au mauvais anglais qu'on lui chante. Les deux compères se rapprochent de cette tentative d'histoire d'amour, surveillée par le peintre, captée par Kiarostami et ignorée par son ami érudit dont le discours est passé aux Médicis, à la Renaissance… Désormais, il pleut. Indifférente à l'éros florentin, l'Américaine ouvre son parapluie et quitte le pont. Blow Up version persane ? Pas seulement : pour l'un, le réalisateur, l'inconnu du réel renvoie à un imaginaire. Pour l'autre, l'érudit, le connu du réel se place dans la répétition du même. Pour l'un, les aspérités de la vie sont plus importantes que le discours sur ce qui la structure dans l'infini de la répétition.
Relisons donc nos fondamentaux sur le cinéma : André Bazin et Gilles Deleuze, pour traiter du problème. Cela tombe bien. Chez l'ami Gilles, la croyance et le nihilisme, le réalisme et le néo-réalisme, filmer le monde et filmer le corps sont des concepts qui ont fait partie de ses célèbres cours à l'ex-Université de Vincennes.André Bazin, lui, faisait une distinction entre le naturalisme du réel (le réalisme à tous crins, où le réel est plus réel que le réel), qu'il distinguait de l'approche du néoréalisme qui offrait une autre réalité, plus complexe, plus ambiguë, plus difficile à déchiffrer. En d'autres termes, une vision du réel et non sa représentation, une contemplation mentale d'un réel multiple et équivoque. Le sens de « ce cinéma de voyant » s'en dégage a posteriori, en « évitant de tomber dans les clichés » (André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma?, p. 270 et 281). Il nous semble que cela s'accorde bien (sans vouloir faire de comparaison avec le cinéma de Rossellini), depuis La Promesse, au désir du cinéma des frères Dardenne.
Gilles Deleuze nous propose, quant à lui, de « filmer non pas le monde, mais la croyance au monde ». Filmer la croyance d'un monde, donc, non pas d'un autre monde, mais celui dans lequel on vit, celui de la terre, de la vie, du corps. Reconstituer un lien profond avec le monde. Tracer une voie dans les décombres planétaires du monde médiatisé. « Nous devons croire au corps, mais comme au germe de vie, à la graine qui fait éclater les pavés, qui s’est conservée, perpétuée dans le saint suaire ou les bandelettes de la momie, et qui témoigne pour la vie, dans ce monde-ci tel qu’il est. » (Deleuze, L'Image-temps, p. 225).
Hors d'un discours médiatique permanent diffusant des images de la représentation du vécu (le visuel sur lequel s'insurgeait Daney), les Dardenne s'intéressent au monde de la vie et du corps qui l'exprime. Le dos, la nuque de Rosetta, en perpétuel mouvement, la nuque et le dos au travail d'Olivier Gourmet dans le Fils, que les frères filment avec une caméra portée, aussi mobile que leurs personnages. Mettre à nu un réel équivoque et multiple sur des corps exempts de tout discours sociologique (la sidérurgie liégeoise est montrée comme un décor déstructurant qui prive du travail). On ne peut être plus clair, leurs films s'interdisent de diffuser les clichés de la culture du divertissement et de la futilité.
Tel nous semble être le cinéma des Dardenne, totalement en dehors des discours sociologiques du réalisme social. Leur cinéma n'est ni dans les statistiques, ni dans des images de la représentation de la réalité, mais dans un « régime d'échange entre l'imaginaire et le réel ». Laissons poursuivre Deleuze : « Le regard imaginaire fait du réel quelque chose d'imaginaire, en même temps qu'il devient réel à son tour et nous redonne de la réalité». (L'Image-temps, p.17). N'est-on pas en train de rejoindre le malicieux Kiarostami plutôt que ce public qui confond les frères avec le naturalisme?
2. Lorna, meilleur film des lecteurs des Cahiers du Cinéma
Trafic consacre, dans son dernier numéro, un article au dernier film des frères Dardenne, Le silence de Lorna lequel vient, en janvier, d'être désigné comme le meilleur film de l'année 2008 par les lecteurs des Cahiers du Cinéma. Jean-Marie Samocki, dans L'Amour du manque, à propos du Silence de Lorna de Luc et Jean-Pierre Dardenne, nous signale que les réalisateurs mettent à nu « la part d’ambiguïté et d'impossible des valeurs judéo-chrétiennes ». Soit. Mais lorsqu'il écrit que « le naturalisme des Frères Dardenne paraît représenter aujourd'hui une sorte d'achèvement cinématographique », au premier abord, on reste pantois, même s'il ajoute que, pour les Dardenne, « ce naturalisme est au contraire un moyen plutôt qu'un résultat, un point d'équilibre entre deux forces de destructions, et Le Silence de Lorna est sans doute, avec Le Fils (2002) le film qui le montre le mieux ». Voyons voir, l'ambiguïté des corps.
L'une des caractéristiques des films des frères est de tisser des liens avec des acteurs privilégiés qui travaillent d'un film à l'autre et « dont les corps circulent de rôle en rôle, de fonctions narratives en d'autres fonctions narratives ». Olivier Gourmet passe de la figure d'un père maléfique dans La Promesse à celle d'un père adoptif dans Le fils. « C'est impressionnant dans le cas de Jérémie Renier, car son corps amaigri porte la fragilité du corps d'enfant d'Igor (dans La Promesse) et la pente lourde du corps de Bruno (dans L'Enfant en 2005). Le corps qu'il offre à Claudy semble ainsi continuellement menacé, meurtri comme sous le coup d'une prochaine mutation – ce qu’entérinera sa disparition par l'ellipse. Parmi eux, Arta Dobroshi est un corps étranger ».
Ce qui nous ramène aux propos de Gilles Deleuze. Notre croyance ne peut avoir d'autre objet que « la chair », nous avons besoin de raisons très spéciales pour croire au corps (« les anges ne connaissent pas, car toute vraie connaissance est obscure »). « Nous devons croire au corps, mais comme au germe de vie, à la graine qui fait éclater les pavés (...) Nous avons besoin d'une éthique ou d'une foi ; ce qui fait rire les idiots, ce n'est pas un besoin de croire à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde-ci, dont les idiots font partie » (l'Image-temps, p.226).
La mort de Claudy provoque chez Lorna le désir d'un enfant, pour vivre la perte de Claudy, « Dans cet enfantement impossible, souligne Samocki, la tristesse de Lorna s'avive. La force de sa croyance renvoie à un désir profondément éthique. Ce n'est pas la Vierge portant l'enfant; c'est Lorna, battue, blessée qui porte en elle le manque pour se découvrir devant l'amour. Elle ne cherche pas le pardon; elle accepte la trahison comme le moment où son amour se révèle à elle, confusément, mais ardemment.(...) Il faut la déshérence de l'amour, sa dépendance et son refus. Il faut en elle la mort de Claudy. C'est le seul amour du film; celui de Sokol n'est qu'un simulacre ».
Et de conclure : « Les Dardenne voulaient filmer Jésus en tant qu'homme; avec Le Silence de Lorna, ils filment la Vierge en tant qu'Albanaise déchirée entre deux identités. Au bout du personnage, entre amour d'infini et amour du manque ». Il nous semble, quant à nous, être plus proche de Dostoïevski que de la vie d'une Marie albanaise.
(1) Le récit de Kiarostami a été publié dans le numéro 50 de Trafic, intitulé Qu'est-ce que le cinéma ?