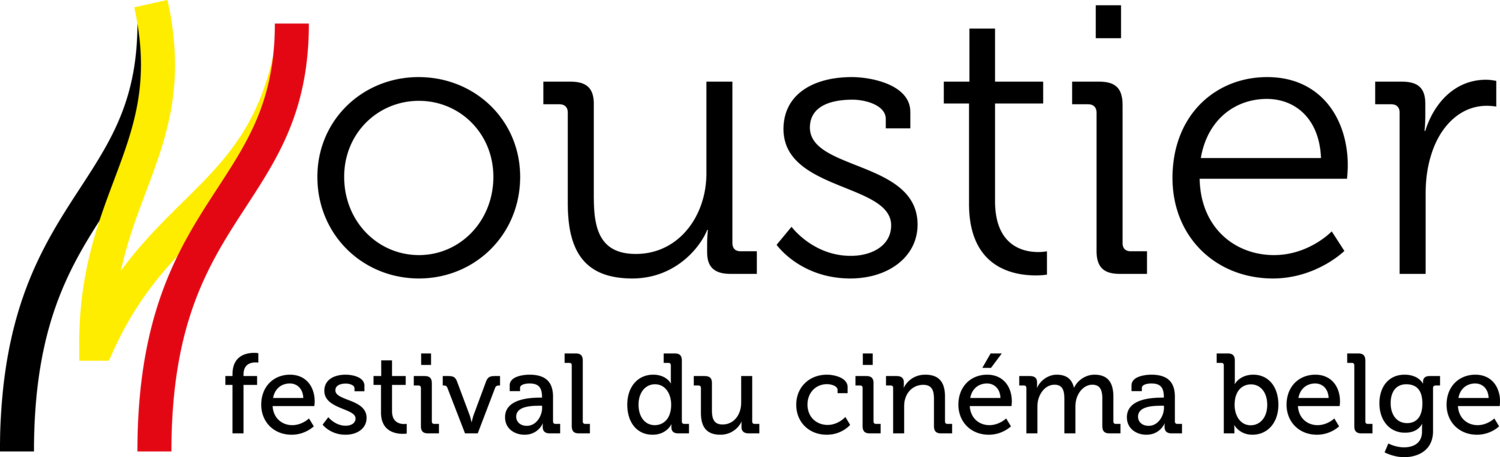Cinergie : Un scénario épouse souvent un seul point de vue. Vous ne vous êtes pas facilité la tâche puisque vous mettez à égalité trois points de vue différents : Gustave, le conformiste, Jules, l’idéaliste et Lou, qui n’a pas encore trouvé sa voie. La structure narrative du film s’est-elle décidée comme ça dès le départ ?
Sarah Hirrt : Non. J’ai beaucoup cherché à l’écriture. Au départ, Gustave était le personnage principal. J’ai ensuite écrit une version où c’était Lou. À un moment donné, j’ai compris que ce qui m’intéressait était d’aller explorer cette fratrie. Chacun des membres de la famille a un point de vue sur le monde et un choix de vie radicalement différents. Je voulais donc défendre chacun de ces points de vue et les confronter. Je n’avais pas envie de prendre parti pour l’un ou l’autre. Je voulais les mettre à égalité, que chacun des trois ait des failles et des grandeurs, afin de faire en sorte que le spectateur puisse choisir celui auquel il a envie de s’attacher. Mais il était important de donner une chance à chacun.
C. : Les directions différentes que prennent les frères et sœurs creusent parfois un fossé, une incapacité à percevoir le sens de l’existence choisie par l’autre. Ce sujet de la fratrie vous touche-t-il personnellement ?
S.H. : Oui, j’ai une sœur jumelle ! Le thème de la fratrie était déjà présent dans mes courts-métrages. Ce qui m’intéressait dans l’écriture, c’est qu’il s’agit de personnages qui n’ont pas forcément envie d’être ensemble mais qui sont obligés, à certains moments de leurs vies, de se retrouver. Ici, c’est pour régler un contentieux familial, une histoire d’héritage. Ça me permettait d’associer des personnages qui ont des visions du monde et de la société qui ne sont pas forcément compatibles et de montrer comment ils vont coexister malgré tout.
C. : Vous mettez les trois personnages sur un pied d’égalité. Néanmoins, j’ai eu l’impression que c’est Jules et les membres de sa communauté, avec tous les thèmes qu’un tel mode de vie engendre, qui vous intéressent en particulier.
S.H. : Le point de départ est la fratrie, un « vivre ensemble » intime. Puis arrive cette communauté qui fonctionne en hiérarchie horizontale, avec des gens qui se sont « choisis ». Je trouvais que la communauté faisait écho à la thématique de base. J’ai travaillé avec des comédiens non-professionnels du groupe « okupa », qui viennent du milieu anarchiste. Dans le film, ils défendent eux aussi leur point de vue sur la société. J’avais envie d’injecter cette énergie participative et collective, je souhaitais vraiment faire un « feel-good movie » et la communauté permettait d’amener ce côté festif. Dans la vie, ces gens sont très généreux. Ils sont délestés de certains poids que nous avons ici et je pense que ça se ressent dans le film. Ça fait du bien de les voir vivre ensemble. Le thème de la communauté me permettait également d’avoir un personnage, Jules, qui n’est pas seul. Gustave et Lou, eux, sont seuls. Mais Jules est complété par son groupe, par sa compagne Lucia et par leur fille de 3 ans, Carmen. Les contradictions au sein des personnages, les dissonances cognitives entre leurs valeurs et leur comportement au quotidien m’intéressent. Jules a beaucoup de contradictions. En apparence, il a l’air d’être le plus déterminé de la famille. Mais en fait, il se cherche lui aussi. Il essaie de trouver une stabilité, un équilibre entre ses responsabilités de père et les idéaux de liberté qu’il partage au sein de la communauté.
C. : Le film est une allégorie de notre monde avec trois personnages qui correspondent aux positions que les sociologues définissent comme des réponses à la crise : les sécuritaires qui ont peur et se replient sur eux-mêmes, les rêveurs qui réinventent le monde et tentent, parfois maladroitement de trouver des solutions et la grande majorité : les indécis. Est-ce qu’en tant qu’artiste, le modèle de Jules est celui qui vous convient le mieux ? J’aurais tendance à croire qu’il y a plus de poésie chez Lou et Gustave. Parce qu’on ne s’attend pas à trouver de la poésie chez un personnage très terre-à-terre et bougon comme Gustave !
S.H. : Mes amis qui ont vu le film me comparent à chacun des personnages. J’ai donc cette impression que Lou, Jules et Gustave sont trois déclinaisons de certaines facettes de ma personnalité. C’est certain qu’il y a quelque chose de très séduisant dans le mode de vie anarchiste de Jules. Et puis, faire du cinéma est contradictoire : on crée, on a envie d’être libre. Mais en même temps, on doit passer par le filtre des Commissions, c’est un art qui demande beaucoup d’argent et finalement il s’agit quand même de vendre un produit ! Donc le côté concret et terre-à-terre est inévitable. Après, il faut tenter de jouer des coudes pour faire le film que l’on a envie de faire. Et puis, de temps en temps, on est comme Lou : on ne sait plus à quel Saint se vouer ni dans quelle voie se diriger.
C. : La réussite sociale et la pression familiale sont des fardeaux qui paralysent Gustave. Néanmoins, il reste le personnage le plus digne des trois. Il est attachant parce qu’on le sent malheureux, obstiné par cette idée d’être « un bon fils », au détriment de sa vie privée et de son bonheur. Il est celui qui s’est sacrifié pendant que Jules faisait tout ce qu’il voulait.
S.H. : Gustave est un personnage qui évolue. Je savais, par ce qu’il dégage, que François Neycken allait amener de l’empathie. Le personnage est mélomane et adore l’opéra. J’ai donc essayé d’aller chercher sa poésie ailleurs. Gustave et Jules s’opposent mais il n’y a pas de méchant et de gentil, car je déteste cette notion-là. Je voulais défendre le point de vue de chacun. Moi je suis assez obstinée. Parfois je me demande : « Ai-je bien fait d’aller dans cette voie ? » mais je continue malgré tout parce que si je fais marche-arrière, je risque d’avoir l’air un peu conne. Ce qui est touchant chez Gustave, c’est qu’il continue à avancer tête baissée et on se demande s’il va aller droit dans le mur ou se retourner à un moment donné.
C. : Les membres de la communauté sont des gens progressistes et ouverts. Mais vous montrez aussi leurs limites et les limites de ce beau rêve : leur arrogance face à Lou, leur côté sans-gêne. Ils sont fêtards, bruyants… Sans parler du fait qu’ils se nourrissent en fouillant les poubelles et mettent peut-être la petite Gloria en danger…
S.H. : Oui mais la scène des poubelles reste joyeuse ! Il y a plein de produits tout à fait comestibles qui sont jetés uniquement parce que la date de péremption est dépassée depuis 24 heures. Cette scène montre l’absurdité de la société de consommation. Mais c’est vrai, je n’avais pas envie de faire un film moralisateur ni de décrire un système idéal. Ça n’existe pas. Tout le monde, y compris les membres de cette communauté, est en train de chercher. Ils ont des contradictions personnelles et au sein du groupe. Ils s’opposent parfois entre eux mais ils en discutent, ils font des débats. Ils ne sont pas obligés de vivre ensemble mais ils l’ont décidé. Je voulais surtout semer des graines de questionnements et montrer comment les gens se cherchent, comment ils essaient de se montrer cohérents vis-à-vis de leurs valeurs. J’ai un côté Bisounours, j’ai besoin d’espoir et d’optimisme. Mais je ne voulais surtout pas faire un film manichéen. Il était donc important de montrer ces moments difficiles au sein de la communauté. Je me pose beaucoup de questions sur le monde actuel, j’ai énormément d’amis qui ne se reconnaissent pas dans le système mais qui en sont esclaves. Finalement, nous courrons tous après le temps, après l’argent. Comment faire pour se débrouiller avec ça ? Comment faire pour vivre et ne pas devenir complètement schizophrènes par rapport à nos attentes, à nos valeurs, à nos utopies, à nos responsabilités professionnelles et familiales, etc. ? Le thème de la communauté était l’occasion de questionner tout ça.
C. : Pour les trois rôles principaux, vous avez choisi des acteurs pratiquement inconnus au cinéma. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec François Neycken (Gustave), Raphaëlle Corbisier (Lou) et Yohan Manca (Jules), ainsi que de vos méthodes pour diriger les comédiens amateurs du mouvement « okupa » ?
S.H. : Dans certains films, on retrouve des visages qui sont tellement connus que ça devient répétitif. Moi, j’avais envie de travailler avec des comédiens qu’on n’avait pas encore vus. Or, monter et distribuer un film avec des comédiens inconnus n’est pas évident. Attirer les spectateurs dans les salles non plus : ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas le travail de ces comédiens… ils doivent donc nous faire confiance ! J’avais travaillé avec François Neycken sur mon court-métrage de fin d’études à l’INSAS, En attendant le dégel. J’ai donc pensé à lui en écrivant le rôle de Gustave… Raphaëlle Corbisier sort également de l’INSAS. Je l’avais vue dans le spectacle de fin d’études et je l’avais trouvée formidable. Elle s’est montrée extrêmement naturelle au casting. Son assurance était assez déconcertante. J’avais l’impression qu’elle n’était pas du tout stressée alors que c’était son tout premier casting. Elle correspondait bien à certaines facettes du personnage, même si elle a dû pas mal composer en changeant de coiffure et de vêtements... Quant à Yohan Manca, qui joue le frère qui vit en Espagne, il est français. Il écrit et réalise mais il avait très peu d’expérience en tant que comédien. Etant donné que les comédiens d’ « okupa » sont non-professionnels et que je voulais travailler en impro, je ne pouvais pas me contenter d’un comédien qui allait simplement apprendre son texte. J’avais besoin de quelqu’un qui pourrait interagir et improviser en espagnol. Johan, dont la mère est espagnole, a du bosser un peu la langue pour le projet. C’était donc un casting composé de comédiens qui avaient peu d’expérience, de comédiens amateurs et de quelques comédiens espagnols beaucoup plus expérimentés. Comme Sergi Lopez et surtout Maria Léon, une star du petit écran en Espagne, qui joue Lucia, la compagne de Jules. C’était elle la plus punk de tout le groupe ! Elle se faisait sans cesse arrêter en rue par des fans. Ce mélange d’expériences et de jeux différents s’est avéré très riche. C’était dingue parce que j’avais des scènes avec beaucoup de personnages, alors que dans mes courts-métrages, j’avais deux, maximum trois acteurs à l’écran. Là, dans toutes ces scènes de groupes, j’avais d’un côté des comédiens très techniques, de l’autre des comédiens super spontanés. C’était un gros melting-pot, un joyeux bordel qui me plaisait et qui faisait écho aux propos du film… Et puis Sergi Lopez a été super parce qu’il a accepté de venir faire un tout petit rôle et de donner la réplique à des comédiens non-professionnels. Il a vraiment joué le jeu. C’est rigolo parce qu’il n’a que deux scènes dans le film et il est sur l’affiche ! Ça fait aussi partie du jeu. Mais Sergi est proche des milieux anarchistes. Il connaît tout ce milieu-là et ça lui faisait vraiment plaisir de venir nous donner un petit coup de main.
C. : Connaissiez-vous les membres d’ « okupa » qui apparaissent dans le film ?
S.H. : Je connaissais le plus âgé d’entre eux, Ivan Altamira, qui joue Jesùs. Je l’avais rencontré durant les repérages. J’avais besoin d’informations pour écrire le scénario. Ivan a vraiment beaucoup d’expérience de luttes et d’occupations. C’est donc lui qui m’a livré le plus d’informations sur le sujet. Ensuite, j’ai commencé à faire des castings sauvages avec Elizabet Llado, une réalisatrice catalane qui a étudié à l’IAD et qui vit maintenant à Barcelone. Elle a organisé des castings un peu partout dans la ville : dans les squats, dans toutes sortes d’endroits où l’on rencontre des gens avec des idéaux anti-patriarcaux, anti-capitalistes. Les membres du groupe dans le film ne se connaissaient pas à la base. En fin de compte, ces comédiens sans expérience arrivent simplement avec ce qu’ils sont et c’est comme ça que je les ai choisis. C’était marrant : un jour en répétition, j’ai décidé d’improviser une scène de fête. Parfois pour chauffer un groupe de comédiens, il faut un peu de temps. Mais là, j’ai à peine eu le temps de me retourner qu’ils étaient déjà tous sur les tables en train de chanter et danser ! C’est là que j’ai été rassurée : le groupe existe ! Il y a eu du vrai « vivre ensemble » pendant le tournage, pas seulement à l’image. Le groupe s’est vraiment soudé pendant ces quelques semaines en Catalogne.
C. : Que pensez-vous des actions et initiatives collectives d’ « okupa » ? Les trouvez-vous efficaces ?
S.H. : C’est un mouvement « squat » né dans les années 90. Moi je suis retournée en Espagne après l’INSAS parce qu’il y avait eu le mouvement des Indignés et je n’avais pas pu y aller à cause de mes études. J’ai voulu aller voir ce qu’il se passait après tout ça. Il y a eu l’explosion de la bulle immobilière, énormément de familles se sont retrouvées à la rue. J’ai l’impression que le mouvement « okupa » a repris de l’ampleur parce qu’il répondait à un besoin de logement, notamment pour que des jeunes puissent vivre sans devoir retourner chez leurs parents. Ils squattent des appartements qui appartiennent aux banques ou à l’Etat et organisent également des activités pour le quartier : cours de couture, de sport, ciné-clubs... Tout ça permet de fédérer un quartier dans des espaces d’échanges et de rencontres. Avec la crise, beaucoup de gens risquent de s’isoler parce qu’ils n’ont plus les moyens de pratiquer des activités. Le mouvement leur permet d’avoir accès à toutes sortes de choses. D’une certaine manière, la crise a permis de retrouver un réseau de solidarité, d’entraide et de partage d’initiatives citoyennes. Bien entendu, il y a des contradictions au sein du mouvement « okupa » : certains squattent par pure conviction politique, pour remettre en question le concept de propriété privée. D’autres le font par nécessité, parce qu’ils ont tout perdu, pour ne pas se retrouver à la rue. Parfois ils trouvent des arrangements avec les banques pour pouvoir rester dans les appartements qu’ils occupent illégalement. Moi j’ai l’impression que dans le monde tel qu’il est, on a besoin d’initiatives collectives comme celle-là pour s’en sortir. Parce qu’on va droit dans le mur. Ce sont ceux qui seront entourés, qui seront forts et qui auront réfléchi à des manières de s’en sortir qui pourront faire face à ce qui est en train de nous arriver dans la gueule.
Cinergie : Pouvez-vous commenter votre approche visuelle ? Beaucoup de scènes ont été tournées caméra à l’épaule…
S.H. : J’aime beaucoup la caméra à l’épaule. C’est efficace quand on a peu de temps et peu de moyens, ça permet d’avoir beaucoup de liberté. C’est le mot « liberté » qui conduisait mes envies formelles. Sur ce film, j’ai vraiment voulu casser mon côté un peu scolaire dans ma manière de réfléchir et de penser. Le fait de travailler en impro avec des comédiens non-professionnels me permettait de ne pas exiger un jeu très technique. C’est la caméra qui jouait avec eux. Le mot que je répétais à mon directeur de la photographie, Jako Raybaut, c’est « organique ». Je voulais que la caméra épouse l’énergie des personnages. Nous avons travaillé en lumière naturelle, avec très peu de lumière ajoutée. J’aime beaucoup choisir des décors, travailler sur les couleurs, sur les costumes et également, dans la mesure du possible, choisir les heures auxquelles je tourne afin d’obtenir la lumière qui m’intéresse. J’aime bien mettre tous ces éléments ensemble parce que ça donne quelque chose de naturaliste, avec un peu de poésie. Je ne voulais pas d’un film trop sophistiqué, j’ai essayé d’aller vers une beauté naturelle. Je résistais quand l’étalonneur me proposait quelque chose d’un peu plus léché, je voulais absolument garder un aspect simple et faire confiance à ce qui existe dans l’image. C’est comme pour la bouffe : j’aime avoir de bons ingrédients mais je n’aime pas l’esbroufe. Certains films très visuels me plaisent beaucoup mais j’aime surtout les films qui sont portés par les personnages.
Cinergie : Vous arrivez à injecter une joie permanente dans ce film qui parle de sujets graves.
S.H. : Je suis très heureuse d’entendre ça. Au Festival de Mons, un spectateur m’a dit : « J’ai commencé à sourire pendant le film et là je n’arrive plus à m’arrêter! » Mon envie première avec Escapada était de redonner une énergie positive. Parce que quand je vois l’état de la société, je suis catastrophée. J’avais vraiment besoin de réaliser un film léger, mais qui pose quand même certaines questions importantes sur la société actuelle. Cette volonté de sortir de la salle avec une bonne énergie, de recharger les batteries des spectateurs, était là dès l’écriture. Mais je n’étais pas certaine que ça allait marcher. Le fait de travailler avec des comédiens amateurs faisait partie de ce processus. Le fait d’aller en Espagne, vers un univers beaucoup plus lumineux y contribuait aussi beaucoup. Ce genre de film peut paraître futile pour certains, mais je suis persuadée qu’ils peuvent faire du bien. Ils peuvent rendre un peu d’espoir et également avoir un petit impact politique. Je voulais qu’on sorte de la salle en se disant : « Y’a moyen ! ». En tant que spectatrice, j’adore les films coups de poing. Mais Escapada, c’est une caresse.