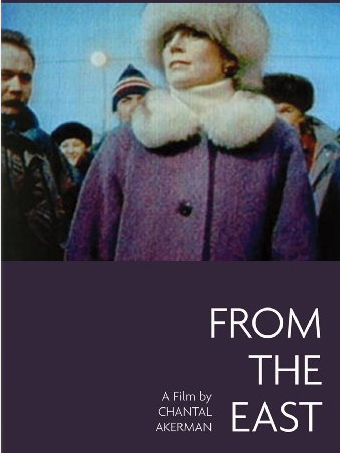Débuts
Chantal Akerman: Mes premiers chocs cinématographiques ont été la vision de Pierrot le fou, à quinze ans, et, un peu plus tard, la découverte du cinéma expérimental américain. Je devais avoir vingt et un ans à l'époque et ça m'avait très fort impressionné. Je n'imaginais pas qu'un cinéma comme ça puisse exister, où tout pouvait être exprimé avec une telle force sans raconter d'histoire, avec ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de guillemets, du "cinéma pur". C'était comme découvrir tout d'un coup qu'il existe un art contemporain au cinéma aussi. Parce que le cinéma est tout de même très en retard, dans son expression publique. Ce qu'on appelle le grand public sait maintenant qu'il y a des tableaux abstraits, mais, au cinéma, il continue d'entretenir une attente stéréotypée pour une histoire construite de telle et telle manière.