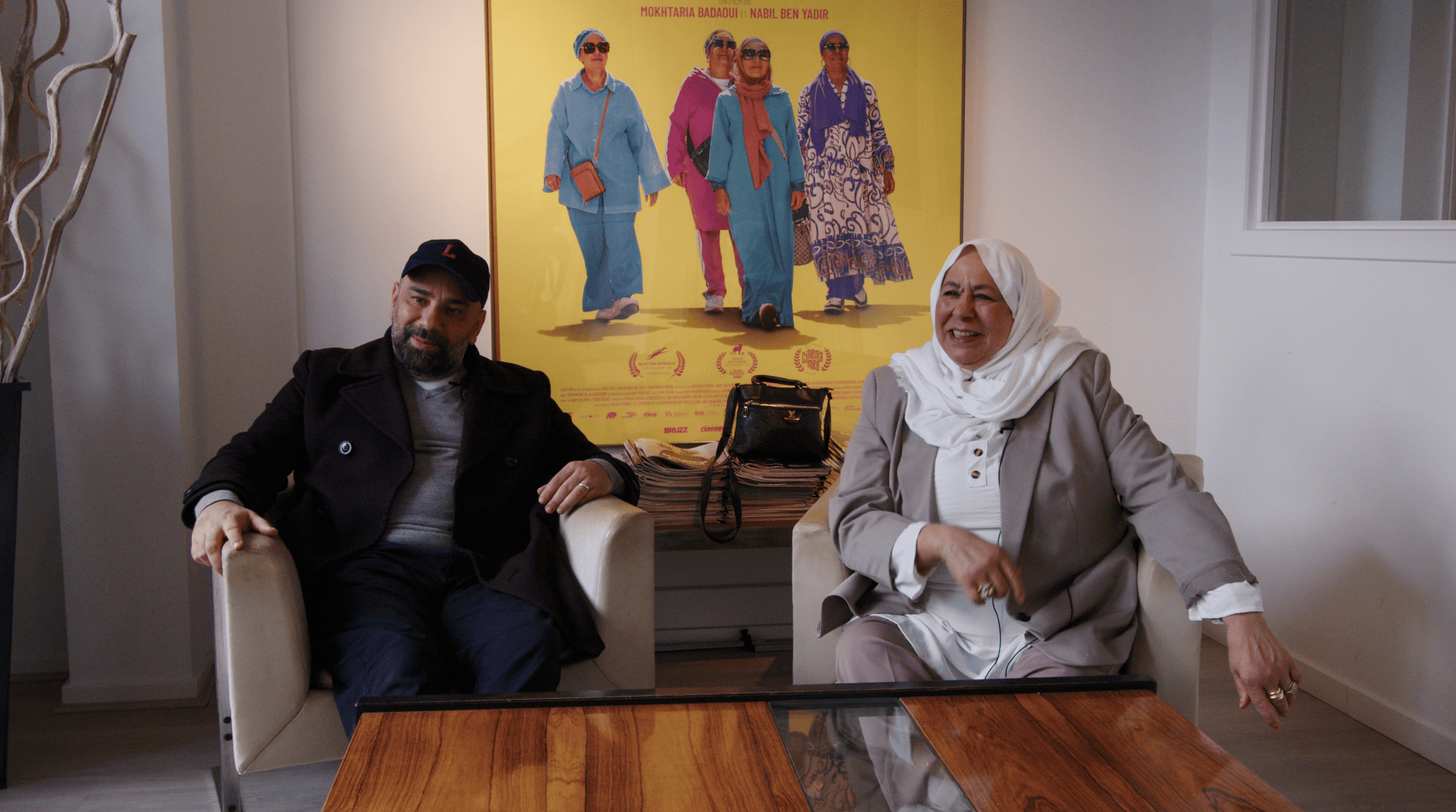Invitée d’honneur au Festival d’Arras, la comédienne Cécile de France y a tenu une masterclass et présenté une sélection de ses films dont Par amour, un long-métrage de Elise Otzenberger qui sortira en 2025. Avec générosité, humour et spontanéité, elle évoque dans cet entretien son intérêt pour les premiers films, son rapport aux scénarios, ses souvenirs d’interviews et de castings ainsi que la place grandissante qu’occupent les femmes cinéastes.
Cécile de France : « J'amène beaucoup de moi dans chacun de mes personnages, dans chaque histoire que j'ai envie de défendre »
Cinergie: Vous avez travaillé avec des réalisateurs belges. On parle beaucoup de l’école de la débrouille en Belgique, est-ce quelque chose que vous avez perçu?
Cécile de France: Oui, c'est vrai que c'est l'école de la débrouille, mais en même temps c'est du coup une nécessité pour les réalisateurs. C'est vraiment un combat, ça demande beaucoup de temps. Le chemin n'est pas facile pour arriver enfin sur le plateau, pour enfin réaliser et tourner. Les réalisateurs et réalisatrices passent beaucoup d’épreuves. Souvent on les accompagne, on voit que ça prend du temps, c'est plus long qu'en France en fait. Quand du coup, le premier jour de tournage arrive, il y a une intensité, une euphorie, une responsabilité, une importance, mais qui n'est pas lourde, qui n'est pas pesante, qui est plutôt créative, riche et intéressante. Effectivement, on se sent plus faire partie d'un combat quelque part pour arriver à faire un film.
C.: Les premiers films commencent souvent avec les courts-métrages. À vos débuts, vous avez fait des courts avec Emmanuel Jespers et Patrice Bauduinet. Quels souvenirs en gardez-vous?
C.D.F: Les courts, c'est souvent très bref et très intense. Je garde un bon souvenir de ces deux collaborations dont vous parlez. Pour Le Dernier Rêve d'Emmanuel Jespers (2000), j'avais reçu un prix d’interprétation. C'était mon tout premier prix d'interprétation à Bruxelles, je crois. Je n'avais pas pu être présente, mais c'était tout d'un coup une première expression d’encouragement de pouvoir continuer à faire du cinéma. C'était exceptionnel, je m'en souviens vraiment très bien de ce moment où j'ai appris ça au téléphone.
Et puis, il y a ce court-métrage dadaïste, La Nuit du 6 au 7 (2003), de Patrice Bauduinet qui est complètement frappadingue et qui ne peut qu’être belge parce que je me baigne nue dans une casserole géante de purée! Il n'y a qu'en Belgique qu'on peut faire ça, donc ça, c'est quand même exceptionnel. Je tiens à préciser l'audace de Patrice Bauduinet avec ce film!
C.: Vous avez continué à faire des courts après avoir percé. Vous avez fait aussi des premiers longs. Comment l’expliquez-vous?
C.D.F: C'est souvent une première expression artistique pour les réalisateurs et les réalisatrices et moi, je suis toujours très émue de les accompagner dans la réalisation de leurs premiers émois en tant que cinéastes. C'est souvent très intense aussi et mis à part le fait qu'on est centré sur soi et qu'on peut essayer des choses, on peut du coup apprendre un peu son métier, que ce soit en court ou en long. Les deux ont autant de valeur. Après oui, les courts-métrages, il faut continuer à en faire et ne pas en faire que quand on est apprenti comédien. Du côté des premiers longs, les projets sont souvent liés à une nécessité. Artistiquement, souvent ils proposent quelque chose de très personnel, de très fort, de très intime aussi. Là par exemple, cette année j'ai tourné deux premiers longs-métrages: Louise de Nicolas Keitel, qui sortira l'année prochaine et La Poupée de Sophie Beaulieu. Souvent, ces cinéastes ont fait des courts-métrages, on a compris leurs capacités. Ce n'est pas une si grande prise de risques finalement, le long, sauf que les distributeurs sont évidemment assez frileux. Par exemple, Héloïse Pelloquet avec qui j’ai tourné son premier long, La Passagère (2022), a fait de super courts-métrages dont je suis tombée totalement amoureuse et Imane Laurence, qui est l'actrice de ses courts-métrages, est devenue mon actrice préférée. C'est vous dire à quel point ça a aussi son importance, tous ces courts-métrages, et à quel point ils peuvent donner envie à des acteurs, à des actrices. Je pense que ce n'est pas une question de carrière ou de quoi que ce soit, c’est vraiment une question d’arriver à réveiller un désir chez un acteur. Grâce à un court-métrage, c'est tout à fait possible et courant. C'est comme tomber amoureux, vous voyez, ça ne se calcule pas!
C.: Vous avez reçu en 2003 le César du meilleur espoir féminin pour L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch. D’autres prix vous ont été attribués par la suite. En quoi ce César est-il un prix à part?
C.D.F: C'est celui qui a le plus de sens je trouve parce que c'est celui qui va encourager vraiment l’acteur. Quand on est déjà confirmé, c’est différent. On sait qu'il y a eu des prix, qu'il y en aura peut-être d’autres après. Alors que là, un espoir, c'est forcément une grande validation, un grand welcome dans la grande famille du cinéma français et belge. Pour moi, je l'ai vécu de cette manière en tout cas. Ça a eu vraiment un impact concret et réel donc ça a beaucoup de valeur.
C.: Comment considérez-vous la lecture d’un scénario?
C.D.F: Comme celle d'un roman. Je le prends vraiment comme un moment où j'ai envie de lire, où je suis souvent excitée à l'idée de découvrir une histoire, de me plonger dedans. Je suis toujours dans un a priori très positif, très curieux et très affamé, on va dire. Et puis après, je lis comme un livre. Si je n'aime pas, je ne sais pas si je vais jusqu'au bout. J'essaye, mais il y a des fois où ça ne me plaît pas du tout et je le vois très vite, alors que quand ça me plaît, je termine la dernière page et j'appelle en général le réalisateur. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. On ne réfléchit pas, vous voyez, c'est vraiment le cœur qui parle.
C.: Comment se passaient vos premières interviews?
C.D.F: On est un peu jeté dans la fosse aux lions. On fait des erreurs et on apprend de ses erreurs. Après, on est moins naïf, on fait attention à ce qu'on dit. Ce n'est pas qu'on nous vole des choses, mais finalement, il faut rester à sa place d'artiste et de représentant d'une œuvre. Après, on peut aussi jouer le jeu de devenir un personnage public. Mais c'est autre chose.
J'ai tout de suite fait beaucoup d'erreurs au début. Je me livrais trop, j'étais à 100% moi. En fait, je suis toujours moi, mais je suis là pour parler de cinéma, et pas forcément de mon intimité ou de ma vie privée. Et ça, personne ne nous le dit. On fait des erreurs et après, on ne les fait plus.
C.: Tant qu’on en est aux débuts, vous auriez un conseil à donner aux jeunes comédiens qui se découragent face à l’épreuve des castings?
C.D.F: J'encourage les jeunes acteurs à faire beaucoup de castings. Ce n'est pas grave si on n'est pas pris. Il faut vraiment en faire un maximum pour s'entraîner, pour se solidifier, parce que c'est très difficile pour l'ego. D'autant plus qu'on reçoit rarement une explication à un refus. Et même des fois, on ne reçoit jamais de réponse. Et puis, un beau jour, vous correspondez au personnage recherché par un réalisateur et vous n'avez pas forcément besoin d'être connu. C’est juste que si vous n'êtes pas pris, c'est parce que vous ne correspondez pas à ce que le réalisateur a dans la tête, pas parce que vous n'êtes pas bon. Mais ça, il faut du temps avant de s'en rendre compte. Pareil, personne ne vous le dit, ça. C'est vous qui devez vous en rendre compte au fur et à mesure, mais ça prend du temps.
C.: Comment on apprend ça?
C.D.F: Je ne sais pas, il n'y a pas d'école pour ça. Il devrait y en avoir, ça devrait faire partie de la formation du comédien, c'est vrai, dans des écoles de théâtre, peut-être, ou en faisant des stages. Mais en général, oui, on souffre et après, on apprend de son expérience douloureuse.
C.: Pour vous, c’est quoi la différence entre le cinéma et le théâtre?
C.D.F: C'est deux choses très différentes, à part le plaisir de jouer, qui est identique. Et puis, le rapport au public est très différent. Quelquefois, au cinéma, on oublie qu'il va y avoir une audience qui va recevoir ce qu'on est en train de faire. Alors qu'évidemment, au théâtre, c'est charnel, c'est incarné, c’est direct, c'est là, c'est concret. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Dans la technique, évidemment. Mais je crois que ce qui reste en commun, c'est le plaisir, c’est s'amuser à jouer, en fait.
C.: Vous ne souffrez pas en jouant?
C.D.F: Non, jamais, parce que je choisis bien mes projets. Même si je dois jouer la souffrance, j’accepte de la jouer et ça veut dire que j'ai du plaisir à la jouer. Si je m’investis dans cette histoire à laquelle je crois, à ce personnage qui m'excite, si ça m'intéresse de l'interpréter, si c'est un metteur en scène qui m'intrigue, je ne souffrirai pas, forcément. Moi, ce n’est pas comme ça que je fonctionne en tout cas.
C.: Qu’est-ce qui vous a plu dans Par amour de Elise Otzenberger?
C.D.F: C'est un film qui invite à retrouver la foi en l’amour, qui invite à croire en la famille, en les gens qu'on aime, à croire nos enfants, à honorer leur confiance, à renouer avec notre part d'enfance aussi. C'est un film qui invite à espérer, à rêver, dans un monde où il n'y a plus de place pour les rêves. C'est un film qui envoie plein de messages, je trouve, plein d’espoirs alors que le point de départ, c’est une famille en crise, une maman qui a perdu son droit à l'insouciance, qui est enfermée dans sa charge mentale, qui est surmenée face à un enfant pré-adolescent, à son couple aussi en crise. Tout démarre dans quelque chose de très réaliste, de très intimiste aussi. Et puis, surgit de manière très suggérée et très poétique, le fantastique. C'est un film qui interroge. C'est aussi pour moi un parcours de personnage, une trajectoire qui est vraiment très intéressante du côté de la dramaturgie et qui pose beaucoup de questions. Cette femme nous interroge énormément sur sa folie, sur le fait qu'elle lâche les règles de bienséance, sur le fait qu'elle prenne des risques. J'aimais bien ce personnage, ce que revendique Elise Otzenberger, notamment d'être en connexion avec le monde de l'enfance, que ce soit notre part d’enfance ou le lien avec nos enfants.
C.: Vous sentez que les femmes ont plus de place aujourd’hui?
C.D.F: Oui, tout d’un coup, il y a une prise de conscience. C’est vrai, elles ont peut-être des choses à raconter puisqu'elles représentent la moitié de la population mondiale, elles ont peut-être plein d'histoires passionnantes à exprimer. C'est ce qui se passe avec Par amour d’ailleurs. C'est la trajectoire d'une maman. Il y a beaucoup de mamans quand même sur Terre donc il y a beaucoup de mères et de parents d'ailleurs qui peuvent s'identifier à elle. Moi, je me suis identifiée à beaucoup de personnages principaux masculins, finalement, je n'avais pas le choix. Là pour le coup, c'est un personnage féminin. Mais je pense que les hommes qui sont aussi écrasés par la charge mentale familiale peuvent aussi se reconnaître en elle. Laisser la place aux réalisatrices, leur permettre d’exprimer leurs obsessions, oui, c’est nouveau. C'est chouette qu'on les écoute.
C.: Vous n’avez jamais été tenter de filmer à votre tour?
C.D.F: Moi, non. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à être au service de quelqu'un qui a une histoire à raconter. Moi, je n'ai pas d'histoire spécialement à raconter. Et c'est déjà beaucoup d'être moi-même, avec mon corps, ma tête, ma voix. C'est déjà pas mal. J'amène déjà beaucoup de moi dans chacun de mes personnages, dans chaque histoire que j'ai envie de défendre.
C.: Vous avez étudié à l’ENSATT, l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à Lyon, de 1995 à 1998. Qu’en tirez-vous comme expérience?
C.D.F: Pour moi, c'est une école formidable, surtout parce qu'il y a tous les corps de métier du théâtre. Il y a des scénographes, des administrateurs, des ingénieurs son, lumière, des comédiens, et peut-être qu'il y a encore maintenant une nouvelle branche. En fait, ce qui est formidable avec cette école, c'est que moi, je suis encore en lien aujourd'hui avec les gens, les étudiants avec qui j'ai vécu ma formation de trois ans, et ça, c'est très, très, très précieux. Ça n’existe pas au Conservatoire. Au Conservatoire, ce ne sont que des comédiens, par exemple. À l'ENSATT, tous les corps de métier sont là. Ces connexions qu'on se fait à cet âge-là, entre 20 et 25 ans, on peut les garder toute sa vie, et c'est mon cas.