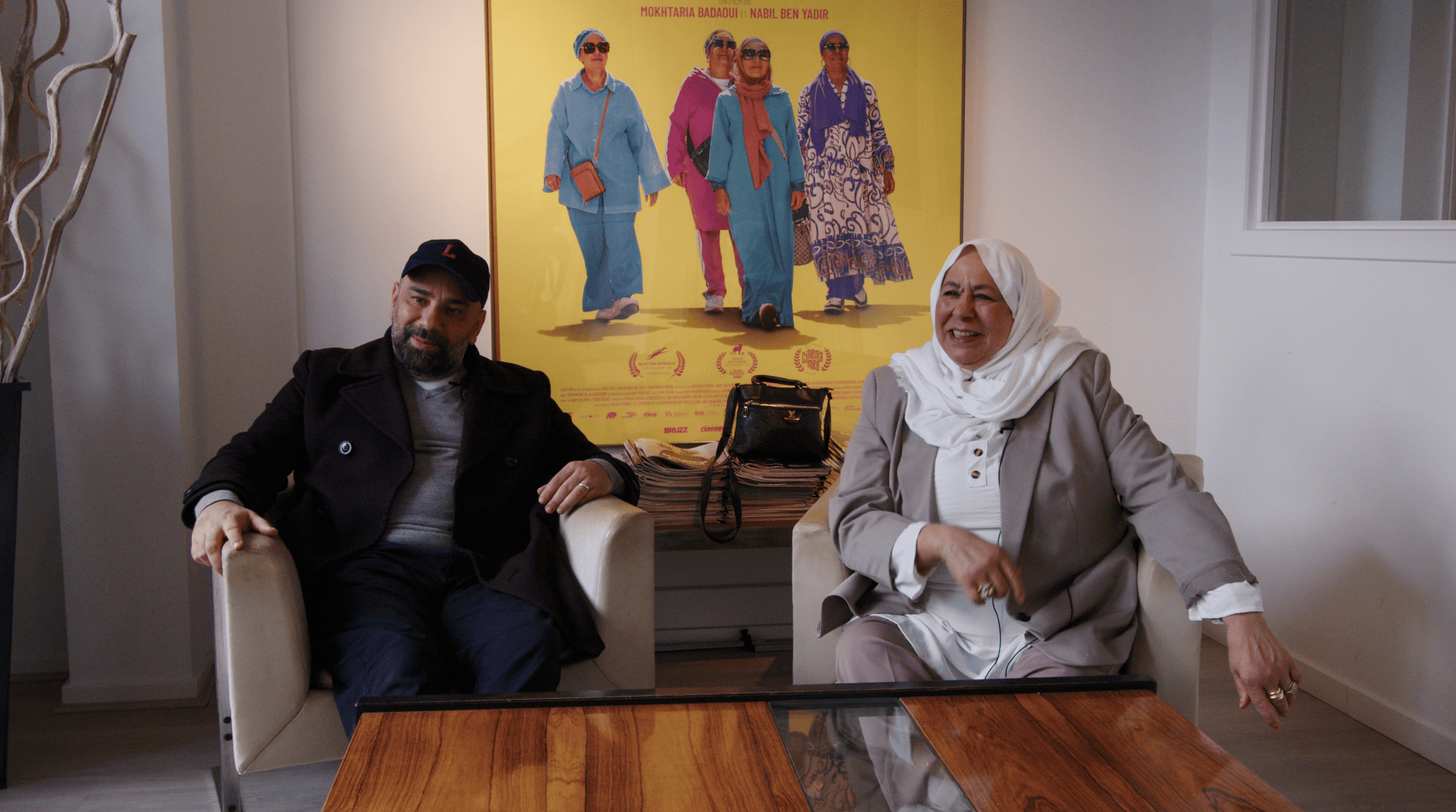Tant qu’il y a de la vie, il y a des films
Tout est parti d’une promesse au coin d’une rue, là-bas au Burundi, en 1991. Philippe de Pierpont était de passage à Bujumbura avec l’atelier Graphoui quand il rencontre Zorito, Etou, Innocent, Philibert, Jean-Marie et Assouman, six gamins des rues. Ils se promettent de ne jamais se quitter. À la vie, à la mort. Le réalisateur leur promet de revenir pour filmer les moments charnières de leur existence jusqu’à leur mort. Ils ont aujourd’hui 40 ans et la promesse tient toujours. Filmés enfants, adolescents, adultes, il n’y en a aujourd’hui plus que trois. Trois cœurs vaillants, trois ombres vacillantes qui hantent le dernier documentaire de Philippe de Pierpont : In Another Life, la suite de Birobezo (1991), Bichorai (1994) et de Maisha ni Karata (2003). L’occasion pour eux de faire le point sur leur vie, bien loin du long fleuve tranquille.