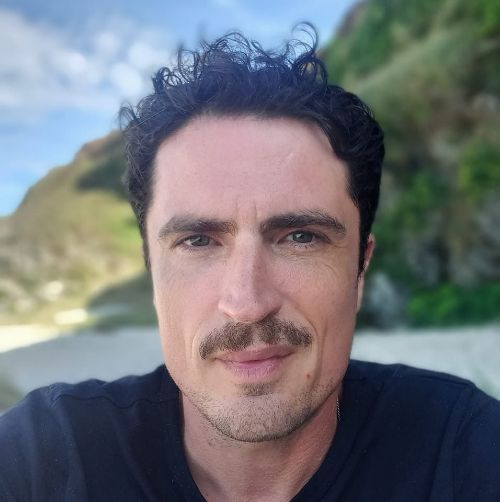Cinergie: Votre récent premier film L’Employée du mois plonge le spectateur dans un huis-clos qui permet une certaine efficacité narrative et dramatique; cette structure - qui n’est pas sans rappeler celle du théâtre, voire du cartoon - faisait-elle partie de vos intentions de départ?
Véronique Jadin: A l’origine, c’était pour des raisons bêtement matérielles et financières. J’ai écrit ce film pour le bientôt célébrissime appel à production Légère, d’où sont sortis Une Vie démente, Fils de plouc, etc. Grâce à ma longue expérience en tant qu’assistante réalisatrice, je sais ce que ça implique que de dire: “on va tourner ça”. J’ai donc su adapter le scénario au temps qu’on avait et à l’enveloppe budgétaire. Nous étions à 101 % des capacités de production, et ça a tenu jusqu’au bout. A l’inverse, je vois des camarades qui pour leur premier long-métrage, écrivent des scénarios qui sont à 150 % de leur temps et de leur budget, et donc ils se “viandent”, faute de moyen. C’est toujours le même problème avec un premier long-métrage.
C.: Avez-vous dû refreiner vos ambitions?
V.J.: Oui, absolument. Une assistante réalisatrice m’avait fait une lecture du scénario avant la prépa, et m’avait dit qu’il fallait retirer au moins quinze pages. Nous avons donc dû supprimer une péripétie, mais rétrospectivement, je pense que cela a fait du bien au film.
C.: Était-ce une scène avec un mort de plus?
V.J.: Oui, c’était ça (rire). Mais un mort extérieur au huis-clos, donc je pense que cela aurait alourdi la narration. Mais ce que ça veut dire, c’est qu’être réalisateur.rice implique de se battre tout le temps et contre tout; même contre soi-même.
C.: Cette unité de lieu, mais également de temps et d’action était-elle nécessaire pour caractériser le récit que vous avez choisi de raconter?
V.J.: Oui, d’une certaine manière, puisque l’idée de base était de représenter cette femme dans son environnement quotidien, comme ce pauvre petit poisson parme enfermé dans un aquarium, et qui se débat contre les méchants poissons en costume. Ça faisait écho à The Office, qui est une série que j’ai tellement regardée - et que je ne dois même plus regarder car je la connais vraiment par cœur.
C.: La mort accidentelle du directeur était-elle indispensable pour aller au bout de vos intentions?
V.J.: Oui, c’est l’incident déclencheur qui était présent dès le début, et qui fait basculer le récit de l’autre côté de la légalité. Cette mort a aussi quelque chose de comique, qui n’empêche absolument pas le déploiement de problématiques sociales, antisexistes, antiracistes, etc. Et finalement, les gens sortent de la projection du film avec un sourire jusqu’aux oreilles, tout en ayant absorbé un contenu politique à l’insu de leur plein gré, et c’est quelque chose que je trouve super! Beaucoup de personnes m’ont remerciée de cette originalité. Mais il était nécessaire que ces deux femmes restent sympathiques aux yeux du spectateur; or elles tuent des gens. Donc l’une des premiers choses à faire était de gommer la vie personnelle de ces victimes (qu’il n’y ait surtout pas d’orphelin, ou même tout simplement de personnes tristes). Au début, il était prévu que la femme du directeur vienne pour chercher son mari qu’elle n’allait évidemment pas trouver. On a retiré cette scène car elle pouvait créer de l’empathie envers le directeur, alors qu’on a plutôt envie de se réjouir de sa mort. On a beaucoup travaillé cette structure de gradation avec la scénariste Nina Vanspranghe, pour qu’au moment où elle prend le revolver et tue de manière ostensible, on soit hyper content. Quand je vois le film en salle, je vois que ça fonctionne puisque les gens sont ravis. Et je ne pensais pas que la réplique qui suit le coup de feu (à savoir: “Putain! Ça fait du bien.”) susciterait autant d’engouement. Elle empile des cadavres, certes, ce qui est horrible et totalement amoral. Mais elle prend le pouvoir et on est heureux pour elle, malgré le sang qui coule...
C.: C’est suite à cela qu’elle endosse une posture de criminelle acharnée; que se passe-t-il dans l’esprit du personnage à ce moment précis?
V.J.: Tout cela repose sur un running-gag qui est le café très mauvais que prépare Inès. Comme c’est la boniche du bureau, elle se retrouve à faire le café, mais comme elle n’en boit pas, tout le monde lui dit qu’il est infect. A un certain point, tout cela devient insupportable pour elle. Comme au début, quand le directeur s’apprête à la violer, on comprend que jusqu’à présent elle n’a jamais réalisé que c’est du viol, de l’abus de pouvoir, etc. Quand ça fait vingt ans qu’on est sous-traité et mis dans des positions d’infériorité, on pense que c’est normal. Peu à peu, elle prend conscience de tout cela, et c’est un carcan entier qui explose. Sauf que c’est sur une réflexion de plus au sujet de son café qu’elle tue de sang-froid, alors qu’elle a vécu des choses cent fois pire que ça. Mais je pense que c’est le propre du parcours de l’humain; parfois tout s’embrase à des moments inattendus, sur des détails absurdes.
C.: C’est à ce tournant que votre film bascule dans un schéma de film de genre, chose qui n’était pas votre intention au départ...
V.J.: Il y a une partie de moi qui sait que si on empile des cadavres, que l’on sort de l’acide et du sang, on bascule effectivement vers le film de genre, mais je crois que je ne me rendais pas tout à fait compte de ces implications. Mon idée de départ était de remettre en cause l’inégalité salariale, qui est juste insupportable quand on la vit. Je pensais donc que mon film allait s’adresser à des femmes de ma génération ou plus jeunes, qui allaient se reconnaître dans ce récit. Quand j’en parlais à des hommes, y compris des réalisateurs - parce que l’inégalité salariale existe aussi au niveau des réalisateurs -, ils s’en fichaient un peu, parce que ça ne les concerne pas. C’est donc ça que j’essayais de viser à travers ce film. Je pense finalement que c’est par soucis de légitimité que j’ai eu recours à des codes du film de genre, mais aussi pour toucher d’autres type de spectateurs que les femmes de mon âge. C’est donc très drôle de voir que le film touche plein d’autres personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces questions, notamment au féminisme.
C.: Ainsi, peut-on penser à juste titre que ces cadavres et ce sang étaient un moyen de parvenir à vos fins?
V.J.: C’est assez drôle parce que j’ai travaillé des mois entiers sur ce scénario, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question, ce n’était pas conscient. J’espérais juste être prise dans quelques festivals de films de femmes, et quand c’est arrivé et que l’on m’a posé des questions, je me suis rendu compte de certains aspects que j’avais incorporés presqu’inconsciemment, mais qui étaient très logiques avec le reste.
C.: Pourquoi le film dégénère progressivement, de façon si radicale et irréversible?
V.J.: C’est le propre du personnage d’Inès, qui veut que tout soit toujours impeccablement propre. Après qu’elle a nettoyé la première tache de sang, inévitablement tout s’enchaîne. Nous en avions beaucoup discuté avec la scénariste et la comédienne Jasmina Douieb. La question était de savoir si le personnage d’Inès, avec son chignon parfait, ses talons et son tailleur parme, allait finir par tout arracher et sortir de sa propreté. C’est une voie que nous avons failli prendre, mais en réfléchissant, il nous a semblé plus intéressant qu’elle reste obsédée par l’ordre et la propreté, tout en devenant une sérial-killeuse et en se libérant d’elle-même. C’est comme ça que sa “machine de nettoyage” s’emballe peu à peu. L’une de mes inspirations à ce niveau est Femmes au bord de la crise de nerfs, d’Almodóvar.
C.: J’ai été charmé par le ton très outrancier du film - outrance des cadavres notamment, qui donne lieu à une pensée logistique sur la façon de s’en débarrasser. Outrance des gags sur ces différentes opérations de main d’œuvre. Pouvez-vous nous parler de votre rapport à cette manière outrancière et irrévérencieuse de raconter des histoires ?
V.J.: C’était présent dès le départ, mais je n’étais pas sûr de la façon dont nous allions procéder. On a donc cherché sur Google pendant des heures: “comment se débarrasser d’un cadavre”; on a aussi repensé à C’est arrivé près de chez vous, à Breaking Bad. Tout cela me fait beaucoup rire, mais j’ai quand même une limite au sang et à la violence. L’essentiel était que l’ensemble reste joli, même si c’est un peu gore. Finalement le film plaît aux ados et grands enfants, ce que je ne prévoyais pas du tout, parce qu’il y a des punchlines et un peu de sang, même si c’est en quantité bien moindre que ce qu’ils ont l’habitude de voir.
C.: La construction de ce duo comique (Jasmina Douieb et Laetitia Mampaka) participe sans doute aussi à cet engouement...
V.J.: Oui, l’idée qui a émergé dès quatre lignes d’écriture était de créer un buddy movie à partir de deux femmes très différentes. Cela permet d’avoir deux regards sur la situation: celui de la femme qui est là depuis des années et qui ne se rend compte de rien; et de l’autre côté celui d’une femme extérieure, plus jeune et racisée. Mais au début, elles n’ont aucune complicité: la première prend la seconde de haut pour lui expliquer un peu la vie, tandis que la seconde méprise la première et désapprouve cette vie dans ce bureau ringard où ne règne que maltraitance et hypocrisie. Ce duo constituait donc un réservoir de comédie et de narration. Evidemment le casting fait qu’elles sont toutes deux bien plus dingues que ce que j’espérais sur papier.
C.: L’étape du montage est toujours décisive dans le développement d’un film, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une comédie, notamment pour donner le rythme. Avez-vous des anecdotes de montage à partager?
V.J.: J’ai eu beaucoup de chance car c’est un monteur bien plus expérimenté que moi qui s’en est finalement chargé, Yannick Leroy, qui a notamment travaillé sur des comédies comme Je suis mort mais j’ai des amis, ou Faut pas lui dire. Sa salle de montage était attenante au décor dans lequel on tournait, et donc il montait progressivement à mesure que le tournage avançait. Cela m’a énormément rassurée, puisque le décor (constitué de merveilles miraculeusement assemblées par la cheffe déco Jennifer Chabaudie) ne permettait pas de faire des re-shoots après. Il fallait absolument que l’on est tout. Mais j’avais la possibilité de regarder les rushs quand j’avais un peu de temps. Donc je n’ai pas eu ce moment extrêmement pénible où on regarde tous les rushs de A à Z en se disant; “Je suis nulle, c’est pas bien, ça va pas ce que j’ai fait, c’est terrible...”. Alors bien sûr, nous avons énormément travaillé puisqu’il s’agit d’un montage au millimètre. Tous les quinze jours, on montrait le film à quatre ou six personnes, on posait des questions de compréhension, de rythme, et ensuite on retravaillait, inlassablement. Vers la fin du montage on a aussi fait une vision dans une école de cinéma avec nonante ou cent jeunes, à qui on a distribué des questionnaires. Le but était de s’assurer qu’un public très large pouvait comprendre ce film qui vient d’un endroit très personnel et qui va dans une direction très tranchée. C’est une méthode dangereuse car si on essaie de faire plaisir à tout le monde, on peut s’éloigner de ce qu’on veut réellement. Il n’était pas question de revenir sur l’intention globale qui était de faire un film joyeusement amoral. Tout ce qu’on voulait c’est que les gens comprennent et sourient, puisque c’est le défi d’une comédie. Je crois donc que cette méthode a été une réussite.
C.: Avez-vous eu l’intuition que ce film qui, rappelons-le est votre premier, toucherait un public international?
V.J.: Non, car c’est un petit film, en plus tourné pendant la période du COVID, donc on avait plutôt l’impression que c’était la fin du monde, pour les salles de cinéma en particulier. Donc cela a été une énorme surprise. Par exemple en ce moment, nous sommes en mars – mois de la francophonie – et il passe dans pas moins de douze pays comme la Pakistan, la Suède, le Rwanda; c’est tout simplement super!
C.: Revenons un peu sur votre parcours si vous voulez bien, qui en différents points, est un peu atypique...
V. J.: Je crois que j’ai toujours voulu écrire, et le cinéma m’est apparu à l’adolescence. Mes parents étaient très inquiets car ils ne connaissaient personne dans le cinéma et ça leur semblait très abstrait. Ma mère pensait que prof de français est un métier qui m’irait très bien. J’ai donc fait des études de Lettres romanes à l’université. Je suis ensuite rentrée dans une école de cinéma et ça s’est très mal passé, pas pour moi mais plutôt pour le prof en fait. L’année s’est terminée avec l’idée que je ne pourrai jamais faire un film, ni même brancher un câble ou apporter une tasse de café. Je n’avais apparemment pas le niveau. J’étais un peu perdue puisque je n’avais aucun accès au monde du cinéma. Et puis par hasard, quelqu’un de cette école m’a appelée (Stéphane Lhoest) pour faire de la régie sur un court-métrage la semaine suivante. J’ai tout de suite couru et c’est comme ça que j’ai commencé à avoir du travail et à gagner ma vie en tant que régisseuse puis assistante réalisatrice. Et heureusement car sinon je serais allée vers l’enseignement, sans aucun moyen de revenir vers le cinéma. Ensuite j’ai écrit un premier court-métrage que j’ai déposé en commission. Coup de bol! il est passé du premier coup. S’il n’était pas passé, je n’aurais jamais retenté, faute de légitimité, surtout qu’à l’époque il me fallait deux ans pour déposer un dossier en commission, c’était affolant. Et au début je n’y connaissais vraiment rien, donc ça faisait un peu “Pierre Richard veut faire du cinéma”... Mais petit à petit ça a marché.
C.: Et pour un prochain film, avez-vous déjà des idées de scénario?
V. J.: J’espère qu’il y en aura un... Là je travaille sur une comédie romantique et deux séries télé, comiques aussi. Mais j’ai plein d’autres projets, en général j’ai trop d’idées, mais pas assez de temps ou d’encrage pour les réaliser. Donc beaucoup de comédies, et du politique. Mais je pense que plus tard, quand je serai grande, j’aimerais vraiment faire des films que politiques, mais on verra. En attendant la comédie c’est une manière de dire “Je ne vais pas vous ennuyer, excusez-moi, je ne vais pas prendre trop de place, etc.”. Mais quand je serai vraiment adulte, je ferai sûrement un film tragique et sérieux, ou alors ennuyeux (rire).