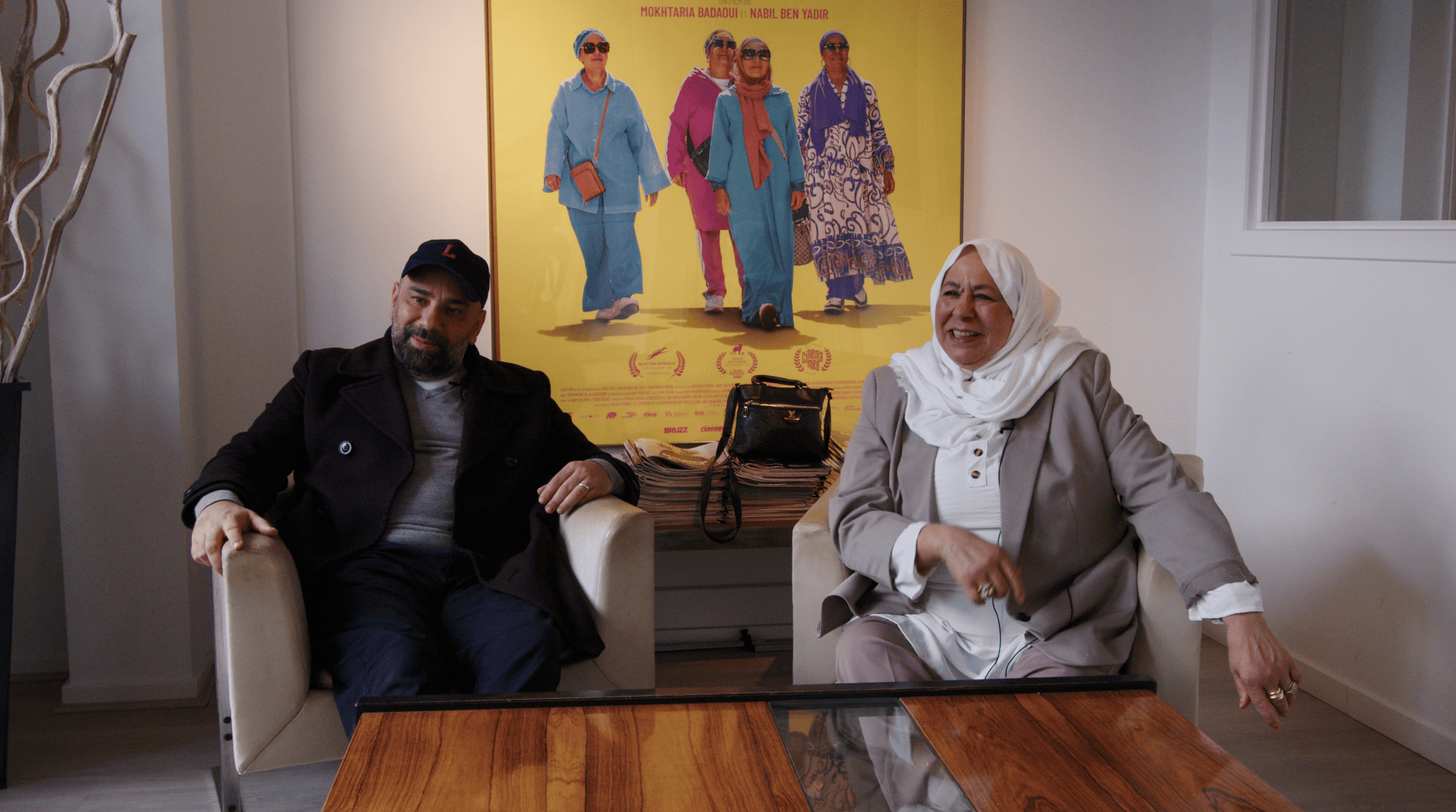Le Fantôme de Truffaut, le livre de Frédéric Sojcher, est une suite plus autobiographique de son livre intitulé André Delvaux, le cinéma des rencontres (Editions du Seuil/Archimbauld). De nombreuses rencontres de réalisateurs, d'actrices et d'acteurs, de techniciens et de scénaristes parsèment ce nouveau livre. « L'amour du cinéma, c'est l'amour des choses que l'on voit et que l'on vit par procuration. Or aimer, c'est admirer, c'est imiter. Alors comment arriver à imiter ceux que l'on admire et qui font votre vie imaginaire ? », écrit Frédéric Sojcher. Cinq questions-réponses avec Cinergie autour d'un verre de bière dans un café bruxellois de la Porte de Namur.
Entretien avec Frédéric Sojcher

Cinergie : Dans le Fantôme de Truffaut, tu reviens sur le parcours du cinéaste, un processus qui se déroule du scénario à la diffusion du film.
Frédéric Sojcher : J'ai l'espoir d'aller au-delà et de raconter le processus des rencontres et des obstacles. Il y a toujours un côté romanesque dans la vie d'un réalisateur. Le problème, c’est que souvent, on a une certaine pudeur, on oublie les obstacles et on ne parle plus que du côté positif. Ce qui est un angle intéressant puisque pour le critique ou le spectateur peu importe comment le film a été conçu : il n'y a que le résultat qui compte. Par contre, si on veut produire ou réaliser des films, il est important de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Comment dépend-on des producteurs ou des comédiens ? Comment se fait la diffusion dans les salles ? (surtout en Belgique pour les films francophones, où cela est particulièrement difficile). Il y a un combat que j'ai envie de mener avec l'espoir que ceux qui veulent faire des films, les étudiants qui veulent réaliser, découvrent des pans du cinéma qui ne sont pas connus et ne sont pas enseignés, et que ceux qui ne sont pas cinéphiles puissent être pris par le côté « romanesque ». Certes, ce n'est pas un roman, c'est la vraie vie, mais parfois, elle peut être romanesque. Truffaut disait, dans La Nuit américaine, que la vie devrait être comme un film de cinéma. De toute façon, il y a des vases communicants entre les deux. Dès les Quatre cents coups, son premier long métrage, il parle de sa propre vie, celle de son enfance. Mais cela n'est pas qu'autobiographique, cela parle à tout le monde et pas seulement à ses copains. En parlant de soi, on peut se dépasser.
J'avais envie de parler des gens qui ont compté pour moi, des portraits, comme dans le livre sur André Delvaux, de personnes connues ou inconnues. Par exemple, Hadelin Trinon, un professeur de cinéma, ou Arletty que j'ai pu rencontrer.
Je voulais aussi montrer comment se déroule le processus du temps qui passe. Comment, en dehors de mon parcours, les destins se développent. Comment on se rencontre, on se perd, et on se retrouve. Mais aussi des rencontres qu'on rate. Cela me fascine.
Cela peut paraître étrange de faire une autobiographie à mon âge, mais c'est une volonté de vaincre ma timidité (rire)... Si, si ! J’étais très intrépide quand j'avais 15, 16 ans. Aller chercher Serge Gainsbourg chez lui à 16 ans, c'est culotté. Il a accepté de jouer dans mon film à cause de cela. Aujourd'hui, je n'aurais plus ce culot, j'ai vieilli. J'essaie de comprendre pourquoi les destinées des uns et des autres se rencontrent ou se perdent.
C. : Dans ton livre sur André Delvaux, tu écris qu’il t’a expliqué que la pauvreté des moyens devenait une force...
F. S. : Le cinéma est une sorte de croyance dans l'imaginaire et dans l'envie de le faire partager, par exemple, entre un comédien et un réalisateur. Il ne faut pas le concevoir comme un produit manufacturé, mais comme un pari qu'il faut faire avec des comédiens, des producteurs et une équipe. Un pari qu'il faut sans cesse renouveler. J'ai eu des expériences négatives et productives.
Il y a quelque chose d'artisanal, d'organique dans l'envie de réaliser un film, comme s’il était vivant et prenait vie. Dans un cadre industriel et manufacturé, c'est l'antithèse de cette démarche autour de la foi qui nous anime dans un projet commun avec sa part d'inconnu. Car il y a toujours une part d'inconnu dans un film, même si on écrit un scénario qui est maîtrisé. Le tournage, le choix des comédiens et de la musique : il y a des strates qui s'additionnent, qui donnent une cohérence au film et qui font que le film aura une force attractive ou pas. C'est une démarche artisanale dont le formatage est l'antithèse. Evidemment, Hollywood parvient à résoudre cette contradiction. C'est un système industriel dans lequel il y a des iconoclastes – Scorsese les appelle des contrebandiers – qui arrivent à pervertir le système pour tracer leur propre voie.
Même dans un cadre industriel, il y a aussi parfois des personnalités fortes qui peuvent arriver à développer un univers personnel. C'est ce qui fait la force d'Hollywood. C'est beaucoup moins vrai dans d'autres cinématographies qui sont arrivées à réunir le système artistique et industriel. En tout cas, la force du cinéma belge a toujours été d'être un artisanat. On n'a donc pas intérêt, avec des cinéastes très différents les uns des autres, de perdre ce qui fait notre singularité.
C. Tu as un grand souci de transmission, de lutte contre l’oubli.
F. S. : C'est essentiel. On ne part jamais de nulle part. S'il n'y a pas de transmission, il y a un manque. Toute la question est de découvrir sa propre voie en préservant les acquis qui viennent des générations précédentes. Il y a la transmission, et ce que l'on apprend des jeunes générations. C'est un échange. J'ai la chance d'être enseignant et de découvrir les générations suivantes. Il est important d'être en connexion avec ce que vivent les nouvelles générations, qui ont d'autres imaginaires, de nouvelles manières de raconter les histoires tout en préservant une démarche créative. Parce que dans notre société, une trop forte pression économique risque de perdre ce qui fait la force du cinéma. Aujourd'hui, il y a une tendance à ce que la rentabilité écrase la création. Il faut un équilibre entre les deux. Victor Hugo disait on connaît le prix de la culture, on ne connaît pas le prix de l'inculture.
C. : Que penses-tu de la diffusion ?
F. S. : Le drame d'aujourd'hui, c’est que beaucoup de films ne rencontrent pas leurs spectateurs dans les salles. La plupart du temps, les spectateurs pourraient prendre plaisir à découvrir un film dont ils ne savent même pas qu'il existe.
Il y a un problème de sélection entre les films dits « du marché » soutenus massivement par un grand nombre de copies, et le reste, qui bénéficie d'une part congrue de la diffusion. Ce qui pose une vraie question : le cinéma peut-il rester un art populaire ou juste une affaire économique ?
Mon rêve est ce que défendait Truffaut, avoir un univers qui lui ressemble, tout en ayant un public. Ce type de film est de plus en plus difficile à réaliser aujourd'hui. Et cela dépasse et de loin la seule Belgique francophone.
C. : Que se passe-t-il alors par rapport au cinéma européen ?
F. S. : Ici, en Belgique, il y a eu d'ardents défenseurs du cinéma européen. Le premier d'entre eux étant Jean-Claude Batz, l'un des fondateurs de l'INSAS. En Belgique, on s'est très vite rendu compte que le marché était trop petit, le nombre de spectateurs potentiels étant restreint - sans compter la spécificité multiculturelle de la Belgique, entre Flamands, Wallons et Bruxellois.
Il y a une faillite démocratique face à l'identité européenne menée par des technocrates qui n’en ont aucune vision. On a pu le constater avec les dérives sur l'exception culturelle. La France défend que l'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres, et que chaque pays doit défendre son identité culturelle. José Manuel Barroso, bien que représentant les pays membres, s'est permis de dire qu'il n'était pas d'accord avec cette position, ignorant l'enjeu de la culture qui va bien au-delà de l'économie. Imaginons que le président d'une multinationale marque son désaccord avec son conseil d'administration. Soit il démissionne, soit il est viré.
Nous sommes imprégnés par la culture de notre temps, par les films, par les livres et tout un environnement, et cela ne se calcule pas uniquement avec des chiffres. La force de l'Europe est d'être une méga puissance culturelle avec la France, l'Italie, l'Allemagne et bien d'autres pays. André Delvaux, lorsque qu'il a fait l'Œuvre au noir, imaginait que l'Europe puisse avoir une nouvelle Renaissance autour des échanges culturels et artistiques entre les nombreux pays qui s'additionnent. L'Europe a un potentiel dont elle ne se sert pas.
Le Fantôme de Truffaut aux Editions les Impressions nouvelles