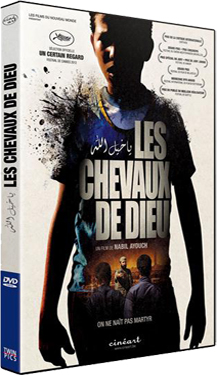Cinergie : Vous avez une formation de comédien et de metteur en scène. Vous avez commencé dans la pub. Comment vous êtes-vous retrouvé au cinéma en tant que réalisateur et producteur ?
Nabil Ayouch : Disons que j'ai essayé de faire l'acteur, mais je n'étais pas très bon. J'avais des choses à exprimer, mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas choisi le meilleur moyen. Je me suis orienté vers la mise en scène de théâtre. Les thématiques qui me sont chères, comme la quête initiatique dans Les Pierres bleues du désert ou Mektoub, liées au fait que j'ai une double identité et des racines plurielles, rendaient l’espace théâtral un peu trop étriqué pour les exprimer. J'avais besoin d'aller vers les grands espaces que seule la magie du cinéma peut offrir. C'est pour cela que j'ai bifurqué, et d'abord vers la publicité. C'était un travail alimentaire, mais je me suis rendu compte que c'était une très bonne école pour apprendre à travailler vite, avec beaucoup de contraintes et pour raconter une histoire en peu de temps. Et puis, cela permet de rencontrer des techniciens avec lesquels on crée des liens, et on commence à se faire sa petite famille.
C. : Vous êtes amis avec Faouzi Bensaïdi et Jamel Debbouze. Est-ce en faisant vos études d'acteur que vous les avez rencontrés ?
N. A. : Non, j'ai rencontré Jamel Debbouze en cherchant le héros de mon premier court métrage, Les Pierres bleues du désert. La comédienne marocaine qui jouait le rôle de la mère, Naïma, m'a parlé d'un jeune apprenti comédien extraordinaire, qui faisait de l'impro dans sa ville de banlieue, dans les Yvelines. Je suis allé à ses matchs d'impro, et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose dans le ventre. J'avais 21 ans et lui, 15. Avec Faouzi, c'était un peu la même chose, mais sur mon premier long métrage, Mektoub. À l'époque, il n'avait pas encore réalisé, il sortait d'une école de théâtre de Rabat.
C. : Quelles sont vos références cinématographiques ?
N. A. : J'aime beaucoup Chaplin, son sens de la politique de la mise en scène; le fait qu'il ait été entrepreneur de cinéma, qu'il se soit donné les moyens de construire un système, un formidable studio, sa volonté de devenir indépendant à une époque où les studios américains contrôlaient tout, encore plus que maintenant.
J'ai été impressionné par le mode narratif des films de Terence Malick, jusqu'aux deux derniers qui m'ont moins convaincus. Je trouve qu'il a véritablement inventé un langage. J'aime aussi beaucoup les films de James Gray et certains films de Kusturica.
C. : Vous avez intégré l'action dans vos films, mais dans les Chevaux de Dieu, par exemple, on ne voit pas l'explosion; on voit seulement ce qui se passe avant et après.
N. A. : Je trouve que la violence n'est pas un spectacle, et je ne voulais pas faire un film sur la violence, mais sur la condition humaine. Je trouve que le point de vue américain sur l'extrémisme ou le terrorisme, même si c'est un point de vue que je respecte et qu'il y a des films très respectables comme Syriana, désincarne trop souvent la violence. Enlever des noms, des visages, ne sert pas le propos, parce qu'on devient monochrome. Le méchant barbu qu'on voit de loin est forcément méchant parce qu'il est musulman et parce qu'il est islamiste et parce qu'il est radical, extrémiste : on ne le connaît pas, et il vaut mieux ne pas le connaître et le laisser à distance.
Moi, j'avais envie, au contraire, de passer de l'autre côté du miroir et d'essayer de comprendre comment et pourquoi des gamins, qui sont des gamins comme tous les autres, qui ont un nom, un prénom, une famille, un quartier dans lequel ils habitent, se sont fait exploser. D'accord, ils vivent dans un quartier misérable, mais si tous les gens misérables devenaient des kamikazes, il y aurait des centaines de millions de kamikazes sur terre. Il y a forcément d'autres raisons qui sont liées à leur être profond et à tous ces micro-traumatismes qui construisent un individu et qui le rendent, à un moment donné, plus perméable que d'autres individus à certaines thèses. Ce n'est pas un film sur les attentats, mais sur le mécanisme qui permet à des enfants de se transformer en bombes humaines.
C. : Lorsque vous avez tourné Ali Zaoua, Prince de la rue, dix ou onze ans avant les Chevaux de Dieu, et que vous aviez rencontré des enfants qui auraient pu être les kamikazes, parce qu'issus du même bidonville, aviez-vous déjà senti, à l'époque, que le désintérêt d'une société pour l'existence et le futur de ces enfants pouvaient les mener à des réactions aussi extrêmes ?
N. A. : Il y a définitivement une forme de consanguinité entre ces deux films, et les enfants d'Ali Zaoua auraient pu devenir ce que sont les héros adultes des Chevaux de Dieu, sans aucune équivoque. D'autant plus, pour l'anecdote, que j'ai tourné certaines séquences d’Ali Zaoua, à Sidi Moumen, en 1989, soit 4 ans avant les attentats, et que j'avais trouvé ce quartier paisible, les gens plutôt pacifiques. Quand j'ai entendu, le 16 mai 2003, que les gamins qui se sont faits sauter venaient de Sidi Moumen, c'était déjà en soi un premier choc pour moi. Maintenant, il y a des différences majeures entre les enfants de la rue qui vivent dans un environnement totalement déstructuré, sans références familiales, même brinquebalantes, et des enfants qui ont quand même une famille. Le bidonville est fermé, géographiquement, physiquement et mentalement. C'est pourquoi ceux qui lavent les cerveaux, ceux qui manipulent avec les textes, ne recrutent pas parmi les enfants de la rue. Ils préfèrent s'adresser à l'enfance fragile, dans ce type d'espace clos qu’est le bidonville. Il est évident que la violence, qu'elle soit individuelle ou sociétale, se construit sur le lit de l'injustice sociale et de l'injustice géopolitique mondiale. Ces thématiques sont récurrentes, et elles sont utilisées partout à peu près de la même manière.
C. : Entre Whatever Lola wants et les Chevaux de Dieu, il y a d'une part un monde féminin et de l'autre un monde masculin où il n'y a que de futurs guerriers. Deux sujets très différents ?
N. A. : Entre Lola, My Land et les Chevaux de Dieu, s'il y a des thématiques qui s'entrecroisent, c'est plutôt celles de la rencontre entre deux mondes, l'Occident et l'Orient, et cette incapacité à se parler, à communiquer. Il est vrai que dans les Chevaux de Dieu la représentation féminine symbolise un amour impossible, un amour mis à distance volontairement. Un des principes de l'éducation dans ce type d'endroit, et dans les pays du sud en général, c'est l'incapacité d'intimité entre un homme et une femme en dehors des liens du mariage. Cela provoque une relation à la sexualité complètement déstructurée, et souvent une absence d'amour. Je pense que si Yacine avait pu avouer son amour à Rizlaine, s'il n'y avait pas eu en permanence cette mise à distance, s'ils avaient eu un endroit où ils pouvaient se retrouver seuls, il ne serait pas allé se faire sauter. Quand on n’apprend pas à aimer et qu'on ne nous apprend pas à être aimé, à recevoir de l'amour, il y a quelque chose qui nous manque dans la construction de l'adulte qu'on devient.
C. : Est-ce que ce film s'adresse à l'Occident ou au spectateur musulman ? Est-ce que vous essayez d'expliquer au spectateur occidental ce qu'est l'Islam, qu'il ne faut pas le confondre avec l'extrémisme ou vous adressez-vous au public musulman pour le mettre en garde contre les manipulateurs qui pourraient se servir de leur foi et les mettre en danger ?
N. A. : Je ne fais pas de film pour un public, je fais des films pour le public, qu'il se trouve dans le monde arabe ou en Occident. Je crois qu'on a tous beaucoup à apprendre de ce type de phénomène et d'embrigadement, et la manière dont il se met en place. Au Maroc, comme à Londres, à Madrid, à New York, au lendemain d'attentats aussi violents, la réaction de tout un peuple est de sortir dans la rue, de manifester et de crier : « Plus jamais ça ». J’étais aussi parmi les manifestants au lendemain du 16 mai. Quand on fait cela, on ne fait qu'une partie du chemin. Si on ne veut pas que ça se reproduise, il y a la nécessité de plonger pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, car tout ne peut pas être expliqué, tout ne peut pas être montré. Il y a des choses irrationnelles. Je pense que ce travail est important, et il l’est pour toute société en prise avec le terrorisme ou l'islamisme radical. Je ne pense pas qu'il y ait une société qui soit à l'abri. Je n'ai pas voulu faire un film didactique, je n'ai pas voulu faire un film où on montre le bon Islam et le mauvais, j'ai voulu faire confiance à l'intelligence du public, qu'il soit arabe ou non. Je montre d'un côté des enfants qui deviennent des adultes et qui, au nom de la religion, sont manipulés, embrigadés, et de l'autre côté des gens qui se servent, qui utilisent cette religion qui n'est pas l'Islam, bien évidemment ! Ce n'est pas qu'il y ait un bon ou un mauvais Islam, c'est qu'il y a l'Islam et cette autre chose qui ne l’est pas. Depuis que le monde est monde, la religion est utilisée pour servir toutes sortes de causes.
C. : Un mot sur la coproduction ?
N.A. : Seuls les Etats Unis et l'Inde peuvent se permettre de faire un film sans co-production. Il y a une dimension artistique, des compétences et des savoir-faire qu'on vient chercher en Belgique et qui n'existent pas nécessairement ailleurs. Je pense à la post-production où la Belgique est très très bonne, mais je pense aussi à Hicham Alaoui, le chef opérateur qui, pour moi, est un grand chef opérateur, je pense à Emilie Flamand, la scripte, à Damien Cailleux, le monteur du film, avec qui j'ai eu de belles collaborations. Et puis, si on parle industrie technique, tous les plans subjectifs, en hauteur, sur le bidonville, ont été réalisés grâce à Flying-Cam, une société belge, et un inventeur formidable, le Studio l'Equipe. Ces apports sont fondamentaux pour le film, et ils vont bien au-delà de l'apport économique. En Belgique, vous avez des talents, croyez-moi, des talents et de l'humilité !