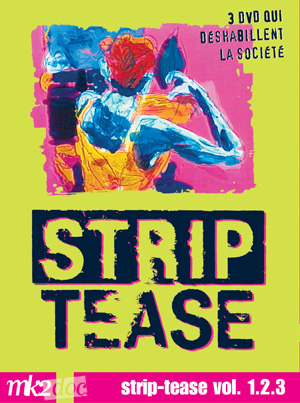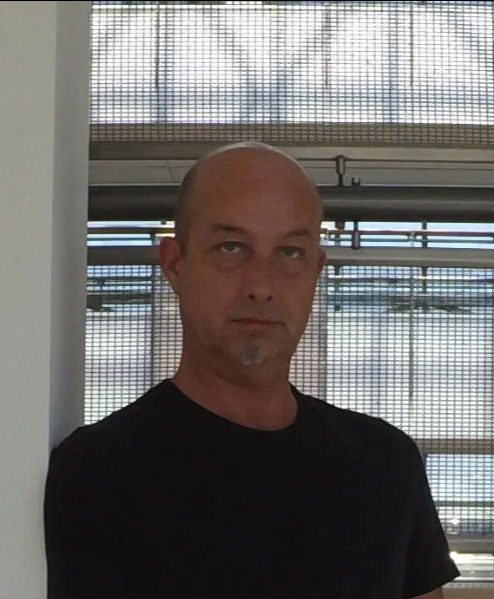Julien Brocquet : Daniel Daniel , Le faux reportage, Striptease… Pourriez-vous revenir sur la naissance de ce film culte qu’est C’est arrivé près de chez vous ?
André Bonzel : Au départ, il y a un peu de Striptease, c’est vrai, mais on voulait surtout faire un long métrage à tout prix. On était encore à l’INSAS. On avait réalisé un court Pas de C4 pour Daniel Daniel, qui nous avait permis d’aller dans plusieurs festivals (à Clermont-Ferrand, à Grenoble Polar…) On s’est dit: « faisons un long. En termes de durée, c’est quand même que cinq ou six fois un court. Si on a réussi à en fabriquer un comme ça, à l’arrache, avec trois francs six sous, pourquoi on n’y arriverait pas sur la durée d’un long ? » J’adore le court mais, malheureusement, ce n’est jamais considéré comme un vrai film… On a donc écrit une version longue de Daniel Daniel. On est partis sur l’idée d’un type qui faisait le mal pour aller en enfer. L’inverse du gars qui veut gagner ses ailes pour monter au paradis. Intournable. Puis, Rémy (Belvaux) a eu l’idée du faux reportage. On en tournait beaucoup du reportage à l’INSAS. Alors que, nous, on avait plutôt envie de faire de la fiction. On avait des profs qui étaient vraiment dans une école du documentaire social très « Borinage ». Ca nous gonflait pas mal. Mais ça nous a donné beaucoup d’expérience et fait comprendre que, quand on tourne et va quelque part avec une caméra, on ne peut pas être neutre. On va très vite manipuler avec le montage, mais même déjà au tournage. C’est une réaction à tout ça. Rémy avait réalisé un reportage sur un type à Charleroi, convaincu que sa fille unique allait devenir une star alors qu’elle chantait comme un pied. Il s’est senti mal d’avoir manipulé ce mec, gentil au demeurant. Ca avait été une expérience assez amère. Le film est un peu né de ça. Et le faux reportage l’a rendu possible. Pas cher. Bien plus facile, en termes de moyens. On n’avait pas besoin de grand chose. Tout est devenu possible.
J.B. : Vous avez quand même décrit le tournage du film comme compliqué ? En quoi ?
A.B. : On n’avait rien, aucun moyen. A l’époque, on n’avait même pas le téléphone à la maison. Quand on voulait fixer un rendez-vous ou organiser quoi que ce soit, on devait aller faire la queue à la cabine du coin. Benoît (Poelvoorde) habitait à l’autre bout de la ville. On se ratait. On se mettait des mots sur la porte : « Je suis passé ». « Où es-tu ? »… On n’avait même pas tout le temps une voiture. J’avais une vieille Citroen GS qui tombait souvent en panne. Puis, on n’était pas nombreux. Quatre ou cinq pour tourner. On était tributaires de tous ceux qui nous aidaient à faire le film. Ceux chez qui on allait filmer. Après il a fallu tout gérer. On a emprunté de l’argent à nos familles. Même si le film n’a pas coûté cher, à l’époque, c’était un gros investissement pour nous. J’ai revendu des trucs aussi. On tournait quand on avait de la pellicule. Quand on avait des acteurs… On avait la famille, les parents et les grands-parents de Benoît. Mais La femme violée, Le veilleur de nuit noir, il a fallu les trouver. La première semaine de tournage s’était révélée catastrophique. On n’avait pas grand chose en boîte. On avait tourné une première version de la scène du restaurant dans un vrai resto qui donnait sur la plage. Il y avait une perspective sur la mer mais il a fait nuit très tôt. Et le type du restaurant avait entendu parler de la scène de vomi et il ne voulait absolument pas de ça dans son établissement. Tout était à jeter. On n’a pas pu terminer. On a même dû payer les repas… On a finalement retourné la même scène dans un resto à Bruxelles. On a ajouté les bruits de mouettes derrière et ça le fait très bien comme ça.
J.B. : Ils viennent d’où, justement, le veilleur de nuit noir et la femme violée ?
A.B. : Pour Le veilleur de nuit, on avait demandé à un type dans un bar, je crois. La femme violée, elle, avait joué dans un film d’un copain de l’INSAS. A l’époque, on devait faire des films « à la manière de » et il avait réalisé un film à la manière de Fellini. Elle était déjà à poil dedans et il nous avait filé ses coordonnées. On avait essayé plusieurs pistes, notamment une comédienne qui faisait une pièce de théâtre entièrement nue. On allait dire aux gens: « On fait un film. Est-ce que vous voulez jouer dedans ? » - « Alors, c’est quoi mon rôle ? » - « Bien, il n’y a qu’une scène et vous vous faites violer. » - « Ah bon. Et qui sont les acteurs ? » - « C’est nous ». – « Je vais réfléchir et je vous dirai »… Cette scène a longtemps été reportée. On n’était pas super à l’aise non plus.
J.B. : Le film va tellement loin. Vous êtes-vous interdit certaines choses ?
A.B. : Non. On ne pensait pas que le film serait autant vu. Donc, on ne se posait pas la question. On faisait des choses qui nous faisaient marrer. On ne s’est rien interdit mais, à un moment, on avait pensé filmer le meurtre d’une femme enceinte. Elle perdait son enfant sur place. Et il y avait un fœtus. Ca, on a abandonné. La femme violée, on a imaginé la violer avec la caméra mais on n’y a pensé qu’après. L’idée, c’était de provoquer pour faire réfléchir. On voulait que le spectateur suive le même raisonnement que l’équipe du film.
Vincent Tavier: Je ne me souviens pas qu’on se soit posé la question en ces termes. Après, on lisait beaucoup de bandes dessinées. Des choses comme Hara-Kiri, Vuillemin… Notre grand trip en BD, c’était Bernet et Abuli. C’était Torpedo, un tueur sans morale. C’était inspiré de choses qui n’avaient pas beaucoup de limites non plus. Je pense qu’à l’époque, il y avait quand même toute une tradition avec les Reiser et autres, d’un humour en France assez trash, qui choquerait davantage aujourd’hui, je pense. Certaines couvertures d’Hara-Kiri ne passeraient plus aujourd’hui. Les mecs seraient au CSA ou en taule. C’était une autre époque.
J.B. : Ca aurait été plus compliqué de sortir C’est arrivé près de chez vous aujourd’hui?
V.T. : Ca reste un ovni dont chaque génération s’empare. Beaucoup de mecs qui ont 20 ans le tiennent pour un film culte. C’est qu’il traverse plutôt bien les époques. Il y a des choses qui sont beaucoup plus trash de nos jours. Une forme de pornographie à la télé, internet tout ce que tu y vois. Mais il y a aussi une forme de morale, de retour en arrière. L’époque est bizarre. J’ai le sentiment que, fin des années 80, on était encore dans une forme de contre-culture que je vois moins aujourd’hui. C’est un peu comme dans la musique. Quand on allait à des concerts ou en festivals à l’époque, on avait quand même l’impression de participer à un mouvement contestataire. Maintenant, tout est récupéré par l’économie, partout. Tu vas dans des festivals de rock, il y a des guichets de banque. C’est tout juste si on ne te greffe pas une puce sous la peau. A Tomorrowland, ils ont déjà le bracelet où ils peuvent voir minute par minute tout ce que tu as fait de ta journée. Comme je le dis toujours: on était des musiciens un peu frustrés avec Poelvoorde dans notre enfance. On a un peu fait en cinéma, et en un peu décalé, ce que les punks ont fait en musique. L’école enseignait des choses : « Tu seras d’abord deuxième assistant, puis premier assistant et peut-être qu’à quarante ans tu pourras réaliser ton premier film ». On s’est dit: « attends. Après tout, pourquoi devrait-on suivre les diktats de l’école ? » C’est pour ça aussi, je pense, que le film a été un choc. Il sortait de nulle part. Et même le système de production venait de nulle part. Il a quand même coûté 12500 euros et c’était en pellicule. Aujourd’hui, on pourrait presque le faire avec notre téléphone. Mais à l’époque, il fallait louer une caméra 16 millimètres. Acheter de la pellicule et payer le développement de laboratoire. Ca a été un ovni tel que Les Valseuses l’avaient été pour nous. Peut-être Easy Rider pour la génération d’avant. Le même genre de choc. Je pense qu’on est une génération pendant laquelle il s’est passé un peu des trucs. La même année à Cannes, il y avait Tarantino avec Reservoir Dogs. C’était les premiers jets de films un petit peu comme ça. Différents.
J.B. : Un réalisateur ou un film francophone belge vous a-t-il profondément marqué?
A.B. : Moi, j’aime bien Dikkenek pour sa folie. L’interprétation de Damiens. Tous ces personnages complètement déjantés. L’absence apparente de limites.
V.T. : C’est arrivé près de chez vous s’est quand même fort inspiré de documentaires, comme ceux de Manu Bonmariage. Cette école belge. Allô Police, des trucs comme ça. Après il y a des films ovnis comme Vase de Noces de Thierry Zéno. Quand on a vu ces trucs là, qu’on était adolescents, on s’est dit: « mais ça sort d’où ça ? » Il y avait des ciné-clubs à l’époque. Même la télévision belge passait des films très bizarres, qu’ils soient flamands ou francophones. Quand tu vois le dictionnaire des cinémas de Belgique, tu as quelques frappadingues quand même… Les documentaires, ça m’a marqué. Et le Zéno, c’était après, étrange avec de la musique contemporaine. C’est quand même un mec amoureux d’une truie qui lui fait quelques petits porcs… Et tu te dis « ah oui. Thierry Zéno, c’est le fils du docteur machin qui habite à Namur ». On allait tous les ans au festival du court-métrage Média 10-10 avec Benoît. C’était une fenêtre sur des trucs bien bizarres également. De sacrés cinéastes sont passés par là. Le cinéma belge était réputé chiant mais tu avais quand même des trucs bien flingués.
Julien Brocquet